
Dans le nouveau livre « La vérité sur Edouard Philippe » du rédacteur adjoint de Valeurs Actuelles Tugdual Denis, l’ancien Premier ministre livre quelques remarques sur l’Eglise catholique actuelle… dont certaines sont plutôt déroutantes. Lu sur le site web de l’hebdomadaire « Famille chrétienne » :
« Édouard Philippe ne croit pas en Dieu. Il l’a écrit, répété », démine dès le début Tugdual Denis dans l’un des chapitres de son nouveau livre : « La vérité sur Edouard Philippe », paru ce mercredi 9 septembre. Dressant un portrait de l’ex Premier ministre sous toutes ses coutures au fil d’innombrables échanges avec lui et son entourage, le directeur adjoint de Valeurs Actuelles ne fait pas l’impasse de la relation d’Edouard Philippe avec les « choses d’en Haut »… et plus précisément avec l’Eglise catholique.
« J’aime aller dans les églises »
Partant de son absence de foi en Dieu, « qu’est ce qui le dépasse ? » s’interroge Tugdual Denis au sujet d’Edouard Philippe. « Plein de choses, répond ce dernier. Dans le coeur de l’humanité, je crois qu’il y a une notion d’absolu et d’éternité. C’est pour ça que j’aime aller dans les églises. C’est pour cela que j’aime le sacré. Mon principe d’explication n’est pas divin. Je ne crois pas en Dieu – ça viendra peut-être –, mais je crois au sacré. Je crois même au fait que ce soit l’homme qui ait créé Dieu, puisque le sacré existe depuis le début de l’humanité. Ce qui ne signifie aucunement de l’irrespect. »
Et le maire du Havre à la barbe grisonnante de poursuivre : « Je ne suis pas mal à l’aise à la messe. Quand j’y suis, à la traditionnelle cérémonie de la Mer au Havre, ou aux enterrements, ou aux mariages, j’essaie d’écouter ce qu’on me dit. Certains curés sont passionnants […] D’autres sermons n’ont aucun intérêt. D’une manière générale, moi, durant les messes, je pense aux morts. Et parfois à la mienne : la seule chose qui m’angoisse, ce serait de mourir après mes enfants. »
À lire aussi
« L'Église est trop exigeante ! » Et si c'était pour notre bien ?
Edouard Philippe défenseur de la messe « tradi » ?
Décidé à titiller davantage Edouard Philippe sur son rapport avec les catholiques, Tugdual Denis raconte : « Initialement, j’avais noté chez lui quelques remarques faciles sur la nullité de l’Église catholique et son rigorisme. J’ai compris après qu’on a connu dans son univers familial élargi des comportements déviants de prêtres. Et que cela avait été mal géré par la hiérarchie ecclésiastique. Sans savoir cela, je lui ai fait remarquer que je le trouvais anticlérical. ‘’Moi ? Anticlérical ? Au Havre, j’ai des relations très respectueuses avec l’évêque ! Je ne suis pas du tout anticlérical, mais je ne suis pas béat d’admiration devant ce que le clergé a fait de l’Église catholique. Le niveau du clergé français a globalement baissé, je trouve.’’ »
Une dernière remarque d’Edouard Philippe en surprendra sans doute plus d’un. Tugdual Denis lui-même fait part de sa surprise dans son récit : « Mon frère, prêtre portant la soutane et célébrant ses messes en latin, serait comblé d’aise en entendant la suite, inattendue : ‘’Je trouve qu’il y a depuis quelques années une forme de désinvolture liturgique. Qui me choque. La guitare à la messe, je n’ai jamais compris. Pour moi le sacré est soit très sobre, tel le dénuement que l’on retrouve dans les monastères, soit très pompeux.’’ » Dès lors on a presque envie de lire la réponse à cette question : comment Edouard Philippe a-t-il perçu le récent Motu Proprio du Pape François restreignant l’usage de la messe tridentine, souvent considérée comme plus solennelle ? Les échanges de l’auteur avec l’ex Premier ministre s’étant échelonnés entre l’automne 2020 et la fin du printemps 2021, inutile de chercher entre les lignes une allusion à cet événement…
À lire aussi
Le pape François restreint fortement l'usage de la messe tridentine
Ref. France : les confidences inattendues d'Edouard Philippe sur l'Eglise
Inutile, en effet, de chercher entre les lignes une allusion au motu proprio « Traditionis custodes » : mais les considérations émises par l’ancien premier ministre laissent deviner ce qu’eût été sa réponse si l’interview avait eu lieu quelques mois plus tard : comme celle de Michel Onfray. Décidément les « périphéries » des uns ne sont pas celles des autres…
JPSC
 La guerre des deux messes romaines va-t-elle bientôt se concrétiser dans les faits? Le pape régnant l’a déclarée sans merci. Les mouvements traditionalistes peuvent difficilement souscrire à leur asphyxie ouvertement programmée par le pontife romain. Les ou des évêques ont-ils vraiment la détermination de jouer les médiateurs pour négocier la révision des articles les plus contestables du motu proprio papal ? Chacun s’observe. À chacun son Rubicon. L’ennui c’est que César a déjà franchi le sien. Un article de Maximilien Bernard publié sur le site web « riposte catholique », ce dimanche 5 septembre 2021, témoigne de la situation inflammable qui couve pour l’instant:
La guerre des deux messes romaines va-t-elle bientôt se concrétiser dans les faits? Le pape régnant l’a déclarée sans merci. Les mouvements traditionalistes peuvent difficilement souscrire à leur asphyxie ouvertement programmée par le pontife romain. Les ou des évêques ont-ils vraiment la détermination de jouer les médiateurs pour négocier la révision des articles les plus contestables du motu proprio papal ? Chacun s’observe. À chacun son Rubicon. L’ennui c’est que César a déjà franchi le sien. Un article de Maximilien Bernard publié sur le site web « riposte catholique », ce dimanche 5 septembre 2021, témoigne de la situation inflammable qui couve pour l’instant:



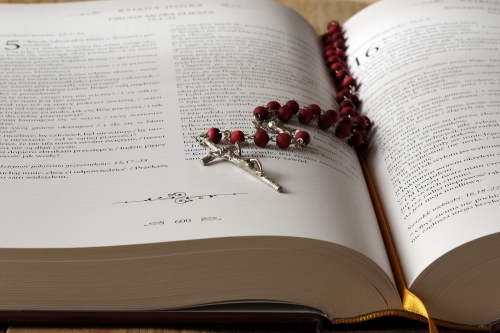
 Soumis depuis des mois à une jauge de 15 puis 200 personnes fin juin dans les églises et un espacement de 1,5 m entre chaque fidèle, les catholiques belges seront délivrés de ces restrictions sanitaires anti-covid19 à partir du 1er septembre. Pour les messes à Bruxelles, les règles ne sont pas assouplies. Un commentaire de l’hebdomadaire français « Famille chrétienne » signé Camille Lecuit :
Soumis depuis des mois à une jauge de 15 puis 200 personnes fin juin dans les églises et un espacement de 1,5 m entre chaque fidèle, les catholiques belges seront délivrés de ces restrictions sanitaires anti-covid19 à partir du 1er septembre. Pour les messes à Bruxelles, les règles ne sont pas assouplies. Un commentaire de l’hebdomadaire français « Famille chrétienne » signé Camille Lecuit :