La théorie du genre s'immisce à l'école
Source : Le Figaro.fr, Marie-Estelle Pech, Caroline Beyer
Le principal syndicat du primaire propose des «outils» pour parler des «nouvelles familles».
«Est-il nécessaire d'apprendre à nos enfants à aimer les travestis?», peut-on lire en boucle sur les réseaux sociaux. L'information bruisse sur les blogs des sympathisants de la Manif pour tous depuis quelques jours. Le livre Papa porte une robe ferait son entrée dans les salles de classe de l'école primaire. La polémique enfle à la suite d'un colloque du Snuipp, principal syndicat enseignant du premier degré, autour du thème «Éduquer contre l'homophobie dès l'école primaire». À l'occasion de cet événement organisé le 16 mai, jour de lutte contre l'homophobie, le syndicat a «mis à disposition» des professeurs des «outils théoriques et pratiques pour avancer». Libre à eux de s'en inspirer ou non. Le rapport de 192 pages déroule de nombreux chapitres, comme «Le genre, ennemi principal de l'égalité» ou «Déconstruire la complémentarité des sexes» et propose une vingtaine de «préparations pédagogiques» et ouvrages «de référence» - dont le fameux livre. «La littérature jeunesse est un support pertinent pour aborder toutes les questions sensibles», affirme Sébastien Sihr, secrétaire général du syndicat, avant de préciser qu'il s'agit de «suggestions» sans lien avec les programmes scolaires. «Le livre Papa porte une robe permet d'aborder les questions de sexisme et d'homophobie, qui sont liées», poursuit-il.
 Sommaire
Sommaire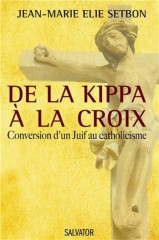 De la kippa à la croix
De la kippa à la croix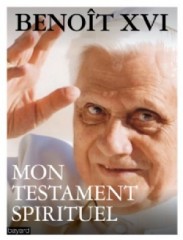 Mon testament spirituel
Mon testament spirituel
 ÉDITORIAUX
ÉDITORIAUX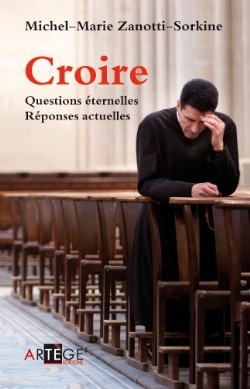 Croire
Croire