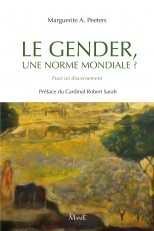Communiqué de presse
(Voir le dossier de presse ICI)
www.lapetitejulienne.be
Lancement d’un site catho interactif pour les enfants
Liège, Belgique. Ce jeudi 28 mars 2013, le site internet lapetitejulienne.be a été mis en ligne.
Ce site agréable, joyeux et ludique permettra aux enfants et à leurs parents de se familiariser avec la vie de la petite Julienne, dite Julienne de Cornillon, l’une des plus grandes figures féminines liégeoises. Son intuition autour du Mystère eucharistique a connu un important rayonnement international du Moyen Age à nos jours, ce qui se traduit encore actuellement par un jour férié, la Fête-Dieu, dans certains pays, dont l’Allemagne.
Symboliquement, la mise en ligne a lieu ce jeudi Saint, jour où l’Eglise entre dans le grand week-end Pascal en se rappelant en particulier l’institution de l’Eucharistie : « vous ferez cela en mémoire de moi » (Lc 22,19).
Sur ce nouveau site, un dessin animé résume son enfance tandis que plusieurs jeux en ligne sont disponibles: memory, puzzle, labyrinthe, 7 différences, bricolages… En outre, les animateurs d’enfants ou catéchistes de préparation à la première communion puiseront également dans des idées d’animations ou de prières.

Une randonnée thématique familiale de 11 kilomètres est proposée en ligne à partir du lieu de naissance de Julienne: Retinne, où prend cours le petit ruisseau qui porte son prénom. Il creuse une verdoyante vallée, agrémentée de 1.001 curiosités et aboutit dans le domaine récréatif des étangs de la Julienne à Visé-Argenteau au Nord de Liège.
Jacques Galloy s’est exprimé : « Nous espérons que le site « la petite Julienne » amusera les enfants et leur témoignera de la joie d’être chrétien. Le dessin animé, les bricolages, les jeux en ligne et la randonnée thématique seront également appréciés des adultes. »
Anne Junker a dit : « Julienne m’a montré l’exemple d’une vie simple et belle à travers la foi et l’amour. J’espère que nous arriverons à transmettre cela à travers le site.»
Ce site internet, illustré par Anne Junker et développé par l’agence web Synchrone sur base des dernières technologies web permettant une navigation verticale dynamique. Il fait écho au succès rencontré par le livre illustré pour les enfants publié en juin 2012. Il va être publié en allemand et en slovène dès l’été 2013.
La mise en ligne du site s’est faite en présence des auteurs et de Mgr Jousten, évêque de Liège, au « 42 », pub dominicain au cœur de Liège, Place Xavier-Neujean, 42, 4000 Liège, à l’ombre de l’église Saint Jean où déjà vers 1240, les dominicains encourageaient Julienne à aller au bout de son intuition.
Contacts :
Jacques GALLOY, auteur, +32 (497) 44 67 36, jacques@galloy.be
Anne JUNKER, illustratrice et infographiste, +32 (498) 41 43 22 junkeranne@gmail.com
Luc MATHUES, communication, +32 (492) 82 83 36, juliennedecornillon@gmail.com
SYNCHRONE, agence web, Olivier Malchair, +32 (43) 44 00 03 info@synchrone.be
A propos des auteurs :
Jacques Galloy est marié et père de 5 enfants. Ingénieur commercial, il est directeur financier d’un groupe de haute technologie et responsable des Jeunes de l’Emmanuel en Belgique.
Anne Junker est infographiste et illustratrice, diplômée de l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc et d’un master d’illustration à l’académie des Beaux-Arts de Liège : anneblog.illustrateur.org
© Editions Gallocam - Chemin de la Julienne 35, 4671 Saive
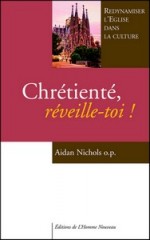 Le Père Aidan Nichols, dominicain, est l'un des plus brillants théologiens britanniques actuels. Il est l'auteur prolifique d'une quarantaine de livres sur des sujets très variés, dont la pensée de Joseph Ratzinger. La publication deChristendom Awake a fait grand bruit dans le monde anglo-saxon, car ce livre programme invite l'Eglise à redynamiser toute la culture contemporaine, de l'architecture à la famille, de la philosophie à la spiritualité, ou de l'art à la politique. La sortie de son édition française était attendue. Les titres des chapitres sont autant d'appels à retrouver sa capacité de transformation et de renouvellement de toutes les activités humaines : réassocier foi et culture, réenchanter la liturgie, reconstituer une société de foyers, resacraliser la culture matérielle, repenser le féminisme, reconcevoir l'oecuménisme, reconquérir la Bible, recréer la vie religieuse, sauver les Saints Innocents, réimaginer l'Etat de chrétienté etc. C'est dans un dialogue permanent avec la culture contemporaine (y compris dans de ce qu'elle peut avoir de contestable) que le Père Aidan Nichols repense à frais nouveaux une nouvelle évangélisation intégrale (mais non intégriste). La « chrétienté » qu'il appelle de ses voeux n'est pas un rêve nostalgique d'un état historique disparu, mais une société qui prend au sérieux la Résurrection du Christ. (via "Chrétiens dans la Cité")
Le Père Aidan Nichols, dominicain, est l'un des plus brillants théologiens britanniques actuels. Il est l'auteur prolifique d'une quarantaine de livres sur des sujets très variés, dont la pensée de Joseph Ratzinger. La publication deChristendom Awake a fait grand bruit dans le monde anglo-saxon, car ce livre programme invite l'Eglise à redynamiser toute la culture contemporaine, de l'architecture à la famille, de la philosophie à la spiritualité, ou de l'art à la politique. La sortie de son édition française était attendue. Les titres des chapitres sont autant d'appels à retrouver sa capacité de transformation et de renouvellement de toutes les activités humaines : réassocier foi et culture, réenchanter la liturgie, reconstituer une société de foyers, resacraliser la culture matérielle, repenser le féminisme, reconcevoir l'oecuménisme, reconquérir la Bible, recréer la vie religieuse, sauver les Saints Innocents, réimaginer l'Etat de chrétienté etc. C'est dans un dialogue permanent avec la culture contemporaine (y compris dans de ce qu'elle peut avoir de contestable) que le Père Aidan Nichols repense à frais nouveaux une nouvelle évangélisation intégrale (mais non intégriste). La « chrétienté » qu'il appelle de ses voeux n'est pas un rêve nostalgique d'un état historique disparu, mais une société qui prend au sérieux la Résurrection du Christ. (via "Chrétiens dans la Cité")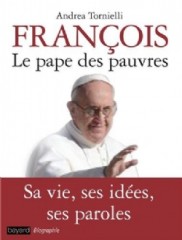 « François, répare ma maison ! » : c'est l'appel que Dieu adresse à François d'Assise dans les Fioretti. De la même manière, le cardinal Jorge Mario Bergoglio a reçu ce message lors de son élection en mars dernier. Cet ouvrage montre, à travers les textes, les idées, les mots du pape François, comment ce fils d'immigrés, à la fois simple et érudit, fait de l'exigence évangélique et de la non-violence, les piliers de sa pastorale. Une biographie complète, qui donne les clefs pour comprendre cette personnalité plus complexe qu'il n y paraît et révèle un pasteur qui incarne le renouvellement et la « purification » de l'Église.
« François, répare ma maison ! » : c'est l'appel que Dieu adresse à François d'Assise dans les Fioretti. De la même manière, le cardinal Jorge Mario Bergoglio a reçu ce message lors de son élection en mars dernier. Cet ouvrage montre, à travers les textes, les idées, les mots du pape François, comment ce fils d'immigrés, à la fois simple et érudit, fait de l'exigence évangélique et de la non-violence, les piliers de sa pastorale. Une biographie complète, qui donne les clefs pour comprendre cette personnalité plus complexe qu'il n y paraît et révèle un pasteur qui incarne le renouvellement et la « purification » de l'Église. 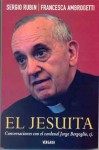 Ne faites pas attention à ce titre, Je crois en l'homme, sous lequel a été traduit en français le livre d'entretien donné en 2010 par le cardinal Bergoglio archevêque de Buenos aires. Le titre originel, argentin, est Le Jésuite. Cette phrase - je crois en l'homme - ne se trouve dans le livre que sur les lèvres des interviewers (p. 191), et elle n'est pas reprise par l'archevêque lui-même. Que dit-il, quand on lui représente qu'"il est parfois difficile de croire en l'homme" ? "L'histoire semble une calamité, un désastre moral, un chaos de possibilités holistiques". Non pas : je crois en l'homme, mais quelque chose de beaucoup plus prosaïque : "On dit des Chinois qu'ils sont comme des bouchons. Dans certaines circonstances ils s'enfoncent et dans d'autres ils réapparaissent.Je crois que c'est aussi applicable en général à la nature humaine".
Ne faites pas attention à ce titre, Je crois en l'homme, sous lequel a été traduit en français le livre d'entretien donné en 2010 par le cardinal Bergoglio archevêque de Buenos aires. Le titre originel, argentin, est Le Jésuite. Cette phrase - je crois en l'homme - ne se trouve dans le livre que sur les lèvres des interviewers (p. 191), et elle n'est pas reprise par l'archevêque lui-même. Que dit-il, quand on lui représente qu'"il est parfois difficile de croire en l'homme" ? "L'histoire semble une calamité, un désastre moral, un chaos de possibilités holistiques". Non pas : je crois en l'homme, mais quelque chose de beaucoup plus prosaïque : "On dit des Chinois qu'ils sont comme des bouchons. Dans certaines circonstances ils s'enfoncent et dans d'autres ils réapparaissent.Je crois que c'est aussi applicable en général à la nature humaine".
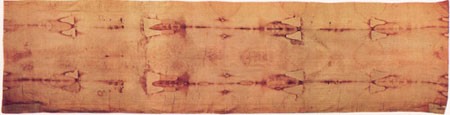
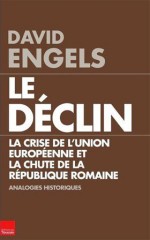 C'est Joseph Savès,
C'est Joseph Savès,