Des propos recueillis par Emilie Pourbaix sur France Catholique :
L’idéologie woke, néo-marxisme culturel : une menace pour l’Église ?
mercredi 9 février 2022
Le courant intitulé woke, nouveau progressisme venu des États-Unis, s’étend dans les médias, la politique et la société. Chimère pour les uns, il est en fait devenu un adversaire redoutable pour l’Église. Entretien avec le Père Joël Guibert, auteur de Le secret de la sérénité (Artège).
D’où vient le wokisme ?
Père Joël Guibert : Le courant woke est une nouvelle « lutte des classes », un néo-marxisme, qui a seulement changé de costume : de « marxisme économique », il a muté en un « marxisme culturel », au sein des démocraties libérales. Le marxisme est devenu le wokisme.
En effet, woke signifie « éveillé ». Est donc woke celui qui est éveillé, c’est-à-dire qui a ouvert les yeux sur les injustices et « l’oppression systémique » dont seraient victimes certaines minorités : les femmes, les minorités sexuelles, les anciens colonisés, les migrants, les obèses, et même les animaux ou la nature.
Ce n’est plus la précarité économique qui sert de grille de lecture à cette nouvelle justice sociale, mais l’appartenance à une minorité. Selon cette nouvelle justice sociétale, imprégnée de progressisme, les oppresseurs sont, en gros, les mâles blancs hétérosexuels et chrétiens, tandis que les opprimés sont les minorités ethniques, les femmes, les animaux, les minorités sexuelles et les minorités religieuses : l’islam bien évidemment, mais surtout pas le catholicisme !
Cette idéologie est une dictature soft et librement consentie par les masses, qui s’est développée aux États-Unis dans les années 1970 avec la French Theory, « théorie française », appelée ainsi à cause de l’influence d’un certain nombre de philosophes français (Foucault, Deleuze, Derrida…), grands promoteurs de la déconstruction de tous les secteurs de la vie sociale.
Est-ce en quelque sorte une contrefaçon laïque du christianisme ?
Le marxisme et le néo-marxisme woke actuel ne sont en effet rien d’autre que la sécularisation de l’espérance chrétienne en un monde meilleur. La foi en Dieu a été remplacée par la foi en l’homme, la Sagesse divine par la technique, la Sainte Écriture par la « sainte opinion ».
Lorsqu’une société ne repose plus sur des valeurs solides, elle finit toujours par s’effondrer de l’intérieur. Ne sommes-nous pas dans la même situation que celle de la Rome antique ? « Une démocratie sans valeurs, prévient l’encyclique Centesimus annus, se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l’histoire. […] en un monde sans vérité, la liberté perd sa consistance et l’homme est soumis à la violence des passions et à des conditionnements apparents ou occultes. »
En quoi cette idéologie bouleverse-t-elle la religion chrétienne ?
Lorsqu’on analyse de près les différents mouvements qui constituent la constellation woke, on arrive à cette conclusion invariable : tous remettent en cause les racines mêmes de l’anthropologie chrétienne, la loi naturelle, sa vision de la famille, de l’homme et de la femme et de l’unité du genre humain, que ce soit à travers l’antispécisme, le féminisme, l’écologisme, l’antiracisme, le gender.
La fameuse cancel culture – littéralement la « culture de l’annulation » – veut faire table rase de la culture et de la morale judéo-chrétienne, afin de mettre en place une culture pas seulement nouvelle mais très exactement une culture et une morale « inversées ».
L’Église est-elle menacée ?
Si nous sommes attentifs à ce qui se passe avec l’actuelle dictature soft de la pensée unique, nous remarquons que, bien que moins violente que la dictature soviétique, elle n’en est pas moins totalisante. Benoît XVI, ce pape au regard d’aigle, a très bien perçu la perversité qui se cache derrière cette subtile dictature civilisée et bien peignée : « N’importe quelle future dictature antichrétienne serait probablement plus subtile que toutes celles que nous avons connues jusqu’à maintenant. Elle se montrera amicale envers la religion, mais à condition que ses propres modèles de conduite et de pensée ne soient pas remis en question. »
L’idéologie woke a-t-elle pénétré à l’intérieur de l’Église ?
Oui, le wokisme ne sape pas seulement l’Église de l’extérieur, en promouvant des thèses totalement opposées à son enseignement. L’idéologie woke a commencé à pénétrer à l’intérieur de l’Église.
Retrouvez l’intégralité de l’entretien et de notre Grand Angle dans France Catholique.
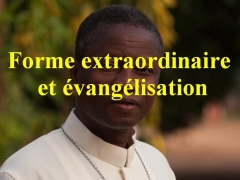 « Comme je l’évoquais dans la Vie Diocésaine du mois d’août 2021, le Pape François a publié un document intitulé "Traditionis Custodes", le 16 juillet 2021. Il y aborde la question des formes liturgiques. En peu de mots, il limite les possibilités de la célébration de la messe selon le missel ancien dit "de saint Pie V". Mais il ne l’abroge pas comme certains parmi nous le pensent et le clament tout haut.
« Comme je l’évoquais dans la Vie Diocésaine du mois d’août 2021, le Pape François a publié un document intitulé "Traditionis Custodes", le 16 juillet 2021. Il y aborde la question des formes liturgiques. En peu de mots, il limite les possibilités de la célébration de la messe selon le missel ancien dit "de saint Pie V". Mais il ne l’abroge pas comme certains parmi nous le pensent et le clament tout haut.

