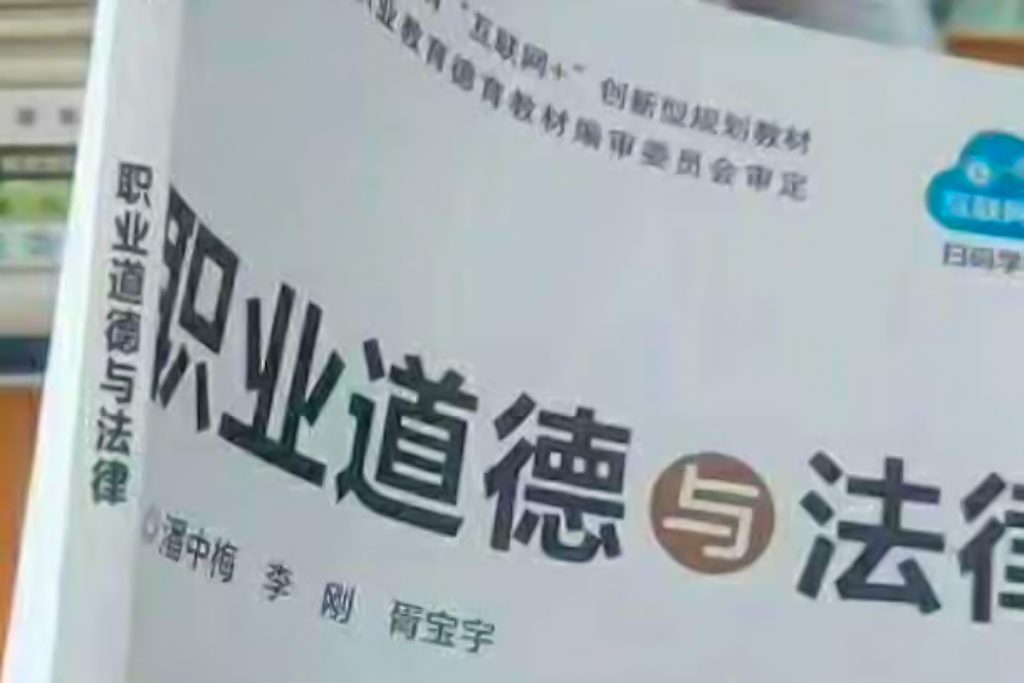FOYER DE CHARITE, PÈRE FINET
Les anciennes élèves portent plainte contre X
Le 7 mai 2020, un communiqué de presse diffusé par les Foyers de Charité condamnait « sans réserve » des « agissements gravement déviants » attribués à l’abbé Georges Finet (1898-1990), père cofondateur avec Marthe Robin, d’une œuvre au rayonnement international : les Foyers de Charité (78 foyers, présents dans 44 pays sur 4 continents).
La condamnation publique du père Finet, résulte uniquement des conclusions que la gouvernance des Foyers de Charité tire, elle-même, du rapport d’une « Commission de recherches indépendante » nommée par elle-même, alors même qu’il s’est agi d’une simple « écoute de personnes » selon les propres termes du Père Modérateur des Foyers de Charité, Moïse Ndione.
Cette « écoute de personnes » aurait dû aboutir à l’ouverture d’une enquête et non à une condamnation.
Nous, anciennes élèves de Châteauneuf-de-Galaure rassemblées en « Collectif des Anciennes » (154 membres) soutenues par d’anciens élèves de Saint-Bonnet et amis des Foyers, rassemblés en « Amis du Collectif » (83 membres) ne comprenons pas comment de simples « écoutes », il a pu être tiré une condamnation ; comment la culpabilité du Père Georges Finet a pu être largement diffusée à la presse française et internationale comme un fait incontestable sans qu’il n’y ait eu ni accusation, ni plainte ni enquête ; comment les médias ont pu accuser le père Finet d’« abus sexuels » et de « pédophilie » alors qu’aucun des termes « accusation », « enquête », « plainte », « attouchement », « agression sexuelle », ou « abus sexuel » ne soit employé dans la synthèse du rapport, rédigées par la gouvernance des Foyers de Charité, synthèse par laquelle on apprend d’une part que les témoignages avaient été appelés et d’autre part que la Commission de recherches avait précisé « Il ne nous appartient pas de qualifier juridiquement les actes repérés, ce qui incomberait à un tribunal ».
Nous nous interrogeons et sur cette condamnation publique de portée internationale, faite sans légitimité, ni autorité, et sur les responsables de cette manipulation calomnieuse et diffamante pour le père Finet.
Si le travail de la Commission de recherches était simplement celui d’« une écoute de personnes qui avaient quelque chose d’important à dire », comme l’a affirmé le père modérateur, pourquoi ce mystère autour de ses membres ? Pourquoi aucune précision factuelle n’a été apportée, quant à son mode de procédé ?
Pourquoi une responsable des Foyers de Charité a-t-elle appelé nos témoignages par un email personnel avec la volonté affichée d’« établir la vérité » (« Établir la vérité est un devoir », disait le Père Modérateur), sans en prendre les moyens ? Pourquoi cette conclusion, hâtive, hors de toute juridiction, mais présentée comme une étape décisive dans le processus de réforme des Foyers de charité et diffusée via une stratégie et un plan de communication internationale (communiqué de presse en trois langues) ?