Du site de l'ECLJ (European Center for Law & Justice) :
Nouvelle étude de fond : « Liberté éducative et droits de l’homme »
L'ECLJ a le plaisir de vous présenter une nouvelle étude de fond : « Liberté éducative et droits de l’homme », accessible librement ici.
Elle a été rédigée pour servir à toute personne désireuse de comprendre et de défendre les droits des parents face à l’État, en particulier en matière d’éducation et d’instruction de leurs enfants.
Cette étude présente l’origine et l’interprétation du « droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions » garanti en droit européen et international. La lecture des discussions des rédacteurs de la Déclaration universelle et de la Convention européenne des droits de l’homme est particulièrement éclairante quant à leur intention initiale. Elle révèle comment les « pères fondateurs » de ces grands textes, au sortir de la guerre, ont voulu protéger les familles de l’emprise idéologique des États. Pour eux, le respect des « libertés familiales » est la condition à toute société juste et proprement libérale, et la meilleure protection contre la dérive totalitaire du pouvoir politique.
La seconde partie de cette étude porte sur l’interprétation et la portée qui ont été données à ce droit par la Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant en particulier de l’instruction en famille. Elle montre comment le « pluralisme éducatif » est jugé « essentiel pour la préservation d’une société démocratique » et pour le respect des libertés familiales. Cette étude démontre aussi « l’effet cliquet » de la CEDH, suivant lequel un État ne peut abroger un droit ou une liberté qu’il a librement reconnus dès lors qu’ils entrent dans le champ de la Convention, alors même que celle-ci ne contient pas l’obligation explicite de les reconnaître.
Il en résulte que si la France n’était certes pas obligée de légaliser l’instruction à domicile, une fois cette liberté accordée le Gouvernement ne peut plus l’abroger de façon générale et absolue, ou arbitraire.
Enfin, une annexe présente une sélection de citations édifiantes des rédacteurs du « droit des parents » ; les références pertinentes de droit international ; ainsi que le droit en vigueur au sein des autres États membres du Conseil de l’Europe.
Il ressort de cette étude que la suppression de la liberté de l’instruction à domicile serait une régression grave de la liberté, contraire à l’intention de la plupart des rédacteurs de la Déclaration universelle et de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle serait aussi contraire au choix opéré par la majorité des États européens.




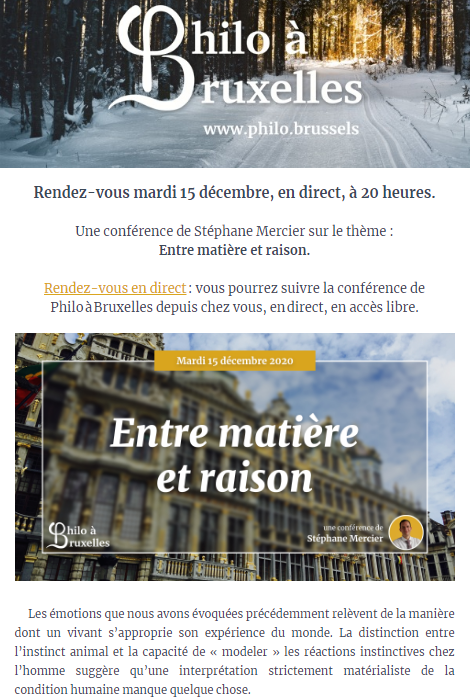
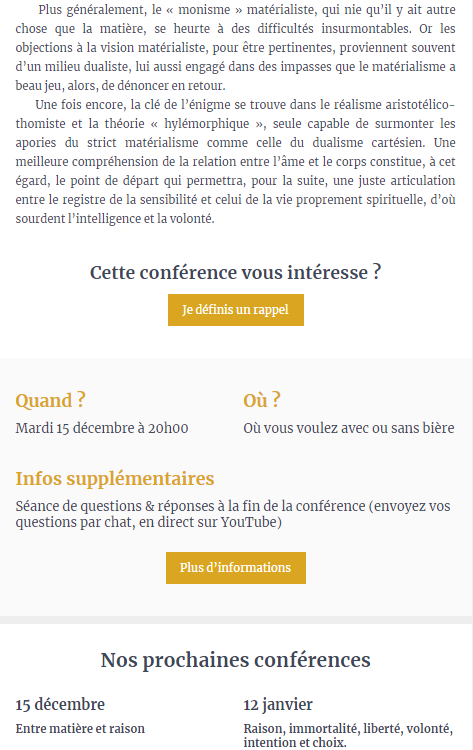
 Les chants de la messe d’aujourd’hui, deuxième dimanche de l’Avent, sont entièrement consacrés à Jérusalem : « Peuple de Sion, le Seigneur va venir pour sauver les Gentils. Le Seigneur fait entendre sa voix pour la joie de votre cœur (Intr.). « De Sion resplendit l’éclat de Sa gloire : Dieu va venir, d’une manière visible. Rassemblez autour de lui ses saints qui ont conclu avec lui l’alliance du sacrifice » (Grad.). « Jérusalem lève-toi et monte à l’observatoire et vois la douceur qui va te venir de ton Dieu » (Comm.). Sion, ville de notre force, le Sauveur est en toi comme un mur et un avant-mur : ouvre largement tes portes car Dieu est avec nous, Alléluia » (Ant. laudes).
Les chants de la messe d’aujourd’hui, deuxième dimanche de l’Avent, sont entièrement consacrés à Jérusalem : « Peuple de Sion, le Seigneur va venir pour sauver les Gentils. Le Seigneur fait entendre sa voix pour la joie de votre cœur (Intr.). « De Sion resplendit l’éclat de Sa gloire : Dieu va venir, d’une manière visible. Rassemblez autour de lui ses saints qui ont conclu avec lui l’alliance du sacrifice » (Grad.). « Jérusalem lève-toi et monte à l’observatoire et vois la douceur qui va te venir de ton Dieu » (Comm.). Sion, ville de notre force, le Sauveur est en toi comme un mur et un avant-mur : ouvre largement tes portes car Dieu est avec nous, Alléluia » (Ant. laudes).
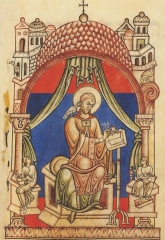 Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.
Grégoire Ier, dit le Grand, est le 64e pape de l'Église catholique. Il est l'auteur d'œuvres patristiques majeures qui ont marqué et marquent toujours l'histoire de l'Église. Né vers 540, il est élu pape en 590 et décède le 12 mars 604.