Une dépêche de l'Agence Fides :
ASIE/PAKISTAN - Mécontentement des chrétiens après la déclaration du caractère obligatoire de l’instruction coranique dans les Universités du Pendjab
Lahore (Agence Fides) – « Je demande au gouverneur du Pendjab, Chaudhry Sarwar, de revenir sur cette décision et de travailler en vue d'une instruction inclusive, ayant réellement de la valeur, qui promeuve les droits fondamentaux et puisse être proposée aux étudiants de toutes les religions au sein de nos institutions éducatives ». C'est ce qu'affirme le Père Abid Habib OFM Cap, 64 ans, dans un message envoyé à l'Agence Fides après que le gouvernement de la province pakistanaise du Pendjab ait rendu obligatoire l'enseignement du coran pour l'ensemble des étudiants sur le territoire de la province. Le religieux exprime son désaccord envers la mesure prise qui a provoqué une vaste désapprobation au sein des communautés religieuses minoritaires – en particulier les chrétiens et les hindous – ainsi que dans différentes organisations et plateformes de la société civile pakistanaise et du monde universitaire.
S'adressant ces jours derniers aux Vice-chanceliers des Universités de la province du Pendjab, le gouverneur, Chaudhry Sarwar, a déclaré : « La décision historique d'enseigner le coran, avec sa traduction en langue urdu, a été prise. Il s'agira d'une matière obligatoire dans toutes les Universités du Pendjab et aucun diplôme universitaire de deuxième degré ne sera assigné sans qu'elle ait été étudiée. Nous promouvrons une révision de la Constitution afin de rendre obligatoire l'enseignement du saint coran ».
La notification émise par le Secrétariat du gouverneur du Pendjab affirme : « Un étudiant ne pourra obtenir de diplôme de deuxième degré de l'enseignement supérieur s'il n'étudie pas le sacré coran avec la traduction », continuant : « Dans toutes les Universités du Pendjab, la matière d'enseignement du sacré coran sera enseignée séparément du thème de l'slamiat (enseignements relatifs à la religion islamique NDR) déjà prévu dans l'ensemble des Universités ».
Le Père Abid Habib, par ailleurs ancien Directeur de la Commission Justice et Paix de la Conférence des Supérieurs majeurs du Pakistan, relève : « Premièrement, il faut rappelé qu'il n'était pas dans les intentions du fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, de faire de ce pays un Etat théocratique. Dans son discours constitutionnel du 11 août 1947, il expliqua que la religion n'aurait rien eu à faire avec les affaires de l'Etat. Cependant, après sa mort, on a commencé à porter l'islam à l'intérieur des affaires de l'Etat ».
Le religieux poursuit : « Au cours de ces 72 dernières années, en de nombreuses occasions, les politiques des gouvernements ont porté des bénéfices aux seuls musulmans alors que les non musulmans subissent des discriminations en tous lieux. Les musulmans lisent le coran depuis leur enfance. Je ne vois pas pourquoi les autres étudiants devraient également être obligés de le faire. Ce dont cette génération a véritablement besoin est une éducation aux valeurs, à la dignité de la personne et cette approche doit débuter dès l'école primaire. Nous assistons actuellement à la montée du fanatisme religieux et de l'intolérance et des mesures comme celle-ci continuent à alimenter ces phénomènes. Ce n'est que si est offerte l'éducation aux authentiques droits fondamentaux que les nouvelles générations apprendront à apprécier et à respecter toutes les fois ».
La majeure partie des chrétiens pakistanais est d'ethnie penjâbi, et ils sont par suite nombreux en province du Pendjab, en particulier dans la ville de Lahore, où ils représentent 10% de la population totale. Au niveau national, sur plus de 210 millions d'habitants, le Pakistan compte quelques 4 millions de chrétiens, dont une moitié de catholiques, l'autre moitié appartenant à d'autres confessions. Le Pendjab compte à lui seul environ 80% des baptisés pakistanais. (AG-PA) (Agence Fides 19/06/2020)

 « Après plus d’une année à la tête de l’État, le président Félix Tshisekedi n’a rien démontré sur la manière dont il comptait remédier au manque de justice et au non-respect de l’obligation de rendre des comptes. Ces défaillances ont caractérisé les gouvernements précédents qu’il a longtemps critiqués lorsqu’il était dans l’opposition.
« Après plus d’une année à la tête de l’État, le président Félix Tshisekedi n’a rien démontré sur la manière dont il comptait remédier au manque de justice et au non-respect de l’obligation de rendre des comptes. Ces défaillances ont caractérisé les gouvernements précédents qu’il a longtemps critiqués lorsqu’il était dans l’opposition.

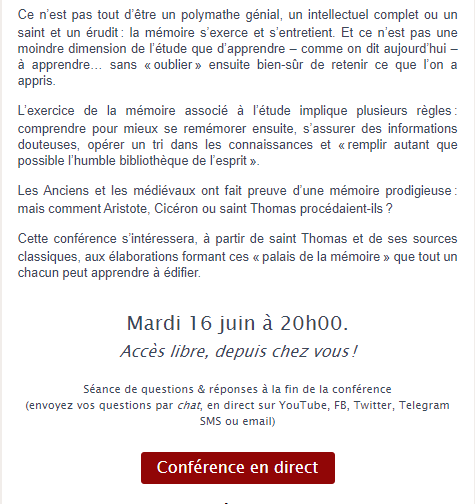


 « 29 mai 2020 ( LifeSiteNews ) - Mgr Georg Bätzing, Président de la Conférence épiscopale allemande, a insisté sur le fait que le rejet des femmes prêtres par les papes récents n'est pas concluant et qu'il doit y avoir plus de discussions «car la question est présente, au milieu de l'Église »!
« 29 mai 2020 ( LifeSiteNews ) - Mgr Georg Bätzing, Président de la Conférence épiscopale allemande, a insisté sur le fait que le rejet des femmes prêtres par les papes récents n'est pas concluant et qu'il doit y avoir plus de discussions «car la question est présente, au milieu de l'Église »!