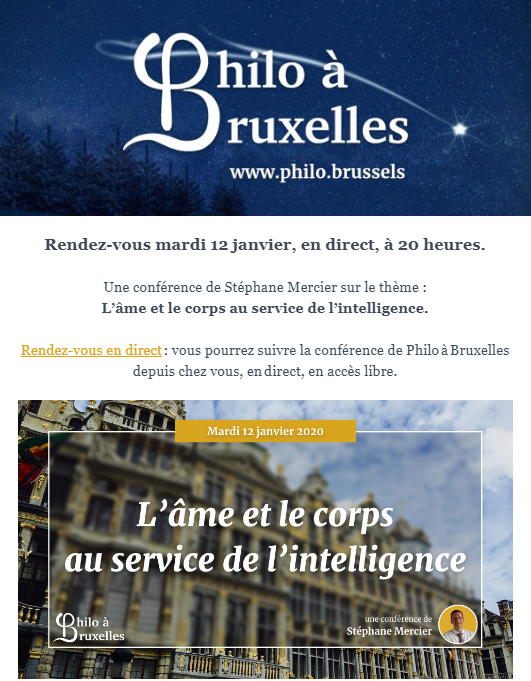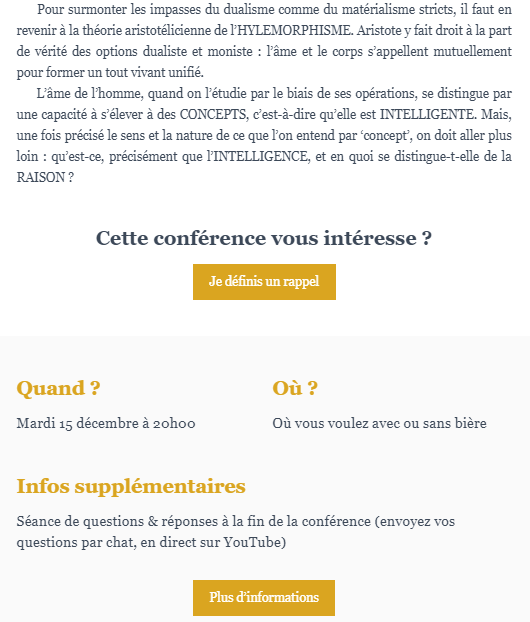Du Père Christian Venard (*) sur le site web « aleteia » :
« Une réappropriation de la mort comme fin de tout être humain permet à chacun de réévaluer le sens réel de sa vie.
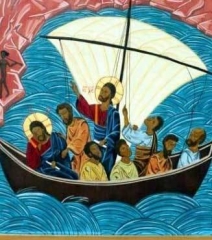 « Nous devrons tous mourir, mais avant, nous aimerions pouvoir vivre un peu ! » Telle est l’idée que l’on aimerait bien faire entendre à nombre de gouvernants occidentaux, qui peu à peu nous enferment dans un complexe réseau de règles sanitaires, donnant à nos cités l’allure d’un vaste camp de prisonniers. La première question posée est bien celle de notre rapport à la mort.
« Nous devrons tous mourir, mais avant, nous aimerions pouvoir vivre un peu ! » Telle est l’idée que l’on aimerait bien faire entendre à nombre de gouvernants occidentaux, qui peu à peu nous enferment dans un complexe réseau de règles sanitaires, donnant à nos cités l’allure d’un vaste camp de prisonniers. La première question posée est bien celle de notre rapport à la mort.
Cette évidence de notre fin avait eu tendance à disparaître de notre horizon. Les progrès médicaux et sociaux en ont été fort heureusement la cause, mais aussi une philosophie sécularisée, progressiste, matérialiste et athée. Même chez les militaires — dont c’est pourtant une donnée d’engagement essentielle —, il a fallu les morts d’Afghanistan pour remettre en perspective la question de la mort, qui avait été évacuée ! Tous nous devrons mourir. Sagesse antique, trop oubliée ou passée sous silence, dans l’étourdissement du « divertissement pascalien », favorisé par la multitude de nos écrans. Question essentielle qui nous arrive désormais en pleine figure, non seulement par la répétition anxiogène des messages officiels sur la Covid-19, mais aussi parce que, coincés par des règles sanitaires et sociales de plus en plus exigeantes, dans des espaces réduits de sociabilité, nous nous retrouvons face à nous-mêmes. L’explosion du mal-être psychique notée par tous les acteurs médicaux et paramédicaux en est un signe tangible.
La dignité du désir de vivre
Une réappropriation de la mort comme fin de l’être humain devient donc urgente. Elle permet à tout un chacun de repenser, de réévaluer, ses engagements, ses besoins, ses désirs, in fine, le sens réel de sa vie. Pour le chrétien, ce travail sur soi devrait être simplifié par la foi. Nous connaissons l’origine de la mort, peine due au péché de nos premiers parents, mais désormais transcendée par un Dieu-fait-homme qui l’ayant traversée a définitivement vaincue la mort sur la Croix par sa Résurrection. Seule l’acceptation de notre finitude, seul l’apprivoisement de cette vérité si simple au fond, peuvent nous permettre alors d’aborder le sens de notre vie aujourd’hui.
« Je veux vivre avant de mourir. » Ce surgissement des profondeurs de tout notre être, ce jaillissement d’énergie créatrice est essentiel. C’est bien lui que, dans un délire sécuritaire, mettent à mal toutes les dispositions de plus en plus liberticides, prises par nos responsables. Il y a pourtant là un droit fondamental de tout être humain : celui de vivre, et de vivre dignement. Est-ce encore une vie digne pour des enfants que de se retrouver dès leur plus jeune âge « en-masqué » ? Est-il digne d’empêcher toute une jeunesse, à l’heure de sa propre prise en main de la vie, de sortir, de se parler, de rire ensemble ? Est-il digne de vivre, bousculé dans des foules inquiètes pour trouver le temps entre deux horaires d’interdiction de faire les courses du quotidien ? Est-il digne encore de ne plus voir ses collègues de travail, autrement que par le truchement d’un écran ? Est-il digne enfin, d’achever sa vie, dans un Ehpad ou un hôpital, privé de tout contact de ses proches ou même de l’ultime consolation portée par un simple prêtre ?
Le virus de la peur
Mener une réflexion de fond, nécessiterait enfin que nos gouvernants et nos responsables écoutent d’autres voix que celles, crédibles dans leur domaine de compétence technique, des spécialistes médicaux : celle des philosophes, celles des artistes, celles des écrivains — et celles des religieux. Encore leur faudrait-il pour cela, un zeste d’humilité. Un reste d’humanité… Quand Churchill, au tout début de la Deuxième Guerre mondiale, perdu dans les batailles politiciennes, assommé par les nouvelles terribles en provenance du front, affaibli par les luttes intestines de son parti, reçut le conseil du roi d’aller écouter le peuple, c’est dans le métro londonien, dans l’écoute des simples braves gens du quotidien, qu’il alla puiser la force de la résistance. Et que l’on ne s’y trompe pas. Ce n’est pas contre un dictateur nazi (ou un Trump, ou un Erdogan, ou un Poutine…) que nous sommes en guerre cette fois-ci. Ni contre un virus d’ailleurs. Mais bien contre nos propres peurs, au premier rang desquelles : celle de la mort. Courage. Résistance. »
Ref. vivre dignement, sans avoir peur de la mort
(*) L'abbé Christian Venard est aumônier militaire depuis 1998. Il a accompagné les troupes françaises dans une dizaine d'opérations extérieures. Auteur de plusieurs livres dont Un prêtre à la guerre (Tallandier, 2015), il est aussi chroniqueur sur KTO et dans la revue Parole et Prière.
JPSC
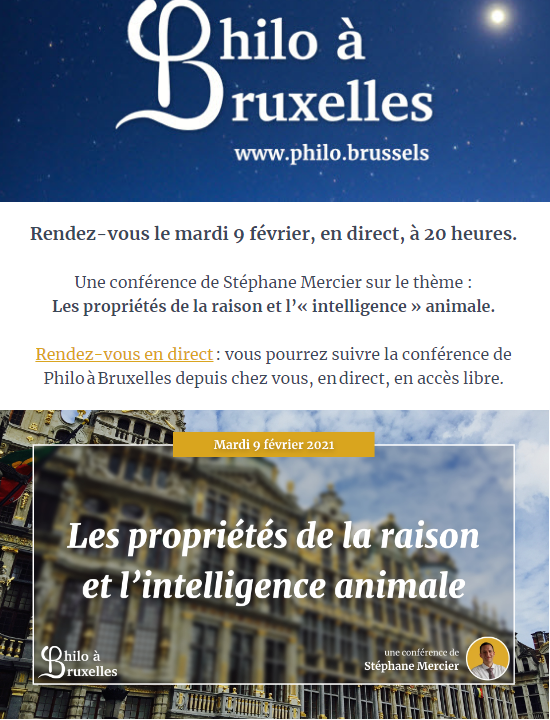
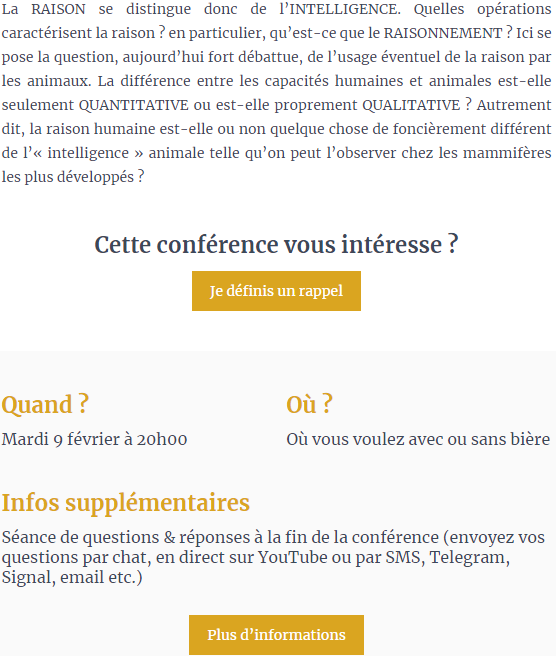
 Mgr Aillet, évêque de Bayonne depuis 2008, réagit en ouvrant en 2009 une classe de propédeutique et en septembre 2010 cinq étudiants entrent dans des locaux provisoires, puis il lance en 2011 le projet de l'Espace Cestac installé dans l'ancien couvent des capucins, au 50 avenue de la Légion tchèque. Cet espace réunit la bibliothèque diocésaine avec salles de conférences, riche d'un fonds ancien exceptionnel de 45.000 livres et 6.000 documents, et le séminaire proprement dit. Il y a déjà une vingtaine d'étudiants dès 2013-14. Les travaux débutent en septembre 2015. Les nouveaux locaux rénovés sont bénis par lui le 1er octobre 2016 en présence du maire de la ville, M. Jean-René Etchegaray et de diverses personnalités. Le séminaire est placé sous les vocables des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.
Mgr Aillet, évêque de Bayonne depuis 2008, réagit en ouvrant en 2009 une classe de propédeutique et en septembre 2010 cinq étudiants entrent dans des locaux provisoires, puis il lance en 2011 le projet de l'Espace Cestac installé dans l'ancien couvent des capucins, au 50 avenue de la Légion tchèque. Cet espace réunit la bibliothèque diocésaine avec salles de conférences, riche d'un fonds ancien exceptionnel de 45.000 livres et 6.000 documents, et le séminaire proprement dit. Il y a déjà une vingtaine d'étudiants dès 2013-14. Les travaux débutent en septembre 2015. Les nouveaux locaux rénovés sont bénis par lui le 1er octobre 2016 en présence du maire de la ville, M. Jean-René Etchegaray et de diverses personnalités. Le séminaire est placé sous les vocables des Saints Cœurs de Jésus et de Marie.
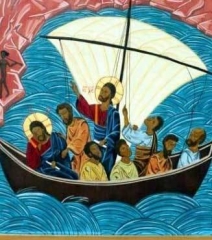 « Nous devrons tous mourir, mais avant, nous aimerions pouvoir vivre un peu ! » Telle est l’idée que l’on aimerait bien faire entendre à nombre de gouvernants occidentaux, qui peu à peu nous enferment dans un complexe réseau de règles sanitaires, donnant à nos cités l’allure d’un vaste camp de prisonniers. La première question posée est bien celle de notre rapport à la mort.
« Nous devrons tous mourir, mais avant, nous aimerions pouvoir vivre un peu ! » Telle est l’idée que l’on aimerait bien faire entendre à nombre de gouvernants occidentaux, qui peu à peu nous enferment dans un complexe réseau de règles sanitaires, donnant à nos cités l’allure d’un vaste camp de prisonniers. La première question posée est bien celle de notre rapport à la mort.



 « La Foi prise au mot » invite chacun à découvrir les richesses de la spiritualité du Moyen Âge et à apprécier certains moments de cette époque lumineuse, complexe et fort méconnue. Une époque dont la modernité frappe puisqu’elle invente tout à la fois l’idée des exercices spirituels, des méditations personnelles et aussi de la spiritualité des laïcs. Celle-ci n’est-elle pas réservée aux religieux ? Y-a-t-il une technique pour prier, méditer, contempler ? Quelle est la différence entre la spiritualité médiévale occidentale et la spiritualité orientale en vogue aujourd’hui ? Grâce au père Patrick Sicard et à l’historien Cédric Giraud, Régis Burnet propose ce soir de réfléchir sur la spiritualité à l’aide des écrivains mystiques qui l’ont inventée.
« La Foi prise au mot » invite chacun à découvrir les richesses de la spiritualité du Moyen Âge et à apprécier certains moments de cette époque lumineuse, complexe et fort méconnue. Une époque dont la modernité frappe puisqu’elle invente tout à la fois l’idée des exercices spirituels, des méditations personnelles et aussi de la spiritualité des laïcs. Celle-ci n’est-elle pas réservée aux religieux ? Y-a-t-il une technique pour prier, méditer, contempler ? Quelle est la différence entre la spiritualité médiévale occidentale et la spiritualité orientale en vogue aujourd’hui ? Grâce au père Patrick Sicard et à l’historien Cédric Giraud, Régis Burnet propose ce soir de réfléchir sur la spiritualité à l’aide des écrivains mystiques qui l’ont inventée.