 De Monseigneur Léonard interrogé par Drieu Godefridi, in « Un évêque dans le siècle » (éditions du CEP, septembre 2016) sur la question du mal et l’encyclique « Laudato si » (extraits) :
De Monseigneur Léonard interrogé par Drieu Godefridi, in « Un évêque dans le siècle » (éditions du CEP, septembre 2016) sur la question du mal et l’encyclique « Laudato si » (extraits) :
→ Dieu et l’univers (*)
Mgr Léonard : « […] C’est intelligent de croire en Dieu, c’est tout à fait raisonnable, même si c’est transrationnel d’adhérer à Jésus tel qu’il est présenté dans le Nouveau Testament. Mais, après tout cela, les gens sont confrontés à tout ce qui fonctionne, dans cette admirable mécanique de l’univers, de manière peu sympathique, de notre petit point de vue en tout cas. Et pour les chrétiens qui mettent leur foi en un Dieu qui, en principe, serait tout-puissant et qui serait un père bienveillant, comment est-ce qu’on met cela en rapport avec le mal qui défigure et abîme la vie des hommes sur la terre et avec tout ce qui ne tourne pas rond dans l’univers, y compris dans notre fonctionnement biologique ? »
→ Je me méfie des apologétiques qui justifient le mal
Mgr Léonard : « […] Je dénonce toujours avec force, y compris dans le monde chrétien, les justifications du mal, qui me paraissent souvent odieuses et qu’on ne devrait jamais employer en présence d’une personne qui souffre […] en disant, comme Spinoza par exemple […], c’est négatif de votre petit point de vue, parce que vous voyez la mort de votre enfant, de votre petit point de vue de mère. Mais, dans la totalité de la substance, qui nous apparaît dans les deux attributs de l’étendue et de la pensée, cela fait partie du positif. Tout est plein, positif dans la substance ! Votre mal, un peu comme dans le bouddhisme, est donc une illusion liée à la perspective que vous avez. De même, on peut dire, d’un point de vue biologique, que la mort des individus d’une espèce fait partie de l’économie du fonctionnement de la vie. Ne pleurez donc pas vos morts! Oui, cette attitude stoïcienne a une certaine dignité, elle a une grandeur, mais qui passe au-dessus du drame des personnes. Je suis devenu allergique aux pensées systématiques, hégéliennes, pour lesquelles, de manière très subtile, le mal est finalement positif. Je me méfie des aologétiques qui justifient le mal en disant : Dieu permet le mal en vue d’un plus grand bien, le mal fait partie d’un premier état pédagogique de la création. Dieu a fait volontairement une création inachevée pour que ce soit l’homme qui l’achève. C’est joli à dire, comme cela, quand on écrit à son bureau, mais cela n’arrange pas les gens qui sont frappés par la douleur.
Drieu Godefridi : Alors, que leur dites-vous par rapport à cette question du mal ?
→ ἐδάκρυσεν ó ἰησοῦς.
Mgr Léonard : « D’abord, Jésus est sensible au mal et ne fait jamais de raisonnements pour dire qu’il n’y a pas de mal. L’attitude de Jésus, dans l’Evangile de Jean, devant la tombe de Lazare c’est d’abord de pleurer : « Jésus pleura » (ἐδάκρυσεν ó ἰησοῦς). C’est le verset le plus court de toute la Bible. Ces pleurs sont pour moi plus éloquents que beaucoup de théories. Jésus n’a pas fait une théorie. Il dit bien que la mort de Lazare va servir à la manifestation de la gloire de Dieu. Mais il ne dit pas à Marthe et à Marie : non, ne pleurez pas, la mort de Lazare c’est pour un bien. Non, il pleure ! Ce que je trouve admirable chez lui, c’est qu’il n’a pas expliqué le mal comme tant de religions ou de philosophies l’ont fait. D’abord, il en a éprouvé la dureté. Puis il l’a porté. Cela, c’est quand même unique dans l’histoire religieuse de l’humanité, un Dieu qui non seulement se fait homme mais qui en outre endure l’absurdité de la mort, l’angoisse qui est liée à la mort. L’attitude de Jésus face à sa mort n’est pas du tout héroïque, ce n’est pas une attitude de héros, c’est l’attitude d’un homme qui est submergé par l’angoisse, par la tristesse et qui, pour la première fois dans les Evangiles, où il a toujours une maîtrise des événements, mendie un peu de secours, de réconfort de la part de ses disciples : veillez avec moi, priez avec moi – et ils dorment pendant ce temps-là ! Eh bien, cela me paraît plus crédible que Spinoza, cela me paraît plus humain que le stoïcisme : « Je savais que mon fils était mortel, donc je ne m’attriste pas de sa mort ». C’est grand, mais en même temps c’est mesquin, pourrait-on dire, d'une telle attitude : cela ne prend pas au sérieux le drame de la vie humaine. »
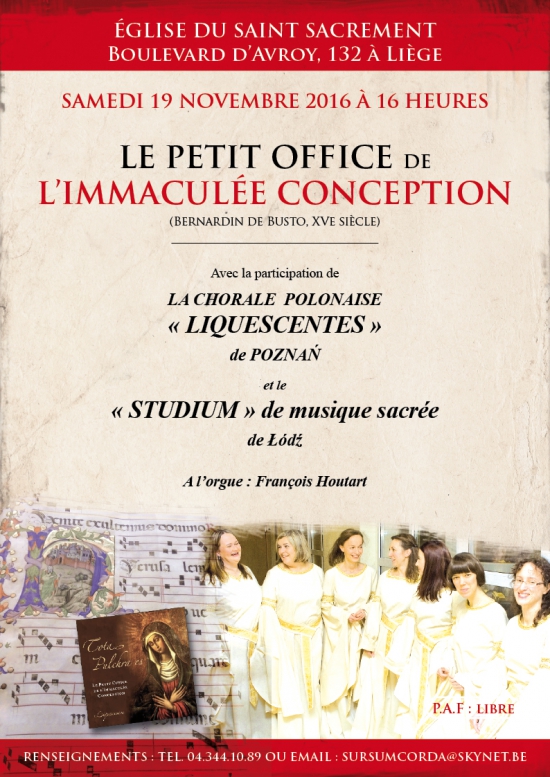
 « Je suis partisan d’une pastorale très chaleureuse et proactive à l’égard des personnes qui se sont remariées civilement après un divorce civil ou qui vivent en concubinage. L’Eglise doit chercher le contact avec ces personnes, comprendre ce qui s’est passé dans leur vie et les aider à assumer leur situation, en conjoignant, comme le fait un psaume, amour et vérité.
« Je suis partisan d’une pastorale très chaleureuse et proactive à l’égard des personnes qui se sont remariées civilement après un divorce civil ou qui vivent en concubinage. L’Eglise doit chercher le contact avec ces personnes, comprendre ce qui s’est passé dans leur vie et les aider à assumer leur situation, en conjoignant, comme le fait un psaume, amour et vérité.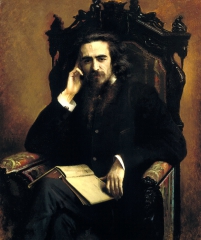 "Il n'y a que trois choses certaines attestées par la Parole de Dieu :
"Il n'y a que trois choses certaines attestées par la Parole de Dieu :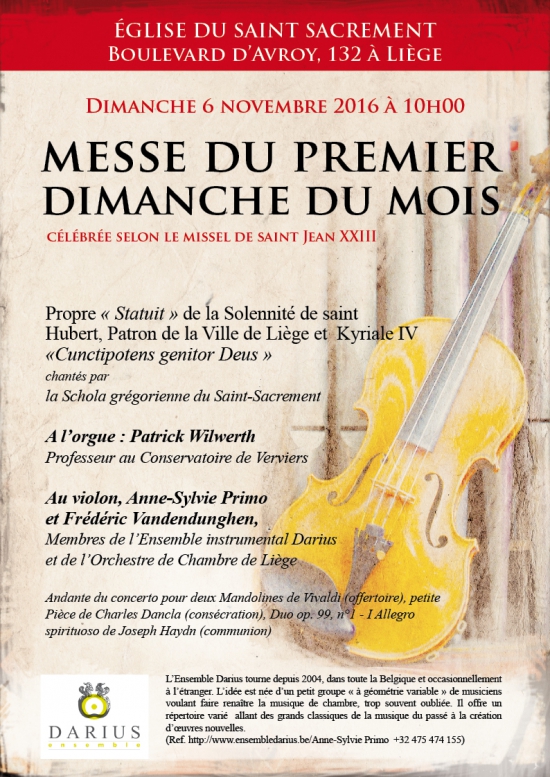
 « …L'obéissance a mauvaise presse, comme l'autorité a mauvaise presse. Il suffit de relire ce que dit Bossuet de l'autorité pour comprendre que ni l'autorité ni l'obéissance ne sont facultatives. L'une et l'autre sont des vertus. Qu'est-ce que l'obéissance ? Le père Labourdette en parle bien dans un flamboyant article de la revue thomiste datant des années Cinquante de l'autre siècle. Etre dans l'obéissance signifie être à sa place. Refuser l'obéissance signifie refuser sa place, refuser de jouer son rôle et s'en inventer un éventuellement... A ses risques et périls.
« …L'obéissance a mauvaise presse, comme l'autorité a mauvaise presse. Il suffit de relire ce que dit Bossuet de l'autorité pour comprendre que ni l'autorité ni l'obéissance ne sont facultatives. L'une et l'autre sont des vertus. Qu'est-ce que l'obéissance ? Le père Labourdette en parle bien dans un flamboyant article de la revue thomiste datant des années Cinquante de l'autre siècle. Etre dans l'obéissance signifie être à sa place. Refuser l'obéissance signifie refuser sa place, refuser de jouer son rôle et s'en inventer un éventuellement... A ses risques et périls.  Quand on regarde l’évolution des choses dans la société européenne contemporaine, au-delà même des questions démographiques, on ne peut pas nier un phénomène qui est la déchristianisation, y compris dans des terres qui sont restées catholiques très longtemps, telle que la Flandre il y a encore trente ou quarante années. Je sais que vous avez une conception qualitative en quelque sorte du catholicisme. Vous préférez un catholique fervent, cohérent et intense, plutôt qu’une dizaine de personnes qui, finalement, sont dans le simulacre du rite. Mais est-ce que, dans le cadre européen, ce recul quantitatif massif de l’Eglise catholique est à caractériser comme un échec, fut-il ponctuel et temporaire, ou pas ?
Quand on regarde l’évolution des choses dans la société européenne contemporaine, au-delà même des questions démographiques, on ne peut pas nier un phénomène qui est la déchristianisation, y compris dans des terres qui sont restées catholiques très longtemps, telle que la Flandre il y a encore trente ou quarante années. Je sais que vous avez une conception qualitative en quelque sorte du catholicisme. Vous préférez un catholique fervent, cohérent et intense, plutôt qu’une dizaine de personnes qui, finalement, sont dans le simulacre du rite. Mais est-ce que, dans le cadre européen, ce recul quantitatif massif de l’Eglise catholique est à caractériser comme un échec, fut-il ponctuel et temporaire, ou pas ?  « Il y a beaucoup de chose à répondre sur une telle question. C’est un échec et en même temps c’est une chance. Dans les décennies qui ont précédé, où nous avons connu dans pas mal de pays d’Europe, notamment la Belgique , un catholicisme très marquant dans la société, faisant même parfois un peu la pluie et le beau temps – et parfois un peu trop –cela avait ses avantages – on avait une société qui était très imprégnée de la foi et des valeurs chrétiennes, mais il manquait peut-être une conviction très personnelle. On était mis sur des rails dès l’enfance : la paroisse, l’école, la famille, les mouvements de jeunesse. C’était beau, mais qu’y avait-il derrière, dans les profondeurs du cœur et de l’âme humaine ? Aujourd’hui, dans cette situation que l’on peut qualifier d’échec, car marquée par un recul quantitatif, il y a l’aspect positif que, si quelqu’un désormais est catholique, il le sera davantage par un choix personnel. Cela, c’est un gain. Donc, oui, il y a un échec, mais un échec qui correspond aussi à une chance qui est offerte.
« Il y a beaucoup de chose à répondre sur une telle question. C’est un échec et en même temps c’est une chance. Dans les décennies qui ont précédé, où nous avons connu dans pas mal de pays d’Europe, notamment la Belgique , un catholicisme très marquant dans la société, faisant même parfois un peu la pluie et le beau temps – et parfois un peu trop –cela avait ses avantages – on avait une société qui était très imprégnée de la foi et des valeurs chrétiennes, mais il manquait peut-être une conviction très personnelle. On était mis sur des rails dès l’enfance : la paroisse, l’école, la famille, les mouvements de jeunesse. C’était beau, mais qu’y avait-il derrière, dans les profondeurs du cœur et de l’âme humaine ? Aujourd’hui, dans cette situation que l’on peut qualifier d’échec, car marquée par un recul quantitatif, il y a l’aspect positif que, si quelqu’un désormais est catholique, il le sera davantage par un choix personnel. Cela, c’est un gain. Donc, oui, il y a un échec, mais un échec qui correspond aussi à une chance qui est offerte. Le voyage du pape François à Lund et Malmö pour le lancement du 5° centenaire de la Réforme nous remet en mémoire la question fondamentale de l’ecclésiologie à laquelle se réfèrent les communautés protestantes et de savoir exactement sur quoi on « dialogue » lorsqu’on parle d’œcuménisme.
Le voyage du pape François à Lund et Malmö pour le lancement du 5° centenaire de la Réforme nous remet en mémoire la question fondamentale de l’ecclésiologie à laquelle se réfèrent les communautés protestantes et de savoir exactement sur quoi on « dialogue » lorsqu’on parle d’œcuménisme. Luther est ce qu’il est, avec ses erreurs, ses excès, sa violence et, comme l’a dit un jour le théologien Benoît XVI, aujourd’hui encore bon nombre de ses thèses tomberaient sous le coup de la censure de l’Eglise. Mais dépassant le contenu des écrits de l'hérésiarque, il a par ailleurs posé son regard sur l’homme et l’a élevé ensuite sur les enjeux de l’œcuménisme contemporain confronté à la grande apostasie présentement à l’oeuvre au sein même du christianisme.
Luther est ce qu’il est, avec ses erreurs, ses excès, sa violence et, comme l’a dit un jour le théologien Benoît XVI, aujourd’hui encore bon nombre de ses thèses tomberaient sous le coup de la censure de l’Eglise. Mais dépassant le contenu des écrits de l'hérésiarque, il a par ailleurs posé son regard sur l’homme et l’a élevé ensuite sur les enjeux de l’œcuménisme contemporain confronté à la grande apostasie présentement à l’oeuvre au sein même du christianisme.