Un rappel bienvenu de Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, lu sur le site web «salon beige » :
 « Une question me travaille depuis des semaines : le blasphème est-il vraiment un droit en démocratie ? Les caricatures blasphématoires sont-elles un droit en démocratie ? Malgré les affirmations du président de la République, je réponds non à cette question et je voudrais argumenter ma réponse.
« Une question me travaille depuis des semaines : le blasphème est-il vraiment un droit en démocratie ? Les caricatures blasphématoires sont-elles un droit en démocratie ? Malgré les affirmations du président de la République, je réponds non à cette question et je voudrais argumenter ma réponse.
En terre d’Islam radical, le blasphème contre le prophète ou le Coran est passible de la peine de mort et dans certains cas par décapitation. Dans l’Église catholique, quand un tabernacle ou un ciboire contenant la présence réelle du Seigneur est profané, les chrétiens célèbrent des messes de réparations et de demande de pardon pour de tels actes de profanation.
Après les attentats de “Charlie Hebdo”, tout le monde était “Charlie” ! Personnellement, j’ai toujours affirmé : “Je ne suis pas Charlie”, tout en condamnant avec force les auteurs de cet attentat barbare et odieux. Il était fondamental de condamner l’attentat, mais il était tout aussi fondamental de me dissocier d’un journal qui fait sa une de caricatures aussi blasphématoires les unes que les autres.
Lorsque “Charlie” a pu reparaître des mois plus tard, la une était toujours scandaleuse et m’a profondément blessé. Elle représentait le pape Benoît XVI sodomisé par le prophète ! Et la presse s’est réjouie de voir ce “journal” renaître de ses cendres. Quelques temps après, j’ai eu l’occasion, lors d’un repas à la préfecture d’Avignon avec le ministre de l’Intérieur de l’époque, et les représentants des cultes de poser au ministre la question suivante : le blasphème semble faire partie des gènes de “Charlie Hebdo”, mais ne pensez-vous pas que la liberté de publier blasphème et caricatures s’arrête là où je blesse gravement mes frères ? Et je lui ai dit combien j’avais été profondément bouleversé de voir ainsi bafouer le pape Benoît et même de voir bafouer le prophète à travers cette caricature. Il m’avait répondu à l’époque qu’au gouvernement, il y avait eu un débat, car un certain nombre de ministres condamnaient une telle caricature au nom même d’une limite à la liberté dans un monde où nous sommes invités à vivre en frères.
Je dois avouer que j’avais pleuré devant une telle caricature qui blessait ma sensibilité de chrétien. Comment des journalistes peuvent-ils agir ainsi au nom d’un pseudo droit à une liberté totale et sans limites de caricaturer jusqu’à l’extrême et de s’en glorifier ? La démocratie ou le laïcisme n’ont rien à voir en cela.
Je croyais – naïvement peut-être – que l’homme était fait pour vivre en société et que la République avait cru bon d’emprunter aux chrétiens le symbole de la “Fraternité” comme emblème de la République ! Si nous sommes appelés à vivre ensemble en frères, la liberté de chacun s’arrête là où je blesse mon frère. Je peux certes entamer le dialogue avec un frère qui ne partage pas mon point de vue, et user de tout mon pouvoir de persuasion, mais déclarer d’emblée que le blasphème et les caricatures, quelles qu’elles soient sont un droit en démocratie, cela n’est pas juste, cela n’est pas vrai.
En même temps, cela ne justifie en aucune façon la décapitation d’un professeur d’histoire qui voulait réfléchir avec ses élèves sur la portée de telles caricatures et sur un tel blasphème remis au goût du jour dans une presse à scandale.
Je dois avouer combien je suis resté sans voix devant les déclarations du président de la République, qui plus est parlant depuis le Liban, face à un tel acte. Il a justifié au nom même de la démocratie la liberté de dire et de publier tout et n’importe quoi, la liberté au blasphème sous toutes ses formes. Je croyais rêver !
Je comprends qu’il soit de bon ton aujourd’hui de se moquer des religions et de les traîner dans la boue, mais les auteurs de tels comportements se rendent-ils compte qu’ils bafouent la liberté dans son vrai sens, son sens profond et authentique ?
Au nom même de la fraternité, base de toute vie en société, je ne peux que redire : la liberté de chacun s’arrête là où je blesse gravement mon frère ! Il s’agit là d’une vérité fondement même de toute vie en société ou alors nous allons vers une dérive totalitaire qui ne dit pas son nom. En même temps, il nous faut condamner avec force les actes de violences et de barbarie qui prétendent répondre à cette conception erronée de la liberté.
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon »
Ref: Non, il n’existe pas de droit au blasphème!
Qui sème le vent récolte la tempête pour lui et pour les autres. Et surenchérir en absolutisant la laïcité comme un dogme d’Etat ne fait qu’ajouter un tison sur le feu des guerres de religion. JPSC
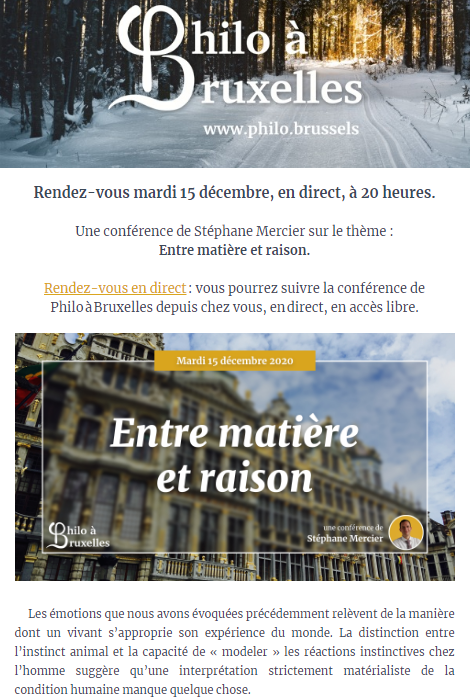
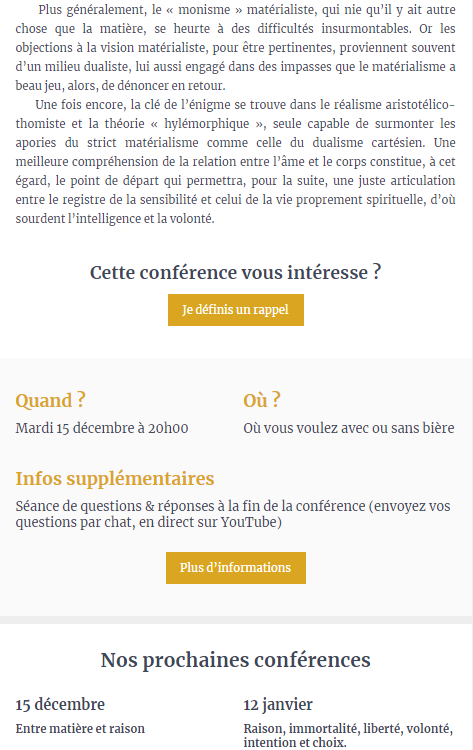

 « Alors que certaines mesures sanitaires s’installent dans le temps long, les demandes persistantes en faveur de la liberté du culte montrent que c’est l’ensemble des libertés publiques qui est en jeu.
« Alors que certaines mesures sanitaires s’installent dans le temps long, les demandes persistantes en faveur de la liberté du culte montrent que c’est l’ensemble des libertés publiques qui est en jeu.


 « Une question me travaille depuis des semaines : le blasphème est-il vraiment un droit en démocratie ? Les caricatures blasphématoires sont-elles un droit en démocratie ? Malgré les affirmations du président de la République, je réponds non à cette question et je voudrais argumenter ma réponse.
« Une question me travaille depuis des semaines : le blasphème est-il vraiment un droit en démocratie ? Les caricatures blasphématoires sont-elles un droit en démocratie ? Malgré les affirmations du président de la République, je réponds non à cette question et je voudrais argumenter ma réponse.