De Jérôme Poignon sur le site « Boulevard Voltaire » :

Tremblements de terre, raz-de-marée, ouragans : catastrophes naturelles normales parce que naturelles. Elles possèdent à chaque fois un périmètre et l’on sait leur durée. Mais aujourd’hui, un danger mortel investit durablement toute la Terre.
De même qu’il y a cent ans, nous sommes impuissants devant un mal souverain – opportunément « couronné » – qui nous plonge dans la sidération, l’hystérie et le dénuement. Pourtant, c’est une catastrophe naturelle, elle aussi. Car il est inutile de savoir qui a vendu au marché un pangolin suspect ou qui a laissé une fenêtre ouverte dans un mystérieux laboratoire P4 : le marchand chinois ignore sa bévue et le laborantin négligent est couvert par le secret défense… L’ignorant et l’apprenti sorcier ploient ensemble maintenant sous un virus létal disséminé et invaincu depuis des mois.
L’ubiquité du danger souligne douloureusement l’adversité essentielle de notre environnement. Tout notre labeur ne vise qu’à lutter, au moins pour survivre et au mieux pour aspirer à un éden mythique. Mais la nature n’est toujours que partiellement comprise et maîtrisée : on ne peut saisir intégralement que sa propre création et, en fait, nous ne créons rien de matériel. Notre génie scientifique est limité à l’observation et l’assemblage des éléments qui nous entourent et de ceux qui nous composent. Les savants poussent des frontières mais ne peuvent les traverser ; l’art seul permet d’entrevoir l’autre côté du miroir.
Puisque être dans la nature, c’est être aussi de la nature, l’instabilité de cette dernière est consubstantielle à notre condition et le destin du puissant n’est pas plus assuré que celui du manant. De même que la tuile qui tombe du toit ne choisit pas sa cible, de même nul ne peut savoir « ni le jour ni l’heure ».
C’est bien un appel à l’humilité qu’inspire la tragédie : humilité à l’égard de la nature et compassion des uns envers les autres pour les vies arrachées. Mais après les bacchanales médiatiques, sportives et politiques célébrant une mobilité retrouvée, l’égoïsme, l’arrogance et la rancœur surgiront d’autant plus violemment que les suites du grand bond en arrière seront dures à supporter.
Pour traverser les épreuves, les poètes et les artistes sont des soutiens lumineux : leurs chefs-d’œuvre renvoient parfois du monde une image décalée. Or, voir différemment, c’est sans doute voir autre chose »…
Ref. Covid19 : le retour de la fatalité ?
La vie en ce monde passe comme le songe d’une nuit d’été ou plutôt, selon le mot abrupt de sainte Thérèse d’Avila, comme une mauvaise nuit dans un mauvais lieu où la fatalité finit toujours par l’emporter sur la liberté. L’espérance n’est pas pour ce monde mais en l’autre. Un virus minuscule nous le rappelle. En exergue de l'avis mortuaire d'une personne proche décédée ce mois-ci, je trouve cette citation de Newmann qui exprime plus élégamment la même chose: " Ex umbris et imaginibus in veritatem", "loin des interrogations et des discussions stériles, enfin dans la vérité".
JPSC
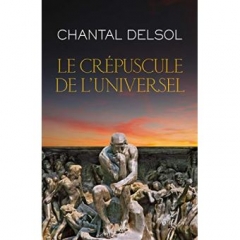 « Chantal Delsol, bien connue de nos lecteurs, a publié Le crépuscule de l’universel, essai remarquable dont elle nous parle ici. Entretien :
« Chantal Delsol, bien connue de nos lecteurs, a publié Le crépuscule de l’universel, essai remarquable dont elle nous parle ici. Entretien :


 « La crise du coronavirus et, surtout, les réactions qu’elle a suscitées ont une grande valeur révélatrice. Il est incontestable que cette période aura constitué un moment important dans ce XXIe siècle déjà ouvert par le choc du 11 septembre 2001. Événement majeur annonçant l’accès à un gouvernement mondial, ou basculement dans le chaos achevant la décomposition postmoderne des sociétés ? Ou peut-être les deux à la fois ? Il est trop tôt pour trancher. Encore peut-on émettre quelques remarques et entrevoir la confirmation de certaines tendances qui ne manqueront pas de peser dans l’avenir. On ne nous en voudra pas de prendre pour appui principal le cas de la France, même si des faits comparables affectent la plus grande partie de la planète.
« La crise du coronavirus et, surtout, les réactions qu’elle a suscitées ont une grande valeur révélatrice. Il est incontestable que cette période aura constitué un moment important dans ce XXIe siècle déjà ouvert par le choc du 11 septembre 2001. Événement majeur annonçant l’accès à un gouvernement mondial, ou basculement dans le chaos achevant la décomposition postmoderne des sociétés ? Ou peut-être les deux à la fois ? Il est trop tôt pour trancher. Encore peut-on émettre quelques remarques et entrevoir la confirmation de certaines tendances qui ne manqueront pas de peser dans l’avenir. On ne nous en voudra pas de prendre pour appui principal le cas de la France, même si des faits comparables affectent la plus grande partie de la planète.

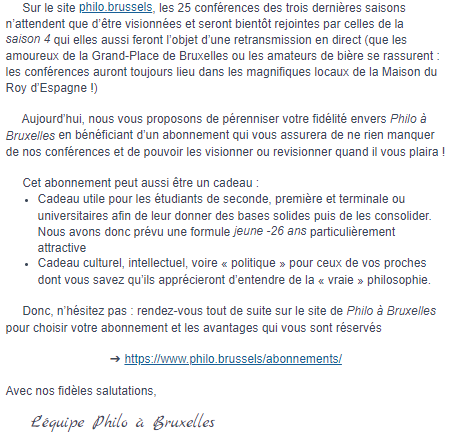
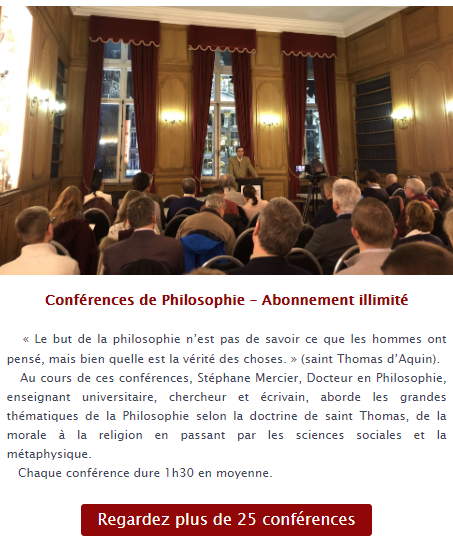
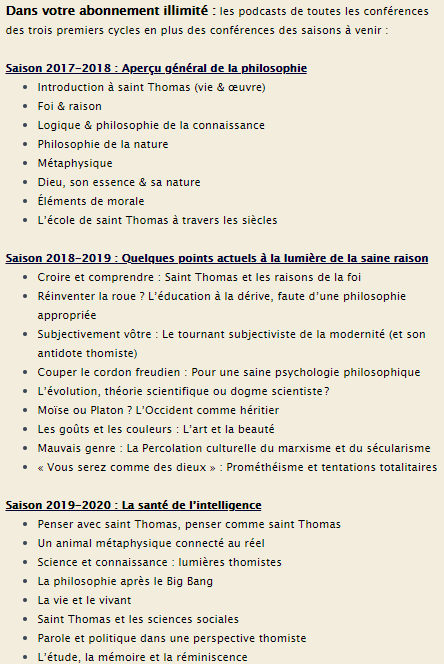
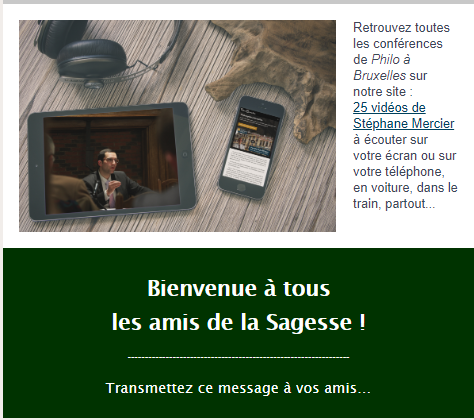


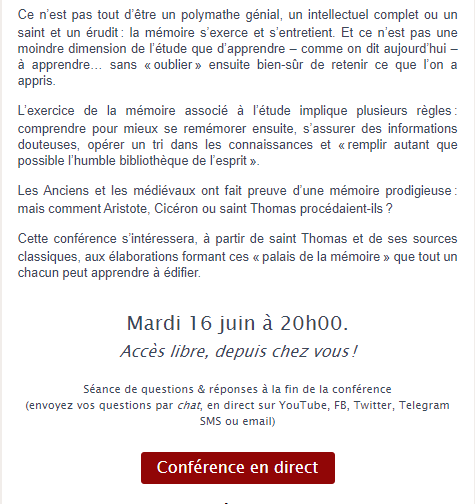
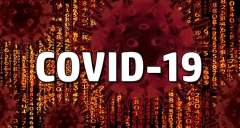 La pandémie de Covid a donné lieu à de multiples interprétations et interrogations, des plus classiques aux plus farfelues, notamment à propos de l’idée de « châtiment divin ». Petit retour ici aux réalités avec l’abbé Christian Gouyaud sur le site du mensuel « La Nef » :
La pandémie de Covid a donné lieu à de multiples interprétations et interrogations, des plus classiques aux plus farfelues, notamment à propos de l’idée de « châtiment divin ». Petit retour ici aux réalités avec l’abbé Christian Gouyaud sur le site du mensuel « La Nef » :