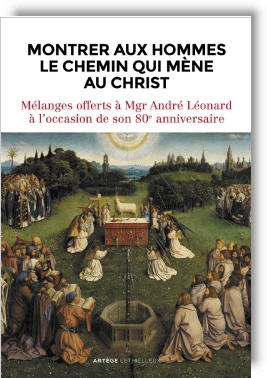Une chronique de Laura Rizzerio, professeure de philosophie à l’UNamur, parue sur la Libre dans la rubrique "opinions" :
La grandeur de la science c’est qu’elle n’explique pas tout
Si la science est essentielle pour donner accès à la connaissance du réel, la considérer comme l’unique source de vérité revient à lui confier un job qui n’est pas le sien.
Parmi les aphorismes dont on a hérité de la culture médiévale il y a celui-ci : contra factum non valet argumentum (contre un fait il n’y a pas d’argumentation qui vaille). Les médiévaux souhaitaient ainsi rappeler qu’il existe une distance entre les faits et leurs interprétations et qu’il faut attribuer aux premiers une priorité sur les secondes. C’était leur manière de reconnaître la grandeur de la science et de l’homme qui la construit grâce aux arguments développés par son intelligence. Mais c’était aussi affirmer que le “fait” déborde toujours l’analyse scientifique (les argumenta).
En cette période où différentes crises – sanitaire, climatique, sociale, politique – se succèdent et s’intensifient mutuellement, ouvrant inlassablement le débat entre citoyens, experts, scientifiques et hommes politiques, cet aphorisme me paraît retrouver son actualité.
En effet, ce qui frappe dans les débats actuels c’est qu’on utilise souvent des arguments pour contester les faits – pourtant attestés par l’expérience, l’expérimentation et l’accumulation de données scientifiques – non pas en se confrontant à d’autres faits, mais en jugeant les argumentations d’autrui comme erronées simplement à partir de ses propres interprétations. C’est le cas par exemple des débats autour du climat.
La lutte contre la pandémie n’a fait qu’amplifier le phénomène en suscitant aussi une animosité palpable entre “experts” et décideurs politiques.
Le vrai scientifique connaît ses limites
Ces attitudes témoignent d’une difficulté à prendre la science pour ce qu’elle est car, comme le souligne le philosophe Jean-Michel Besnier, s’il y a bien une distinction entre sciences et non-sciences, c’est que “les premières endurent l’épreuve de la réfutation, les secondes s’y soustraient” (Jean-Michel Besnier, “Les théories de la connaissance”, PUF, 2016, p. 57.). Ces attitudes inquiètent aussi, car elles fragilisent la responsabilité individuelle, l’action politique et l’organisation de la société.
Le philosophe Dominique Lambert décrit la science comme un “ensemble de pratiques théoriques observationnelles et expérimentales visant à maîtriser divers champs de phénomènes” (Dominique Lambert, “Les trois niveaux de l’activité scientifique”, in “Science et Théologie. Les figures d’un dialogue”, Lessius/PUN, 1999, pp. 13-44.). Elle atteint la réalité en nous livrant une connaissance de celle-ci aussi bien au terme d’une reconstruction théorique – par modélisations, formalisations, simulations – qu’au terme d’une procédure empirique, à l’aide de l’expérimentation.
La science serait donc une discipline apte à dire quelque chose de vrai sur la réalité mais à partir de la méthode qui est la sienne, dans une condition de révision perpétuelle. Cette méthode ouvre à la connaissance du réel au moyen d’une analyse (c’est l’argumentum des médiévaux) qui explique le complexe à partir de l’élémentaire, en “réduisant” méthodologiquement celui-là à celui-ci.
Or, si telle est la condition de la science, il est alors évident que l’image de la réalité qu’elle nous livre ne peut prétendre épuiser complètement la vérité profonde des faits. La vision “réductionniste” qui caractérise sa méthode conduit inévitablement à mettre entre parenthèses la question du sens, d’une signification qui dépasse le cadre de l’expérimentation et de l’analyse scientifiques. Ce cadre est pourtant essentiel pour expliquer l’agir des êtres humains que nous sommes. Le véritable scientifique en est conscient et ne le nie pas. C’est ainsi que, par exemple, “réduire” la complexité de l’acte humain à des mécanismes moléculaires reviendrait à faire tort à la science ainsi qu’à mépriser l’humanité. Si donc l’expertise scientifique est essentielle pour donner accès à la connaissance du réel (les faits), la considérer comme l’unique source pour dire la vérité de celui-ci et comme le seul guide de notre agir, c’est confier à la science un job qui n’est pas le sien. C’est aussi méconnaître sa grandeur et celle de la liberté humaine.
La responsabilité d’indiquer comment nous devons agir pour faire face aux crises revient en dernière instance à chacun, et à ceux qui ont la responsabilité de gérer la société, éclairés par l’expertise scientifique, mais pas déterminés par celle-ci.
Voilà en quoi l’aphorisme médiéval conserve toute son actualité et fait même un clin d’œil, par-delà plusieurs siècles, à notre nouveau gouvernement.