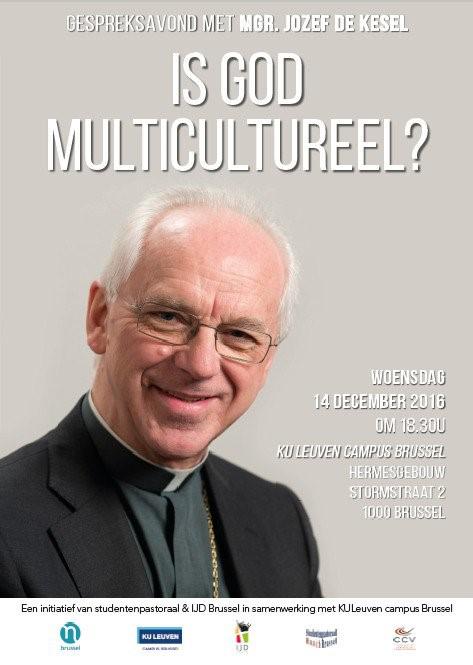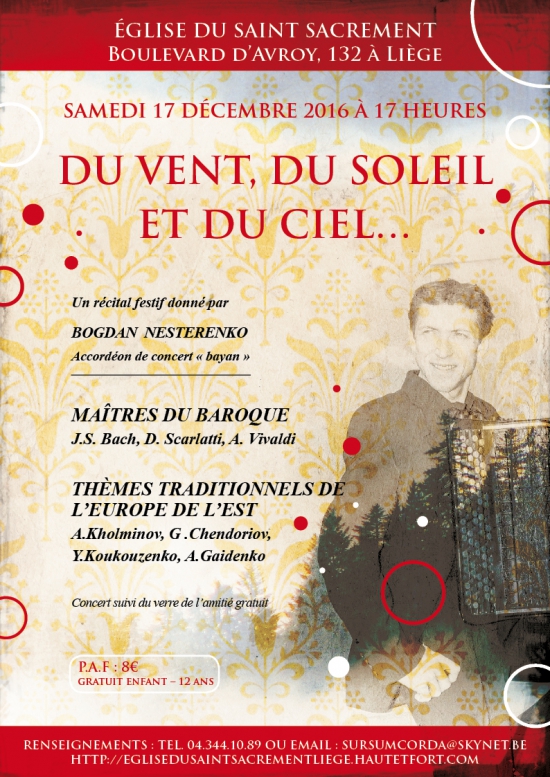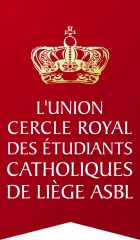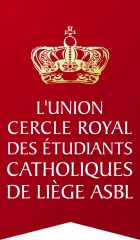
A l’Université de Liège le 17 janvier 2017 à 18h00:

Monseigneur Delville inaugurera le cycle annuel des conférences de l’Union des Étudiants catholiques, consacré en 2017 à « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain »
Le Groupe éthique sociale et l’Union des étudiants catholique de Liège organisent, avec le concours du Forum de conférences « Calpurnia », leur cycle de conférences pour l’année 2017 à l’Université de Liège sur le thème « L’Europe, ses fondements, aujourd’hui et demain ».
Ce cycle propose quatre rencontres pour réfléchir sur des enjeux majeurs de la crise actuelle de l’Europe exposés par des conférenciers issus de différents horizons de la société.
Une approche historique à partir des invasions germaniques qui ont suivi la chute de l’Empire romain et une interprétation du passage de la République romaine à l’Empire romain permettront de réfléchir sur la manière d’envisager l’avenir possible de l’Union Européenne confrontée à l’immigration et à la conservation d’une identité compatible avec la multiculturalité.
Les défis socio-économiques auxquels l’Europe est confrontée et les conditions à remplir pour y faire face seront abordés en conclusion par Pierre Defraigne, Directeur général hre à la Commission européenne et actuel Directeur exécutif du Centre Madariaga, qui est une fondation du Collège de l’Europe,
La rencontre inaugurale aura pour thème : « le christianisme médiéval, creuset de l’Europe ». Elle sera animée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège mais aussi Professeur honoraire d’histoire du christianisme à l’Université catholique de Louvain (U.C.L.) sous la forme d’un lunch-débat organisé le mardi 17 janvier 2017 à 18h00, à la Salle des professeurs dans le bâtiment du Rectorat de l'Université de Liège, place du XX août, 7, 1er étage (accès par la grande entrée : parcours fléché).
Participation aux frais : 15 € (à régler sur place) – 5 € pour les étudiants
Inscription nécessaire au plus tard trois jours ouvrables à l’avance (12 janvier 2017)
soit par téléphone : 04 344 10 89
soit par email : info@ethiquesociale.org
Plus de renseignements et s’inscrire en ligne ici : http://www.ethiquesociale.org/
JPSC