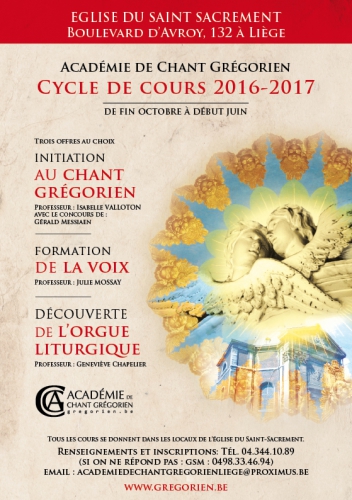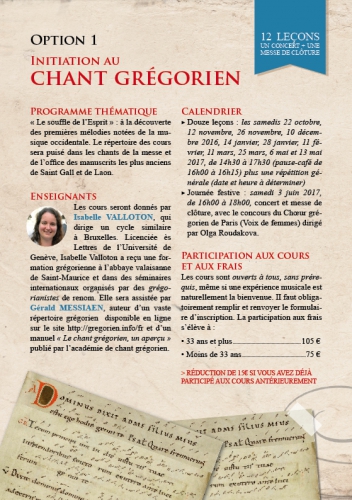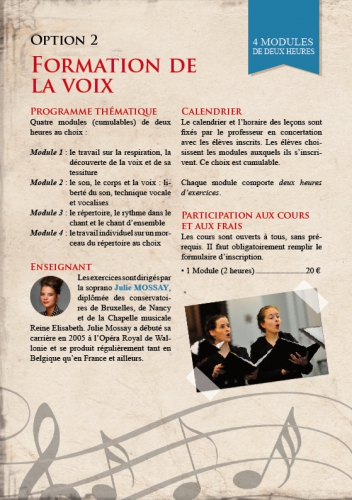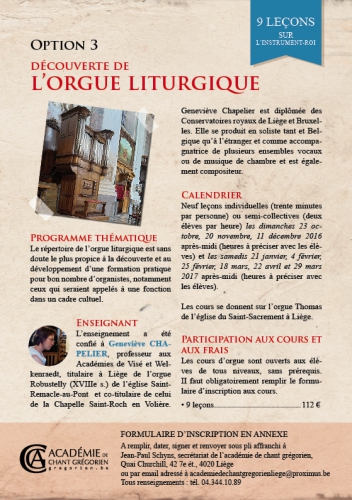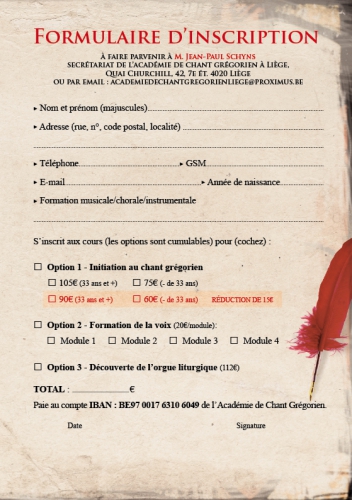De LaLibre.be (débats) :
Assoiffés d’espérance et de vérité
Une opinion de douze jeune chrétiens. Organisateurs de la Session Lead (1).
Le 22 septembre dernier, dans un texte implacable publié par le journal "Libération", le collectif Catastrophe regroupant une quinzaine de jeunes nés en 1990 traçait à grandes lignes le portrait d’une société globalisée et désenchantée qui ne put offrir de place à leur génération. "Nous avons grandi dans une impasse […] Nous arrivions trop tard […] Au lycée, on nous avertit d’emblée que l’Histoire était finie. On nous expliqua que Dieu, le Roman et la Peinture étaient morts. Sur les murs de la capitale, on nous apprit que l’Amour l’était aussi. Nous n’en connaissions pas le visage que déjà, nous n’avions plus le droit d’y croire." Quelques jours plus tard, dans "La Libre" du 29 septembre, plus sereinement mais tout aussi inquiète, l’essayiste Anne Mikolajczak se penchait sur nos âges. Elle décrivait à son tour "une génération en panne de projets, de confiance et de repères".
Leurs constats respectifs qui se croisent et se complètent ne s’arrêtaient cependant pas là. L’un comme l’autre, ils évoquaient des échappatoires possibles, des énergies propres, des chemins de traverse qui ouvrent à la création et à de nouveaux horizons.
Une vérité commune pour nous rassembler
A notre tour, nous les rejoignons, mais sans doute pour aller plus loin encore, dans le constat comme dans l’espérance. Plus loin, car nous le reconnaissons, nous sommes assoiffés d’une vérité vers laquelle la société ne nous mène plus.
Dans les pas d’un saint Thomas d’Aquin, nous affirmons pourtant que cette vérité existe et qu’elle n’est "ni dans les choses, ni dans la pensée" mais bien "dans une relation d’adéquation entre notre pensée et la réalité qui nous fait face". Ainsi, la vérité ne dépend pas de nous, et ne pourrons jamais la détenir, mais nous sommes appelés à la chercher inlassablement. Or, une société qui se contente d’affirmer que chacun détient "sa" vérité, qu’il y a autant de vérités que de points de vue, et que tout ce qui est sincère est vrai, ne nous pousse plus à dépasser ou à réinterroger humblement nos convictions et nos a priori. Pire, elle nous écarte irrémédiablement les uns des autres, tant nous restons enfermés dans nos conceptions respectives sans ne plus oser les confronter. Et en définitive, elle se délite par elle-même. Car comment pourrions-nous "faire" société, si aucune vérité, aucune perspective commune ne pouvait plus nous rassembler ?
Il ne nous revient donc pas de créer une vérité préfabriquée soucieuse d’aiguiller le monde. Simplement de reconnaître que la recherche du vrai, du beau, du bien et de ce qui est juste est plus que jamais ce qui doit animer notre génération en quête de sens. De reconnaître également que nous ne serons jamais les détenteurs de la vérité, mais que nous pouvons en être les "coopérateurs" répéterons-nous avec Benoît XVI. Car si la vérité ne dépend pas des hommes, elle a besoin des hommes pour être dite, et les hommes ont besoin de s’en approcher pour être éclairés. Là est notre credo et là est notre espérance : ce cheminement, même infini, est possible. Pour ce faire, il nous revient donc, dans la société que nous sommes appelés à bâtir, de permettre aux hommes de chercher cette vérité de par l’éducation, la charité, et des lieux de réflexion à retrouver.
Le sens et l’espérance
Nous plaidons en ce sens pour le retour de la transmission d’abord et avant tout à l’école. Tout simplement parce que le retour aux savoirs, loin de nous aliéner, nous offre des appuis pour mieux nous émanciper et découvrir ce que nous sommes. Tout simplement aussi parce que nous ne nous sommes pas faits tout seuls et que nous avons autant besoin du savoir de nos prédécesseurs, que de celui de nos contemporains pour progresser vers la vérité. "Tout homme a quelque chose d’unique à dire de la vérité", nous rappelait en ce sens François-Xavier Bellamy. Et nous avons besoin de tout homme, quel qu’il soit, pauvre ou petit, faible ou fragile, âgé ou étranger, pour nous guider et nous apporter son regard spécifique.
Ce sont donc la transmission et le développement des liens fraternels qui sauveront notre génération. L’une comme l’autre élargiront notre regard et nous feront progresser. L’une comme l’autre nous permettront de reconnaître ce que notre voisin est aussi : celui qui peut nous guider vers la vérité. C’est d’ailleurs cette reconnaissance que nous oublions trop souvent de poser sur nos contemporains. Et c’est en son absence, lorsque l’on oublie ce que le plus petit d’entre nous a à nous apporter, que ne cesse de grandir "la globalisation de l’indifférence" comme le rappelle le pape François.
L’Histoire n’est pas finie
Cette double nécessité du lien et de la transmission est d’autant plus urgente que le sens et l’espérance ne sont pas de vains mots. Partout ils ne demandent qu’à renaître. Philippe de Woot, décédé le mois dernier, nous le rappelait au quotidien, lui qui offrit au monde de l’entreprise de retrouver des finalités au service de l’humain. Mère Teresa, canonisée dernièrement, ne peut que nous édifier, elle qui derrière les blessures les plus profondes voyait le sens et l’exceptionnel de chaque vie. Plus près de nous encore, l’initiative Teach4Belgium qui pousse les élèves à aller au bout de leurs capacités et de leurs ambitions est un exemple de ce qui encourage et valorise la jeunesse.
Le lien et la transmission seront des clés pour soulager une société avide de vérité et d’espérance. Des clés complexes à assumer cependant, car elles requerront du courage : celui de conformer notre pensée à la réalité qui lui préexiste; car elles nécessiteront de l’humilité : celle de voir en l’autre celui qui peut m’aider, me faire grandir et me guider vers la vérité; car elles nous imposeront enfin de la persévérance : celle capable de rejeter la confortable indifférence comme le trop rassurant relativisme.
Si donc les repères manquent parfois et que la confiance s’éclipse, l’Histoire n’en est pas finie pour autant. Pour répondre à Libération, Dieu lui-même n’est pas mort, et l’Amour ne s’est même pas retiré. Au contraire, ils n’attendent que nous. A notre génération dès lors de répondre avec confiance à cette soif de vérité et d’espérance qui habite nos cœurs. A notre génération de créer du lien, de transmettre et d’aimer.
(1) Charles-Henry Cattoir (25 ans), Geoffrey de Hemptinne (24 ans), Hugues Bocquet (25 ans), Lorraine Grisard (23 ans), Maël Dumont (23 ans), Mathilde Van Breuseghem (23 ans), Marie-Alice Milcamps (25 ans), Philippe Cartuyvels (23 ans), Priscille de Truchis (26 ans), Tanguy Bocquet (25 ans), Thomas de Richecour (25 ans) et Valentine Hermans (23 ans). En septembre, la deuxième édition de la "Session LEAD" a rassemblé plus de 140 jeunes de 21 à 30 ans, pendant 5 jours. Objectif : encourager la réflexion personnelle et l’engagement dans la société à la lumière de la foi chrétienne.