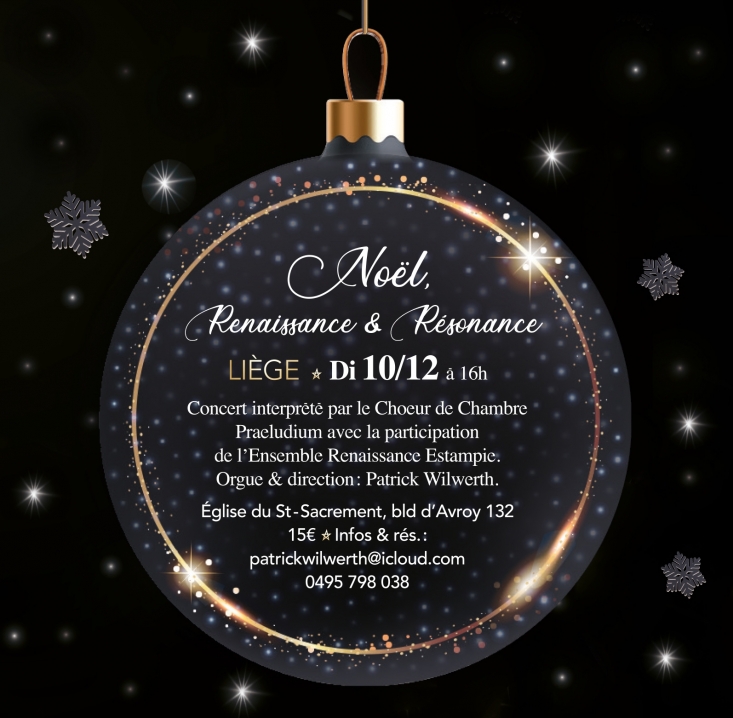D'Alice Pairo-Vasseur sur le site du Point via didoc.be :
« Certains politiciens se perdent dans une quête de laïcité mal comprise »
L’interview, dans « Le Point » d’une journaliste musulmane convertie au catholicisme, qui témoigne de sa perplexité face à la découverte d’une société sécularisée. Une analyse qui porte sur la France mais s’applique aussi à tout l’Occident.
Dans un essai, la journaliste Claire Koç livre un témoignage personnel sur sa conversion au catholicisme et une réflexion, documentée, sur ce qui demeure, en France, de l’héritage judéo-chrétien.
« Sans l’âme chrétienne de la France, la République ne serait pas ce qu’elle est », insiste Claire Koç, dans Le jour où je me suis convertie, à paraître ce 9 novembre, chez Plon. Née en Turquie, il y a trente-neuf ans, la journaliste, autrice d’un premier livre, Claire, le prénom de la honte (Albin Michel, 2021), dans lequel elle racontait son désir d’assimilation et ce changement d’identité entrepris contre la volonté de sa famille, revient avec le récit de sa conversion au catholicisme.
Un processus de trente années, dont elle raconte l’aboutissement et partage les désillusions. « Je vis dans une France où vouloir devenir catholique est regardé comme absurde », déplore-t-elle. Un livre-témoignage intime, doublé d’une réflexion, documentée, sur les racines judéo-chrétiennes de la France, à l’heure où les églises se vident et le sentiment d’appartenance s’effondre.
Le Point : Votre livre s’ouvre sur le constat suivant : « En me convertissant au catholicisme, j’étais persuadée de m’extraire d’une certaine minorité pour entrer dans la norme. J’avais tort sur toute la ligne. » Expliquez-nous.
Je viens d’une famille issue d’une minorité, les alévis. Une branche de l’islam originaire de Turquie et plus précisément d’Anatolie. J’ai beau avoir grandi en France, mes parents ne se définissaient pas comme français et, entourés de musulmans sunnites — dont les pratiques étaient différentes des nôtres —, ils m’ont élevée dans un carcan minoritariste. En me convertissant au catholicisme, je pensais m’en extraire et me fondre dans la masse. Mais quand j’ai annoncé ma conversion à mes amis français, ils m’ont dit que ce n’était « pas une bonne idée », quand ils n’ont pas montré un rejet complet vis-à-vis de mon choix, voire une hostilité à mon égard. J’ai compris que la religion catholique n’avait pas le vent en poupe, qu’elle ne faisait pas partie des nouvelles « normes » de croyance. Mais aussi qu’il y avait, en France, que l’on dit pourtant « fille aînée de l’Église », un rejet de la foi et de ceux qui l’épousent.
Pour quelles raisons, selon vous ?
Je crois que le « bashing » [dénigrement, NDLR] dont souffre la religion catholique, depuis plusieurs années, lui a été particulièrement délétère. Quasi exclusivement traitée sous l’angle de la pédophilie — ce qui est très grave, entendons-nous — ou de l’intégrisme, elle souffre d’amalgames très dépréciateurs. Quand elle n’est pas moquée, voire ridiculisée. Le cas d’Henri d’Anselme, le « héros au sac à dos » de l’attentat d’Annecy, est, à ce titre, éloquent. Très vite, il a été qualifié, sur les réseaux sociaux, d’« illuminé » et de « facho » pour avoir dit sa foi. Avec ce type de traitement, il n’est pas étonnant que l’athéisme séduise tant de fidèles. Le sentiment d’appartenance à la religion catholique est d’ailleurs passé de 89 % en 1960, à 39 % en 2023 (chiffres de la Conférence catholique des baptisés francophones). Cela interpelle dans un pays aux racines judéo-chrétiennes millénaires…
Est-ce ce qui vous a motivée à rendre publique votre conversion ?
La conversion est, en effet, un processus très intime. Et ce livre est avant tout un appel à la tolérance. Il y a un paradoxe à ce que notre société moderne, dans laquelle on parle tant de liberté et d’ouverture, montre une telle intolérance à la liberté de conscience. Laquelle émane d’ailleurs majoritairement de ceux qui en appellent à la tolérance et au « pas d’amalgame » avec les autres religions.
Plus largement, cette propension à dénigrer le christianisme m’inquiète, car la France lui est intrinsèquement liée. Et s’attaquer à la culture judéo-chrétienne revient à s’attaquer à l’Histoire de notre pays. Lequel a été façonné par elle et lui doit une large part de son héritage politique, artistique, législatif et moral (valeurs, éthique sociale…) Outre qu’il déprécie les Français dont les ancêtres chrétiens ont défendu ces terres, ce rejet pour ce qu’on est relève presque de la psychanalyse ! Il témoigne, du moins, d’un grand malaise identitaire.
Quel enjeu y a-t-il à réaffirmer cet héritage ?
Il en va de notre identité collective. Si la culture judéo-chrétienne s’efface, alors quelles seront nos références, quel sera notre modèle ? Sans socle commun, tout pays est en partition. Par ailleurs, les progressistes y trouvent peut-être encore leur compte, mais comment peuvent-ils croire que demain, un enfant — en particulier issu de l’immigration — embrasse ce pays qu’eux-mêmes rejettent ? Les politiciens qui veulent retirer les crèches dans l’entrée des mairies, utiliser la formule « fêtes de fin d’année » au lieu de « Noël » ou déboulonner des statues de saints se perdent — sciemment ou non — dans une quête de laïcité mal comprise et les prive d’un héritage fondamental à la compréhension de notre pays et de ses racines.
Vous consacrez, justement, une large part de votre livre à la laïcité, rappelant qu’elle est née du christianisme lui-même…
Absolument. Car si la France est chrétienne, la République est laïque. Et c’est parce que l’histoire de notre pays est profondément ancrée dans le christianisme — qui régissait tout jusqu’à la séparation de l’Église et de l’État — qu’il a accouché de la laïcité, actrice essentielle de l’équation entre spiritualité, liberté de conscience et citoyenneté. Aussi, lorsqu’on s’attaque à la foi chrétienne, ce sont aussi ces digues que l’on risque de détruire. Lesquelles, menacées par des radicaux, sont aujourd’hui plus essentielles que jamais…
Alice Pairo-Vasseur est journaliste au « Point ». Référence du livre : Claire Koç, Le jour où je me suis convertie, éditions Plon, 192 pages.