De Sandro Magister sur son blog chiesa.espresso :
François le rebelle. Contre la "colonisation idéologique"
Il s’agit, affirme le pape, de ceux qui enseignent que "chacun peut choisir son sexe". Dans le même temps, les évêques australiens démontrent que l'idéologie du "genre" est en progression partout dans le monde, au détriment des mariages homme-femme
ROME, le 8 août 2016 – Mettant fin à la consigne de silence qui avait été donnée initialement, le Saint-Siège a rendu publique, il y a quelques jours, la transcription de l’entretien à huis clos que le pape François a eu à Cracovie avec les évêques de Pologne le 27 juillet, premier jour de sa visite dans ce pays :
> Rencontre avec les évêques polonais
L’une des raisons de cette inhabituelle publication "a posteriori" a probablement été la volonté de couper court aux rumeurs concernant le contenu de cet entretien, en particulier à propos de l’accès des divorcés remariés à la communion, en raison de l’opposition massive des évêques polonais à quelque concession que ce soit dans ce domaine.
En effet, lorsqu’on lit la transcription de ce long entretien, on n’y trouve aucune référence à l’exhortation apostolique "Amoris lætitia" ni aux controverses qu’elle a suscitées.
En revanche on y découvre, vers la fin, une vibrante harangue du pape contre l'idéologie du "genre", qu’il qualifie de "véritable colonisation idéologique" à l’échelle mondiale.
Voici, rapporté textuellement, ce qu’il a déclaré :
"En Europe, en Amérique, en Amérique Latine, en Afrique, dans certains pays d’Asie, il y a de véritables colonisations idéologiques. Et l’une d’entre elles – je le dis clairement avec nom et prénom – c’est le 'genre' ! Aujourd’hui, à l’école, aux enfants – aux enfants – on enseigne ceci : que chacun peut choisir son sexe. Et pourquoi enseigne-t-on cela ? Parce que les livres sont ceux des personnes et des institutions qui te donnent l’argent. Ce sont les colonisations idéologiques, soutenues aussi par des pays très influents. Et ça, c’est terrible ! Quand j’ai parlé avec le pape Benoît – qui va bien et qui a une pensée claire – il me disait : 'Sainteté, c’est le temps du péché contre Dieu Créateur !'. C’est intelligent ! Dieu a créé l’homme et la femme ; Dieu a créé le monde ainsi, ainsi, ainsi… et nous sommes en train de faire le contraire. Dieu nous a donné un état 'inculte', pour que nous le fassions devenir culture ; mais ensuite, par cette culture, nous faisons des choses qui nous ramènent à l’état 'inculte' ! Ce qu’a dit le pape Benoît, nous devons y penser : 'C’est le temps du péché contre Dieu Créateur !'".
Le réseau des grands médias a pratiquement passé sous silence ces phrases de François qui, de plus, sont enrichies d’une citation lourde de sens du pape émérite. Il ne faut pas s’en étonner : c’est ce qui se produit à chaque fois que François tient des propos qui ne sont pas en harmonie avec l’image dominante que les médias donnent de lui, celle d’un pape ouvert à la modernité.
Mais ces choses-là, il les a bel et bien dites, comme il l’avait déjà fait en d’autres occasions dans le passé. Et on peut présumer qu’elles n’ont pas été bien accueillies par les gens qui, dans l’Église, militent pour une modernisation drastique de la doctrine catholique en ce qui concerne le "genre", l’homosexualité, le "mariage" de personnes du même sexe.
Lire la suite
 "Le monde est en guerre", mais pas de religions, a déclaré mercredi le pape François, évoquant, à bord de l'avion qui l'amenait en Pologne, l'assassinat la veille d'un prêtre français. "Ce saint prêtre qui est mort au moment où il offrait une prière pour toute l'Eglise", en est une victime, a dit le pape, à propos de l'attaque revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique contre une église en France lors de laquelle un prêtre âgé de 86 ans a été égorgé.
"Le monde est en guerre", mais pas de religions, a déclaré mercredi le pape François, évoquant, à bord de l'avion qui l'amenait en Pologne, l'assassinat la veille d'un prêtre français. "Ce saint prêtre qui est mort au moment où il offrait une prière pour toute l'Eglise", en est une victime, a dit le pape, à propos de l'attaque revendiquée par le groupe djihadiste Etat islamique contre une église en France lors de laquelle un prêtre âgé de 86 ans a été égorgé.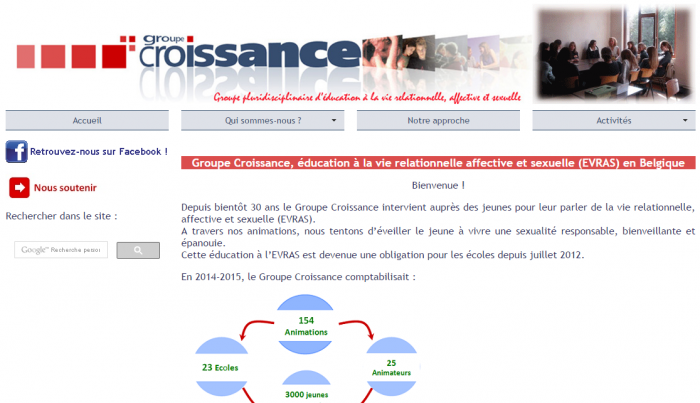
 De Riccardo Cascioli sur le site de la nuova bussola quotidiana
De Riccardo Cascioli sur le site de la nuova bussola quotidiana