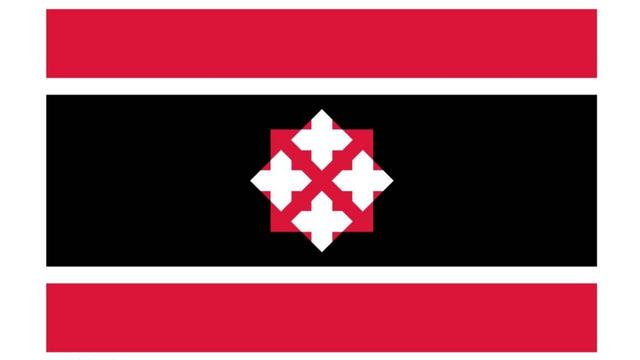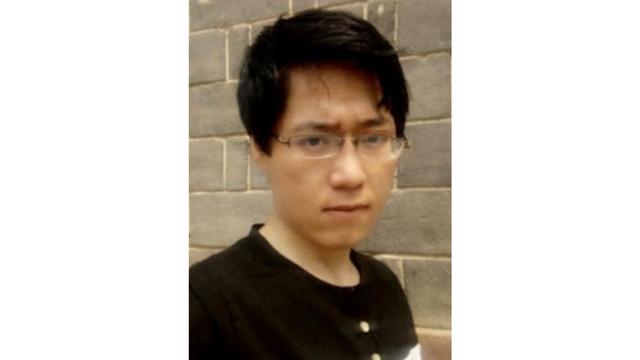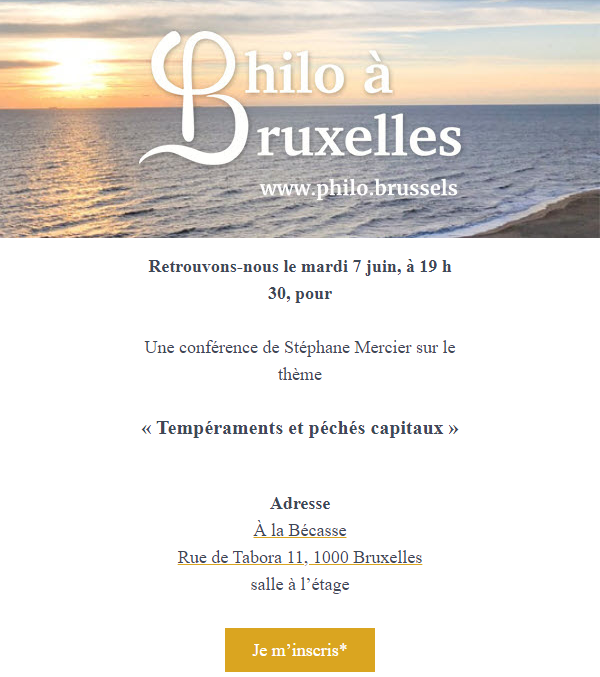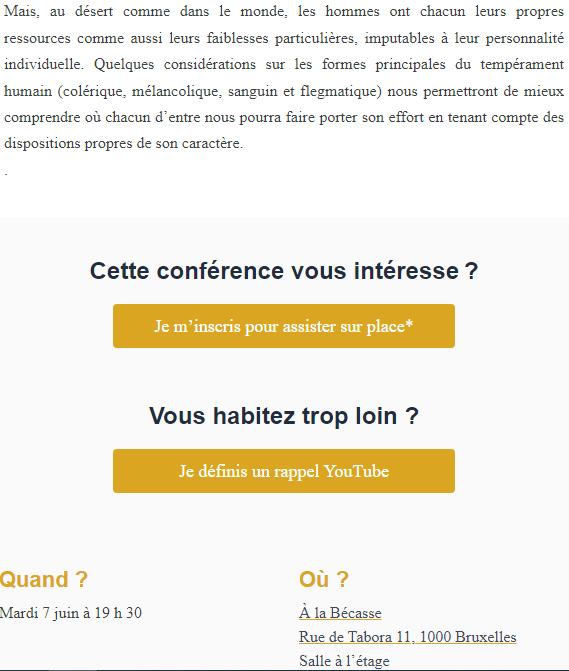Lu sur le site "diakonos" de ce 20 juin 2022:
 "Le Pape François est furieux contre ceux qui le mettent du côté de Poutine. Il les a traités de « calomniateurs » et de « coprophiles » dans une lettre écrite de sa main à un ami journaliste argentin. Mais un peu plus tard, en recevant le 8 juin dernier à Sainte-Marthe un trio d’Ukrainiens présentés par un autre de ses amis argentins (voir photo), il s’est vu reprocher par l’un d’entre eux, Myroslav Marynovich, vice-recteur de l’Université catholique de Lviv, que oui, « au Vatican, l’Ukraine a été vue pendant trop longtemps à travers le prisme russe ». Trouvant cette fois dans le Pape « un auditeur attentif » et compréhensif, et même prêt à admettre – un point-clé qu’il a presque toujours esquivé – que le peuple Ukrainien « a droit à l’auto-défense », parce que « autrement, ce qui se passe pourrait ressembler à un suicide ».
"Le Pape François est furieux contre ceux qui le mettent du côté de Poutine. Il les a traités de « calomniateurs » et de « coprophiles » dans une lettre écrite de sa main à un ami journaliste argentin. Mais un peu plus tard, en recevant le 8 juin dernier à Sainte-Marthe un trio d’Ukrainiens présentés par un autre de ses amis argentins (voir photo), il s’est vu reprocher par l’un d’entre eux, Myroslav Marynovich, vice-recteur de l’Université catholique de Lviv, que oui, « au Vatican, l’Ukraine a été vue pendant trop longtemps à travers le prisme russe ». Trouvant cette fois dans le Pape « un auditeur attentif » et compréhensif, et même prêt à admettre – un point-clé qu’il a presque toujours esquivé – que le peuple Ukrainien « a droit à l’auto-défense », parce que « autrement, ce qui se passe pourrait ressembler à un suicide ».
Le problème c’est que, quand il prend la parole, François parle à tort et à travers. Avec les conséquences qui s’en suivent. Toujours pendant l’entrevue du 8 juin avec les trois Ukrainiens, on lui a demandé d’éclaircir si vraiment il ne pouvait pas il y avoir de guerre « juste », comme il l’a dit à plusieurs reprises, contrairement à ce qui est écrit dans le Catéchisme de l’Église catholique. À quoi le Pape a répondu avoir « chargé quelques cardinaux d’approfondir ce thème », encore un de ses nombreuses décisions personnelles, parfois même fracassantes, prises sans consulter personne et sans même en parler.
Sur la guerre en Ukraine, à chaque fois que François parle à l’emporte-pièce, la Secrétairerie d’État a des sueurs froides. Le 14 juin, le jour même où l’archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, répétait que « nous devons résister à la tentation d’accepter des compromis sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine » – ce qui est en opposition la plus totale avec les prétentions de Moscou -, la revue des jésuites « La Civiltà Cattolica » publiait la transcription d’un entretien du Pape avec les directeurs de cette revue et d’autres revues européennes de la Compagnie de Jésus, dans laquelle François a de nouveau affirmé que « cette guerre a peut-être été d’une manière ou d’une autre provoquée ou non-empêchée ». Et par qui ? Par l’OTAN, avec ses « aboiements aux portes de la Russie ».
En comparaison avec son interview mémorable au « Corriere della Sera » du 3 mai dans laquelle il avait utilisé cette image zoomorphe pour la première fois, cette fois-ci, le Pape a révélé de qui, sans le nommer, il avait repris cette image, probablement le président social-démocrate de la Slovénie, Borut Pahor, qu’il a reçu en audience le 7 février dernier :
« Quelques mois avant le début de la guerre, j’ai rencontré un chef d’État, un homme sage, qui parle peu, vraiment très sage. Et après avoir parlé des choses dont il voulait me parler, il m’a dit qu’il était très préoccupé par l’attitude de l’OTAN. Je lui ai demandé pourquoi, et il m’a répondu : ‘Ils sont en train d’aboyer aux portes de la Russie. Et ils ne comprennent pas que les Russes sont impérialistes et ne permettent à aucune puissance étrangère de s’approcher d’eux’. Et il a conclu : ‘La situation pourrait conduire à la guerre’. C’était son opinion. Le 24 février, la guerre a commencé. Ce chef d’État a su lire les signes de ce qui était sur le point de se passer ».