Entre le monde et le cloître, où va donc aujourd’hui la barque de Saint-Pierre sur les flots agités de la planète ? Pour le n° de janvier du mensuel « La Nef », Christophe Geffroy fait le point avec le Père Abbé de la célèbre abbaye française Notre-Dame de Fontgombault :

« Fille de Solesmes, l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault remonte au XIe siècle et, depuis sa renaissance en 1948, a déjà essaimé cinq fois. Entretien avec Dom Jean Pateau, son Père Abbé.

La Nef – Quelle est l’utilité d’un moine contemplatif dans une société aussi utilitariste et « connectée » que la nôtre, si éloignée de la prière et de la vie spirituelle ?
TRP Dom Jean Pateau – Saint Benoît fait prononcer à ses moines trois vœux : stabilité, conversion de ses mœurs et obéissance. Je crois que le message du moine au monde passe aujourd’hui plus particulièrement par le vœu de stabilité. Conversion des mœurs et obéissance ne semblent plus guère audibles. Le monastère, par ses bâtiments, évoque déjà cette stabilité. La communauté, l’enseignement qui y est dispensé, s’inscrivent aussi dans cette perspective de durée, de tradition. Se retirant d’un monde liquide, sans repères, les retraitants viennent chercher auprès des moines une stabilité propice au contact avec Dieu. Même non croyants, des touristes de passage ressentent ce contraste. Dieu seul est source de la stabilité monastique. Le moine donne l’exemple d’un être « connecté » avec le Ciel : « Est moine celui qui dirige son regard vers Dieu seul, qui s’élance en désir vers Dieu seul, qui est attaché à Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul, et qui, en possession de la paix avec Dieu, devient encore cause de paix pour les autres. » (saint Théodore Studite).
Le contraste entre le « monde » et le cloître paraît plus grand qu’il ne l’a jamais été : dans ce contexte, d’où viennent vos vocations, sont-ils des jeunes hommes déjà quelque peu préparés par leur vie antérieure à cette ascèse ou sont-ils le simple reflet des jeunes d’aujourd’hui, vivant l’instant présent avec la peur de tout engagement ?
Il faut reconnaître que nous recevons des vocations de tous les horizons. Selon les provenances, le chemin sera plus ou moins difficile, plus ou moins long. La peur de l’engagement est assez banale. Le drame est quand cette peur dure. Saint Benoît donne comme critère de discernement : « si le novice cherche vraiment Dieu. » Les mots ont leur poids : chercher, vraiment, Dieu.



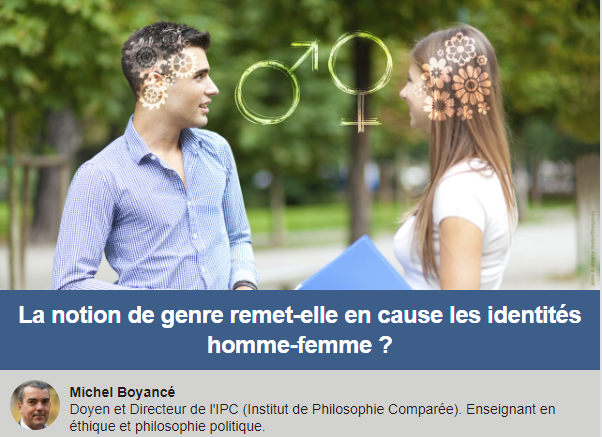
 Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’
Rédigé par Joël Hautebert le 23 décembre 2019, l’

