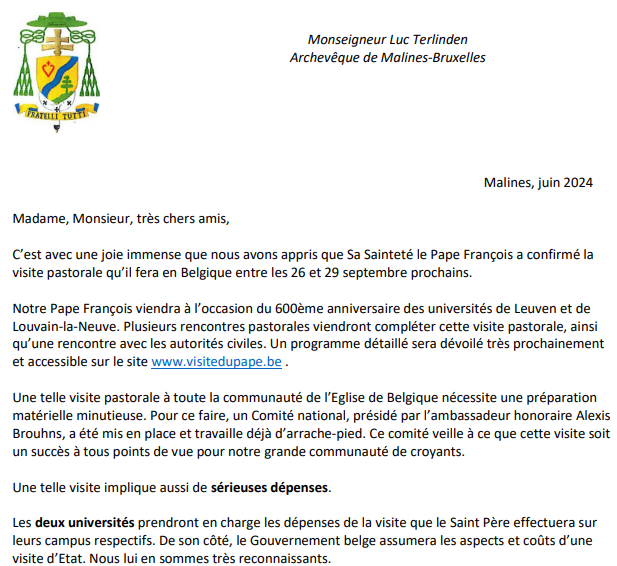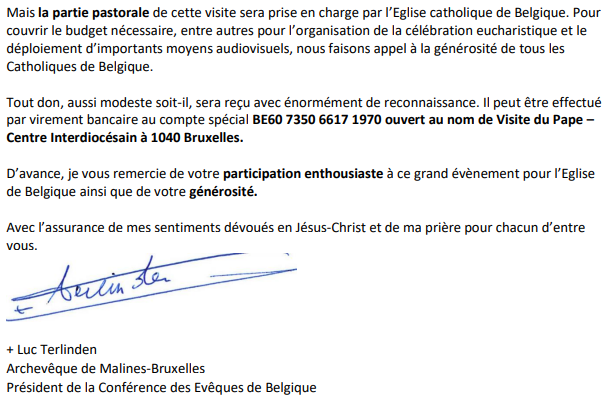Le primat de l’apôtre Pierre et de ses successeurs est l’une des grandes questions ouvertes qui divisent toujours les catholiques, les protestants et les orthodoxes.
Le 13 juin dernier, le Dicastère pour l’unité des chrétiens présidé par le cardinal Kurt Koch a publié un document d’étude qui tire le bilan des trente années de dialogue œcuménique ayant suivi l’encyclique de Jean-Paul II « Ut unum sint » de 1995, qui appelait à trouver « ensemble » les formes dans lesquelles le ministère de l’évêque de Rome « puisse réaliser un service d’amour reconnu par les uns et les autres ».
L’époque actuelle n’est certes pas la plus pacifique en matière de relations entre les différentes confessions chrétiennes, surtout entre l’Occident et l’Orient.
Mais entretemps, il y a un primat du pape non pas « ad intra » mais « ad extra », c’est-à-dire non pas au sein de l’Église ou des Églises mais pour le grand public sur la grande scène mondiale, qui est en train de vivre une saison très particulière.
Le Pape François a déjà donné un avant-goût de ce « spectaculum » singulier dans les heures qui ont suivi la publication du document théologique en question sur le primat du pape.
Pour comprendre ce qui s’est passé, il suffit de reparcourir l’agenda papal très chargé du 15 juin, une journée à couper le souffle pour un homme de 87 ans à la santé chancelante.
De bon matin la scène s’est ouverte par un prélude, constitué de l’accueil par François au Vatican, à la salle Clémentine, d’une centaine d’acteurs comiques issus de quinze pays du monde, dont une douzaine venant des États-Unis, certains jouissant d’une grande notoriété, tels que Whoopi Goldberg.
Le Pape y a tenu un discours pour faire l’éloge du sourire, il a conclu en demandant de prier pour lui « en sa faveur et pas contre » comme il le dit de plus en plus souvent ces derniers temps. Puis il les a salués un par un.
L’élément curieux de cette audience, c’est qu’aucun des invités n’a su expliquer pourquoi il avait reçu cette invitation de la part du Vatican, ou plus précisément du Dicastère pour la culture, présidé par le cardinal José Tolentino de Mendonça. L’invitation était une surprise pour tous. Parmi eux figuraient bon nombre d’anticléricaux acharnés et l’accueil n’était certes pas comparable à celui d’une messe du dimanche. Et pourtant ils ont tous massivement répondu oui à l’invitation. Et cela pour une seule et unique raison : le pape.
Il est difficile de trouver quelqu’un d’autre, dans le monde, qui jouisse d’une telle capacité d’attraction, pour offrir en échange non pas tellement un discours de rigueur et une poignée de mains de quelques secondes, mais simplement sa propre personne, c’est-à-dire le fait qu’il soit le pape.
François le sait. Et il pense même que sur la scène mondiale, cela suffit, et qu’il n’est pas toujours tenu à offrir de lui-même autre chose qui n’appartienne déjà au langage du monde. Il suffit qu’il soit le pape, avec toute cette puissance d’image modelée par des siècles d’histoire.
Quant au faible de François pour quelques acteurs comiques italiens qu’il affectionne tout particulièrement, allant jusqu’à s’identifier avec eux, elle est sous nos yeux à tous. Le vénérable Lino Bafi, que le Pape qualifie de « grand-père de l’Italie » et prophète de sagesse, est fréquemment son invité à Sainte-Marthe et aux liturgies pontificales. Et l’acteur oscarisé Roberto Benigni peut quant à lui s’enorgueillir de deux rencontres révélatrices avec le pape : la première le 7 septembre 2022 : dans une chaleureuse audience filmée dans laquelle il a illustré l’une de ses émissions télévisées sur le Cantique de saint François programmée pour le lendemain, fête de l’Immaculée Conception ; la seconde le 26 mai 2024, où il a été jusqu’à confier à l’acteur comique une homélie supplémentaire de vingt minutes place Saint-Pierre, à l’issue de la messe célébrée par François à l’occasion de la journée mondiale des enfants.
Pour en revenir à l’agenda du Pape François du 14 juin, au prélude matinal de la rencontre avec les comiques a fait suite un intermède lui aussi bien chargé, avec deux audiences relevant typiquement de la compétence du pape : le président de la République du Cap Vert et les évêques de Guinée Équatoriale en visite « ad limina ».
Après quoi, François s’est envolé en hélicoptère en direction des Pouilles pour rejoindre la station balnéaire de Borgo Egnazia où se déroulait le G7, ce groupe intergouvernemental informel réunissant les sept principales économies des pays développés : Canada, France, Allemagne, Japon, Italie, Royaume-Uni et États-Unis, rejoints cette fois-ci par une dizaine de dirigeants d’autres pays et organisations internationales importants.
Et c’est à rien de moins qu’au Pape – invité par le chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui assure la présidente tournante du G7 – qu’il est revenu d’ouvrir en début d’après-midi la session de travail commune, avec un discours sur l’intelligence artificielle en tant qu’ « outil fascinant et redoutable » et de « ses effets sur l’avenir de l’humanité ».
Le Pape François a lu le discours dans une version abrégée, proposant aux invités le texte intégral, rédigé par le franciscain Paolo Benanti, un expert de réputation internationale en la matière qui est chargé de mission aux Nations Unies. Il a parlé pendant une vingtaine de minutes devant tous les leaders qui l’écoutaient autour d’une grande table ovale. En arrivant, il les a salués un par un, embrassant très chaleureusement son compatriote argentin Javier Milei et l’Indien Narendra Modi.
En soir, la participation du pape au G7 constitue déjà une première absolue, avec le traditionnel rituel de la photo de groupe avec lui au centre. Mais en plus de cela, François a eu, avant et après son discours, pas moins de neuf entretiens bilatéraux, avec dans l’ordre : Kristalina Georgieva, la présidente du Fonds Monétaire International, l’Ukrainien Volodymyr Zelensky, le Français Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau, l’Indien Narendra Modi, le Turc Recep Tayyip Erdogan, le Kenyan William Samuel Ruth, le Brésilien Luis Inácio Lula da Silva et l’Américain Joseph Biden.
Quand François est rentré à Rome en hélicoptère, la nuit était tombée et les images de lui au G7 avaient déjà fait le tour du monde, pas tant pour son discours – construit avec compétence mais uniquement circonscrit au thème, sans aucune référence à Dieu et à la « loi morale naturelle qu’Il a inscrite dans le cœur de l’homme » (Benoît XVI, « Caritas in veritate ») – que pour sa simple présence au milieu des puissants de la terre, non seulement d’Occident mais également de pays-clés du « Global South » comme l’Inde et le Brésil. En Inde, son accolade avec le président Modi a immédiatement été interprétée en matière de politique interne comme un point en faveur du gouvernement contre l’opposition.
Parmi les chefs religieux, il n’y a personne au monde susceptible de rivaliser avec ce pouvoir d’image extraordinaire, stellaire, du Pape, incarné jusqu’à l’excès par Jorge Mario Bergoglio même, dans une période de déclin du christianisme et de divisions entre les Églises.
Pour mieux percevoir la distance entre lui et son prédécesseur, il suffit de se rappeler qu’on avait interdit à Benoît XVI, à la suite de l’opposition d’un grand nombre de professeurs, dont un futur prix Nobel, de mettre les pieds dans l’université « La Sapienza » de Rome, où le 17 janvier 2008 il était censé prononcer un discours engagé dans la foulée de celui prononcé deux ans plus tôt à Ratisbonne.
Parmi les observateurs, le vaticaniste américain John Allen a pointé du doigt la contradiction entre d’une part le redimensionnement prévisible du primat du Pape si l’on parvenait à une réconciliation entre les confessions chrétiennes et d’autre part le triomphe persistant, pour ne pas dire grandissant, de l’image du Pape sur la scène internationale : « la ressource singulière la plus précieuse que la chrétienté ait à sa disposition ». Oui, mais au prix de s’assimiler au monde ?
———
Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.
Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur Diakonos.be en langue française.
Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.