Le 6 mai prochain, Mgr A. Léonard fêtera son quatre-vingtième anniversaire.
Anciens étudiants de Mgr à l'UCL, Monsieur l'Abbé Eric Iborra (paroisse Saint-Roch, Paris) et Isabelle Isebaert qui a été directrice de l'Ecole de la Foi (Namur), ont conçu le projet de lui offrir, à cette occasion, un volume de Mélanges, hommage de gratitude à celui qui fut, pour beaucoup, un guide avisé et un courageux confesseur de la foi.
Ce volume sortira, comme prévu, en mai 2020 pour l'anniversaire de Monseigneur, sous le patronage des cardinaux Erdö et Müller, et du professeur Rémi Brague. Il contient les contributions d'une quarantaine d'auteurs, philosophes et théologiens pour la plupart (au nombre desquels par exemple : le cardinal Müller, Rémi Brague, Stéphane Mercier, Mgr Pascal Ide, Mgr Warin, Mgr M.Schooyans, le Père J.M Verlinde, Mme Carine Brochier, M. Michel Ghins , le P. B. Pottier, le Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine...) et compte plus de 600 pages.
Pour financer les coûts d'édition, l'ouvrage est proposé en souscription, au prix de 20 € seulement et les souscripteurs ont, s'ils le souhaitent, la possibilité de figurer dans la tabula gratulatoria et de s'associer ainsi nommément à l'hommage rendu à Monseigneur Léonard.
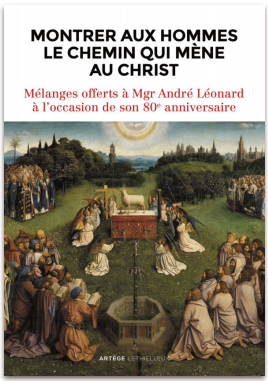
Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ
Mélanges offerts à Mgr André Léonard,
archevêque émérite de Malines-Bruxelles, à
l'occasion de son 80ème anniversaire
Parution : 20 mai 2020
ISBN : 978-2-249-91046-3
676p. - 29 €
« Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ » : telle est, selon les termes du pape émérite Benoît XVI dans une lettre-préface, la façon dont Mgr André Léonard a vécu sa vocation de prêtre et de professeur. Publié à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le 6 mai 2020, ce recueil d'études se veut un témoignage de gratitude envers celui qui fut, pour beaucoup, un maître de vérité chrétienne et un guide sûr en des temps de grande confusion.
Près de quarante confrères et amis se sont associés à cet hommage, offrant ainsi un vaste panorama d'essais sur la théologie des sacrements et la figure du prêtre, l'histoire de la philosophie, la métaphysique (vérité, don et amour), l'éthique (dignité et vocation de l'homme), l'écologie, l'art et la littérature, la fin des temps (« Viens Seigneur Jésus ! »).
En souscrivant dès à présent, vous pouvez acquérir le volume au prix de 20 € (hors frais de port) et contribuer ainsi au financement de l’édition. Si vous le souhaitez, votre nom figurera dans la Tabula gratulatoria insérée dans l’ouvrage. Dans ce cas, n’oubliez pas de cocher la case correspondante ci-dessous et d’y indiquer le titre de civilité (M, Mme, Mlle, Sœur, Père…) qui doit accompagner votre nom. Les souscriptions doivent nous parvenir au plus tard le 10 avril 2020.
O Je souhaite figurer dans la Tabula gratulatoria avec le titre de civilité ………………...................
----------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE à retourner à Elidia - 9, espace Méditerranée 66000 Perpignan
Je commande ........ exemplaire(s) de «Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ» au prix de 20 €
COORDONNÉES
Nom .........................................................
Prénom ...................................................
Adresse ...................................................
................................. CP ...........................
Ville .............................. Pays ..................
Courriel ...................................................
Téléphone ...............................................
RÈGLEMENT
❏ Chèque bancaire ou postal à l’ordre de Elidia
❑ Carte bancaire n°.............................. expire fin .................. n° de contrôle ......................
❑ Virement à Elidia : IBAN : FR76 3000 4007 5300 0103 1965 648
Date et signature
Frais de port : France métropolitaine et Belgique + 5 € - dans les autres pays + 10 €



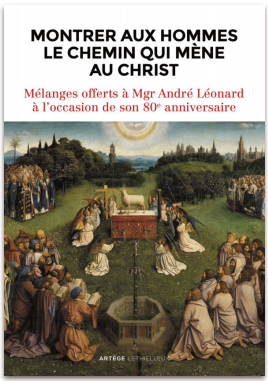



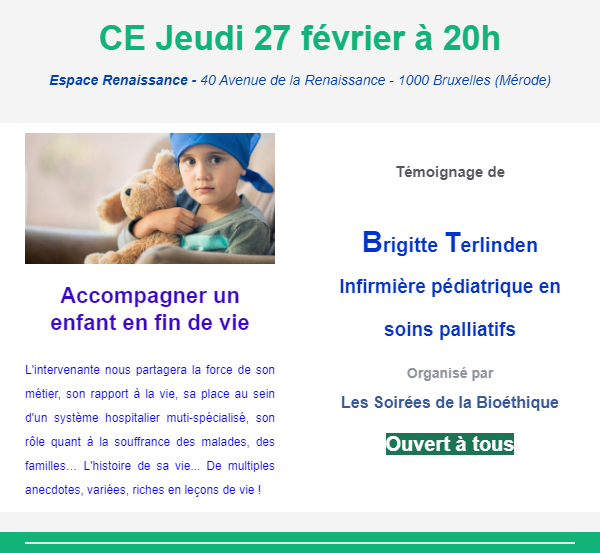

La Sainte Eglise Une Divine Catholique Romaine et...