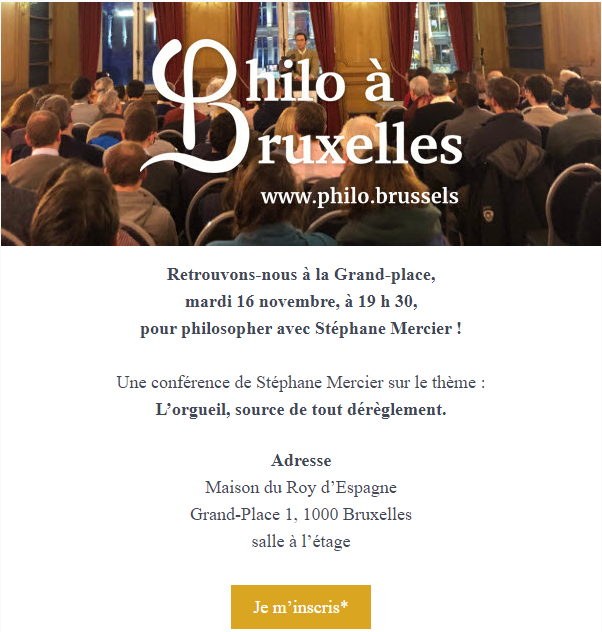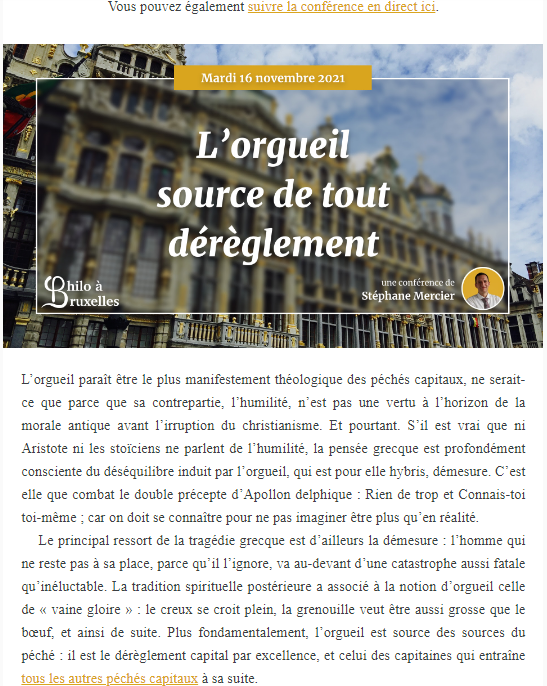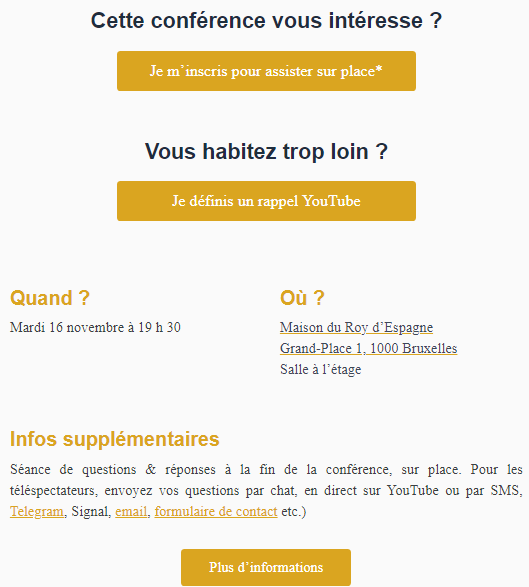Les évêques de France, réunis à Lourdes, ont décidé vendredi de “reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église” dans les agressions sexuelles subies par des milliers de victimes [au passage, je note que l’AFP n’assume pas le chiffre de 216 000 victimes, que tout le monde ressasse sans trop comprendre d’où il sort, note de GT] et la “dimension systémique” de ces crimes, a annoncé vendredi leur représentant, Mgr Eric de Moulins-Beaufort.
Et, un peu plus bas, l’AFP ajoute que Mgr de Moulins-Beaufort aurait précisé que ces actes pédocriminels “ont été rendus possible par un contexte général, des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de l’Église”.
Disons-le tout net: je butte sur cette “dimension systémique” et cette “responsabilité institutionnelle”. J’avoue que je ne comprends pas ce que cela signifie – ou plutôt que j’ai peur de trop bien comprendre!
Si l’on entend par là, que tous les diocèses et paroisses de France seraient collectivement responsables des crimes commis par moins de 2% des clercs, ce serait évidemment à la fois absurde et monstrueux. Comment rendre responsable une écrasante majorité d’innocents de crimes aussi abominables? La justice consiste à condamner les coupables et à réparer le préjudice subi par les victimes, pas à condamner en bloc des innocents – et trop de prêtres amis ou inconnus m’ont dit leur douleur d’être ainsi cloués au pilori par une opinion publique manipulée par des personnes profondément hostiles à l’Eglise (dont le moins que l’on puisse dire est que le souci des victimes n’est pas toujours la priorité).
De façon générale, je crois beaucoup plus à la responsabilité personnelle qu’à la responsabilité “systémique”. Ce sont les idéologies totalitaires, notamment nazie ou communiste, qui voyaient des culpabilités collectives de race ou de classe, pas les gens civilisés!
Alors que peut-on vouloir dire par cette “responsabilité institutionnelle”? Peut-être veut-on dire par là que la fraternité sacerdotale a empêché un certain nombre de dénonciations et donc empêché de mettre un terme aux agissements criminels de certains clercs. Pour le coup, c’est bien possible. Encore que ma petite expérience de séminariste me laisse supposer que la charité sacerdotale peut aussi s’accompagner d’une profonde détestation: dans tous les milieux où des hommes sont proches les uns des autres, ils nouent des amitiés très profondes, rendant psychologiquement difficile une dénonciation, mais aussi parfois de solides animosités. Et j’ai peine à croire qu’un prédateur, qui aurait bénéficié de protections de la part de ses confrères ou de ses supérieurs, n’ait jamais rencontré un confrère beaucoup moins amical… Si M. Sauvé se souvient de son expérience de noviciat, je doute qu’il soit dupe de cette présentation qu’il entretient d’une sorte de “corporation ecclésiastique” totalement unie et formant un bloc soudé face au monde extérieur!
En tout cas, de toute évidence, la plupart des chacals médiatiques ont compris la notion de “responsabilité institutionnelle” comme un engagement solidaire à dédommager les victimes. Mais cela pose au moins deux problèmes.
Le premier, c’est de savoir comment nous saurons que telle personne a réellement été victime de tel clerc. Dans la situation actuelle, je ne vois que la justice pénale séculière qui soit à même de trancher ce genre de questions. Mais ladite justice ne connaît pas de “responsabilité institutionnelle”: elle connaît des victimes, des coupables et éventuellement des complices. Pour ma part, je trouve plus que normal que les coupables paient pour leurs crimes. Je ne vois pas davantage d’inconvénient à ce que les clercs qui auraient dissimulé les crimes de leurs confrères ou subordonnés soient condamnés pour complicité. Mais je ne peux pas imaginer une situation où n’importe qui se disant victime pourrait demander réparation à n’importe quel diocèse ou paroisse. Je dis: “se disant”, non pour minimiser le préjudice subi par les véritables victimes, mais parce que, sans le passage de la justice, nous ne pouvons pas savoir si une personne est réellement victime ou affabulatrice ou encore détestant l’Eglise et voulant la faire “cracher”! Je rappelle que, parmi les innombrables problèmes méthodologiques du rapport Sauvé, figure le fait que les quelques 3000 victimes que l’on présente comme avérées se sont, pour la plupart, auto-déclarées. Cela ne signifie pas qu’elles ne soient pas victimes; cela signifie juste que nous n’avons que leur parole – sans rien savoir de la parole de la défense (qui peut même ignorer totalement être ainsi accusée). Comme disait l’abbé Viot dans une émission que j’animais récemment sur TV Libertés, il ne suffit pas de balancer des nombres, il faudra bien donner des noms (de coupables et de victimes) et des faits.
Le deuxième problème, c’est que les biens de l’Eglise n’appartiennent pas aux clercs. Si l’on admettait – quod Deus advertat! – qu’il soit juste que les innocents paient pour les coupables, on ne pourrait se tourner, que je sache, que vers deux sources de financement: le denier du culte ou le patrimoine de l’Eglise. Mais le denier du culte, comme son nom l’indique, sert à permettre aux clercs de nous donner les sacrements. Il permet que le prêtre vive de l’autel, selon la plus antique tradition, non seulement chrétienne, mais même juive et païenne. Il serait insensé de priver des prêtres innocents de leurs moyens de vivre pour dispenser des coupables de répondre de leurs actes criminels! Au passage, je puis sans grand risque prophétiser que l’Eglise de France, qui a déjà un grave problème de denier du culte en ce moment (les recettes se sont effondrées avec la crise sanitaire), connaîtrait un effondrement pire encore. Pour ce qui me concerne, il est clair que, si, demain, j’apprenais que mon denier servait à financer les conséquences des turpitudes de certains clercs, je ne le donnerais plus et le transformerais en dons directs à certains prêtres de confiance – et évidemment, c’est mon diocèse qui en serait instantanément pénalisé. L’autre source de financement serait le patrimoine de l’Eglise. Ou plutôt ce qu’il en reste après les spoliations révolutionnaires et républicaines, notamment celles de 1790 et de 1905. D’abord, je doute que cela suffise. Je suis d’ailleurs étonné que personne ne parle d’ordre de grandeur: si l’on admet le chiffre de 216 000 victimes et en supposant que la moitié soit encore vivantes, et même si l’on admettait que l’indemnité moyenne soit de 100 000 euros, ce qui ne me semble pas très important pour un viol, cela impliquerait des dépenses de réparation de l’ordre de 10 milliards d’euros. Croit-on vraiment que les diocèses de France disposent d’un tel patrimoine, alors que la moitié sont déjà en faillite ou proches de la faillite? Au passage, je rappelle aussi que la commission Sauvé, qui fut si généreuse sur le nombre de victimes, n’a fait que 22 signalements à l’autorité judiciaire – le chiffre a assez peu circulé, mais il me semble très significatif du nombre de cas réellement avérés que la commission a eu entre les mains. Mais, même si l’on admettait que les diocèses avaient les moyens financiers de payer de telles sommes à un tel nombre de victimes, il y a un droit: le patrimoine de l’Eglise a été légué en vue d’une fin cultuelle, charitable ou autre. Si l’on détourne le leg de sa fin, la justice exige qu’il revienne aux héritiers du légataire.
En un mot, il serait sage de dire au plus vite que l’interprétation médiatique commune de cette “responsabilité institutionnelle” est infondée. Sans quoi nous nous avançons vers des problèmes sans fin. En tout cas, chers amis, prions pour nos prêtres, ils en ont grand besoin – de façon générale, mais tout spécialement en ce moment! Et prions pour que notre Sainte Mère l’Eglise (même ainsi défigurée par les péchés de ses enfants et les crachats de ses ennemis, elle reste sainte!) sorte purifiée de cette effroyable épreuve.