Le site web de la Libre Afrique publie ces libres propos de Jean-Luc Vellut
 « À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration.
« À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration.
Au plan de l’information historique, le peu qui filtre de la réflexion en cours suscite des inquiétudes, et ceci, dans chacun des deux piliers qui structurent l’argumentation qu’on nous laisse prévoir.
Pilier 1. Les historiens belges auraient jusqu’ici négligé les sources africaines. Le Musée rénové entend remédier à cette lacune. Cette affirmation est étonnante, alors que les scientifiques belges ont joué un rôle d’avant-garde dans la collecte, la publication et l’interprétation critique des sources africaines, orales ou écrites. On aurait plutôt attendu d’un musée belge qu’il rende hommage à la génération pionnière des D. Biebuyck, G. Hulstaert et J. Vansina qui, grâce à l’appui de collaborateurs congolais, ont à leur crédit la collecte de milliers de pages de sources historiques africaines. Notons que, grâce à ses travaux sur l’oralité dans le bassin du Congo, Vansina fut le mentor d’une génération de professeurs d’universités américaines. La toute prochaine session de l’African Studies Association (Chicago, 15-19 novembre 2017) lui rendra un hommage appuyé.
Depuis ces grands ancêtres, et dans la mesure de leurs moyens, d’autres historiens, belges, congolais ou autres, se sont efforcés de faire honneur à cet héritage. Ils se sont aussi distingués par leur recours aux sources africaines, notamment contemporaines. Ce fut le cas de l’école historique de Kinshasa-Lubumbashi, comme en témoigne l’attribution récente d’un doctorat honoris causa à un autre savant belge, Léon Verbeek, en reconnaissance de ses travaux sur les sources africaines, orales et artistiques, dans le Haut-Katanga. Pour ses propres contributions au domaine des sources populaires, B. Jewsiewicki, autre membre en vue de cette école, fut honoré à la même occasion. J’ajoute pour bonne mesure que l’on doit à un historien belge, David Van Reybrouck, d’avoir placé les témoignages africains au coeur de son livre, « Congo. Une histoire » : immense succès de librairie, plus de 700 000 exemplaires vendus en diverses langues dans le monde.
On pourrait sans mal aligner d’autres noms, mais restons-en ici en ce qui concerne le pilier 1 et la pseudo-ignorance en Belgique des sources africaines.
Pilier 2. Les historiens belges auraient refusé d’ouvrir un vrai débat sur la colonisation, à la différence de la franchise qui est désormais de règle à propos des crimes commis au cours de la Deuxième Guerre mondiale. La présentation du futur Musée sera conçue comme un « Mémorial » des victimes africaines, à l’instar de ce qui a été entrepris pour les victimes juives des persécutions nazies en Belgique occupée.
Je ne m’attarde pas au parallèle revendiqué entre Deuxième Guerre et colonisation. Cette perspective est sans aucune signification pour l’Afrique. Elle est odieuse en Europe. Il est cependant exact que, pendant de longues années, les institutions d’État en Belgique, tout comme un enseignement scolaire encombré d’un nationalisme étriqué, ont fait obstacle aux investigations indépendantes concernant la colonisation. Ce déni a tranché avec la dénonciation des violences en Afrique coloniale, jadis courantes en Belgique durant le règne même de Léopold II : n’allez pas là-bas , selon le titre évocateur d’un ouvrage publié dans la Belgique de l’époque.
En Belgique, il y a toutefois bon temps que la libre discussion a repris ses droits. Elle a été amorcée par un grand savant, Jean Stengers. Elle reprit avec vigueur dans les années 1980, mais dans un premier temps, elle prit un ton polémique. Les publications se multiplièrent en effet, dues à des chercheurs « engagés » qui se présentèrent comme chroniqueurs des crimes coloniaux. Leurs exposés ont alimenté la production de divers publicistes, journalistes, littérateurs. Ces réquisitoires, souvent complaisants dans l’horreur, connurent une diffusion mondiale. Celle-ci contribua à confirmer la formidable charge symbolique qu’a toujours portée le Congo dans les publics occidentaux.
Tenir la chronique d’atrocités, personnifier la discussion à outrance autour d’un homme, Léopold II, ne revient toutefois pas à faire un travail d’historien, loin s’en faut. Aujourd’hui, le sensationnalisme n’est plus nécessairement maître du terrain. La vérité toute simple émerge que la compréhension du régime léopoldien doit prendre en compte différents héritages, non seulement les héritages venus d’Europe – et, en effet, les rêves d’introduire le progrès en Afrique furent tôt pervertis par des vagues de spéculations au sein du capitalisme mondial –, mais aussi les héritages de l’Afrique du temps. L’État du Congo s’est en effet inscrit à la fois dans les multiples strates de l’expansion occidentale à l’échelle mondiale, mais aussi, localement, dans le vaste arc des Frontiers of Violence (R. Reid, 2011) : dans les années 1870-1890, ces frontières étendirent leur chaos, du sud de l’Éthiopie au Sud-Soudan, du Rwanda aux Grands Lacs, et de ceux-ci jusqu’au Haut-Zambèze. Sur le terrain, poursuivi à coup d’alliances, de retournements, d’opportunisme, le grandiose projet géopolitique d’un État-Congo finalement survécut à ces tourmentes, mais au prix d’avoir pour un temps emprunté au brutal chaos des « Frontières ».
En Belgique comme ailleurs, cette perspective sollicite aujourd’hui les chercheurs les plus avertis. Elle est sans doute plus dérangeante que le ronron des récits moralisateurs. Elle paraît d’autant plus évocatrice que le Congo du temps présent est, lui aussi, livré aux même spéculations qui ont jadis dicté leur loi à l’État léopoldien : à nouveau, dans le Congo du XXIe siècle, l’État est faible et les puissants s’abritent derrière leurs murs d’argent, tandis que les nouvelles Frontiers of Violence sombrent dans le chaos.
Concluons ce rapide parcours du pilier 2. Le scénario qui semble retenu par le Musée ne rend pas justice aux débats du travail historique actuel. Dans le langage d’aujourd’hui, il se montre complaisant au monde des fake news.
En conclusion, si on en juge par ce qui est connu des projets en cours, que dire du volet historique au sein du futur Musée rénové ?
Il paraît aller de soi que cette grande institution, unique en son genre, doit activement contribuer à éclairer le passé africain, précolonial, colonial, postcolonial. Il serait toutefois à la fois absurde et indécent de renoncer pour autant à mettre en pleine lumière le passé de ce que fut la diaspora belge en Afrique. Dès ses moments fondateurs (Léopold II, toujours lui !), avec ses hauts et ses bas, avec évidemment les accents de l’époque, le Musée a existé comme manifestation tangible de la part de la Belgique dans l’histoire du Congo moderne et de la part du Congo moderne dans l’histoire de Belgique.
Différentes généalogies historiques sont donc en présence. Venues d’Europe ou d’Afrique, elles sont complexes, elles plongent leurs racines dans des passés, souvent lointains. Elles ne demandent évidemment pas à être abordées dans un esprit, tantôt d’exaltation puérile, tantôt de pénitence tartuffe.
Soyons clairs : il n’est d’autre alternative que de chercher la vérité et le Musée devrait y contribuer. Cette vérité fut celle d’ingénieurs, de médecins, de savants, de cadres, de techniciens, de religieux et religieuses, d’artistes et artisans belges qui ont mené au Congo colonial leur vie de travail, avec ses réussites et ses échecs. Cette vérité est tout autant celle de cadres, de techniciens, d’ouvriers, de cultivateurs et de cultivatrices, de notables, de religieux hommes et femmes, d’artistes et artisans congolais qui, eux aussi, longtemps méconnus, ont eu leurs réussites et leurs échecs. En régime colonial, cette rencontre fut inégale, mais elle donna naissance au Congo moderne et, en réalité, le Musée actuel en est issu.
Certes, le système colonial tel qu’il a fonctionné à l’échelle de l’Afrique comptait plus que sa part d’aventuriers, blancs et noirs. Certes, la logique coloniale ne répond pas aux aspirations d’aujourd’hui. Le système global tel qu’il fonctionne au Congo du présent ne répond pas non plus aux critères d’une société juste. Regardons-y donc à deux fois avant de jeter la première pierre. Si l’on tient absolument à jeter un regard moral sur le passé du Congo, la cohérence exigerait de soumettre à nos jugements l’ensemble de son histoire, que ce soient les temps précoloniaux, coloniaux ou postcoloniaux. Est-ce le rôle d’un musée de jouer le rôle d’un tribunal ? Je ne le pense pas.
À ce stade-ci, on peut risquer quelques pronostics. Celui d’abord que l’ouverture du Musée connaîtra un grand succès esthétique et matériel. Un immense effort a été consenti pour qu’il en soit ainsi. On s’en félicitera sans réserve.
Par ailleurs, telle que nous la connaissons aujourd’hui, la présentation de son héritage dans le Musée rénové est à la fois insuffisamment informée et empreinte de ressentiments. La pratique du lock out des opinions divergentes y est si profondément incrustée que l’on se croit revenu aux beaux jours de la censure d’État.
Les conditions d’un flop sur le plan scientifique et sans doute humain sont donc réunies.
Faut-il pour autant perdre tout espoir ? « Voyez ce qui se passe, les choses »n’auraient pas pu aller plus mal », dit le pessimiste. « Mais si, mais si », répond l’optimiste. Au bout du compte, le travail historique possède une résilience et, tôt ou tard, la vérité l’emporte toujours.
Jean-Luc Vellut
Professeur d’Histoire de l’Afrique, retraité des universités du Congo (1964-1976) et de l’UCL (1976-2002)
Responsable scientifique de l’exposition Mémoire du Congo.
Le temps colonial (MRAC, 2002-2005)
Ref. Rénovation du Musée royal de l’Afrique centrale
Même « Congo, une histoire », recueil louable de témoignages indigènes mais (volontairement?) crédule par certains côtés, publié par David Van Reybrouck en 2012 chez Acte-Sud est, de bout en bout, sous-tendu par un préjugé anticolonial auquel pourra difficilement souscrire un Belge qui a vécu au Congo non pas au temps aventureux des pionniers de l’Etat indépendant (1885-1908) mais d’une expansion économique et sociale ordonnée et pacifique qui fut ruinée, en quelques mois à peine, par la médiocrité politique d’une métropole pressée d’abandonner ses responsabilités au cœur de l’Afrique pour se concentrer sur les questions communautaires et linguistiques plus proches du niveau de ses préoccupations .
JPSC



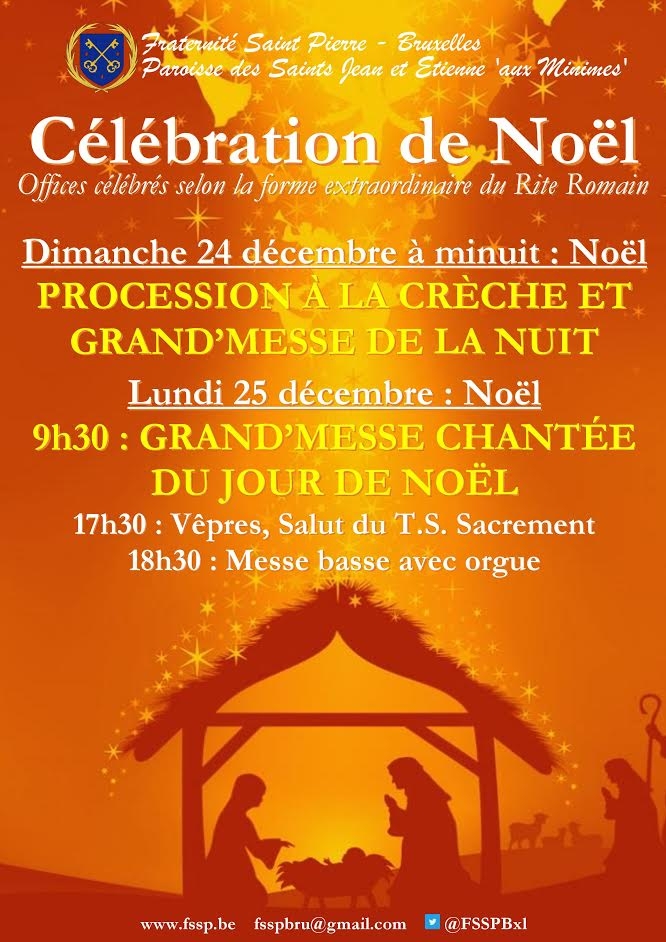




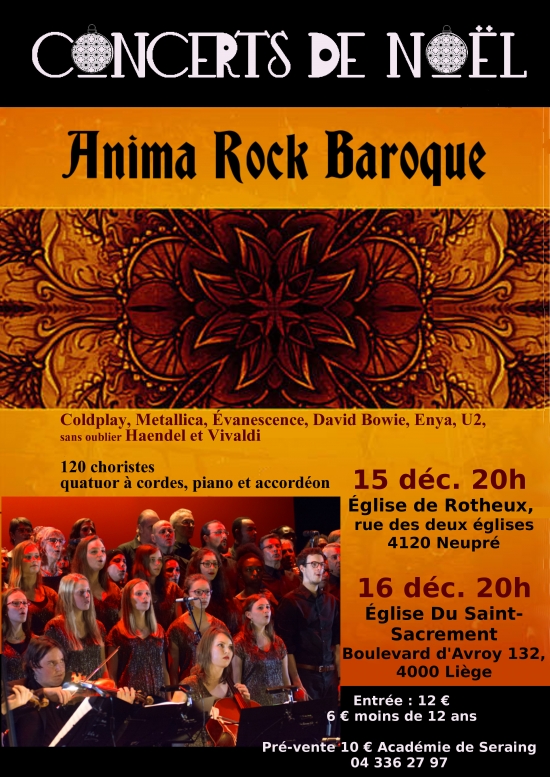

 « À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration.
« À propos de ce qu’on connaît des lignes maîtresses du projet de présentation du volet historique par le MRAC rénové et de leurs conditions d’élaboration. Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)
Lu sur le site du Centre d’Action Laïque (C.A.L.)