« Nous ne maitrisons pas quelles peuvent être les conséquences à moyen et long terme de l’édition du génome humain » a rappelé Elena Postigo mardi dernier au cours d’une conférence sur « les nouveaux défis du XXIe siècle dans le domaine de la bioéthique ». Elena Postigo est professeur pour le Master en bioéthique de l’Université catholique de Valence (UCV) et directrice de l’Institut de bioéthique de l’Université Francisco de Vitoria de Madrid (UFV). « Un énorme champ de possibilités s’ouvre devant nous, y compris sur le plan thérapeutique, mais nous devons agir avec beaucoup de prudence » explique-t-elle. Refusant la diabolisation de la science et des technologies, « au service de l’humanité », elle rappelle la nécessité d’en faire « bon usage », « toujours au service des personnes et des générations futures ».
L’approche personnaliste
Pour apporter des réponses aux questionnements bioéthiques, actuels et futurs, Elena Postigo propose l’approche dite « personnaliste », dans les pas de l’Italien Elio Sgreccia : « le personnalisme place la personne au centre de la bioéthique, comprise comme un être ayant une valeur intrinsèque particulière, et non comme la manifestation de ses accidents, qu’il s’agisse de la couleur de sa peau, de sa taille, de son âge, de sa qualité de vie ou de son état de santé, entre autres ». Toute personne reste alors une personne, « quelles que soient les circonstances », même en cas d’impossibilité d’agir ou de réfléchir, même en cas d’état végétatif chronique[1]. « Du point de vue de la bioéthique, cela implique que vous devez être respecté lorsque vous êtes dans cet état ».
Le personnalisme ontologique, qui « s’articule autour du concept de personne et de dignité », s’oppose à l’utilitarisme et au principalisme, car il repose sur une définition de la personne « à partir d’un fondement métaphysique et non en termes fonctionnels » : « nous ne sommes pas seulement devant un être qui pense, mais devant un être qui est, avant de penser, et digne en toute circonstance de son existence ». L’utilitarisme et le principalisme, au contraire, vont considérer que dans certaines circonstances, la vie humaine ne serait « pas digne », ce qui peut amener à justifier, par exemple, la recherche sur l’embryon humain, la modification de son génome, ou encore l’euthanasie de certaines personnes.
Du personnalisme, au contraire, découlent plusieurs principes éthiques, explique Elena Postigo : « le respect de la vie humaine en toutes circonstances, de la conception à la mort naturelle ; le respect de sa corporéité, en comprenant le corps comme quelque chose d’intégral ; le respect de sa liberté et de la responsabilité qui en découle ; et le principe de justice et de solidarité ».
Bioéthique contemporaine : d’autres grands défis à relever
En plus de l’édition du génome des embryons humains, la spécialiste mentionne trois grands défis contemporains pour la bioéthique : les nanotechnologies appliquées aux humains, l’utilisation de l’intelligence artificielle en médecine et la fin de vie humaine.
La question des nanotechnologies est cruciale si celles-ci sont utilisées au niveau du cerveau, et appliquées à la « dimension neuronale et cognitive » de la personne. Il pourrait s’agir par exemple d’un implant limitant les effets d’une maladie neurodégénérative, ou bien de la nanopuce Neuralink d’Elon Musk qui espère améliorer les capacités cognitives, voire réparer certaines lésions cérébrales. « Toutes ces propositions soulèvent des doutes bioéthiques » alerte Elena Postigo.
L’intelligence artificielle en médecine, quant à elle, peut avoir des applications « formidables », et apporter des améliorations « de diagnostic et de pronostic ». Mais la capacité thérapeutique ne s’améliorera pas forcément à la même vitesse. Ainsi, « de nombreuses maladies peuvent être diagnostiquées, mais pas guéries ». La fin de vie humaine, enfin, représente le dernier grand défi bioéthique du XXIème siècle, notamment sur les questions de l’euthanasie et la cryogénie, c’est-à-dire « le maintien d’un corps après la mort ».
Selon l’approche personnaliste, « les critères éthiques fondamentaux qui devraient être appliqués face aux défis bioéthiques susmentionnés » sont « le respect de la vie, le fait de ne pas nuire, le respect de la justice et la responsabilité envers les générations futures » conclut Elena Postigo.
[1] L’état végétatif chronique, ou EVC, est un terme qui a une connotation très négative. Il gagnerait à être remplacé par celui de “syndrome d’éveil non répondant ” proposé par le Pr Cohadon (Bordeaux) en 2010. Cependant le terme d’EVC, usité en France depuis presque 50 ans, reste couramment employé.
Sources : Observatorio de Bioética (10/06/2021)



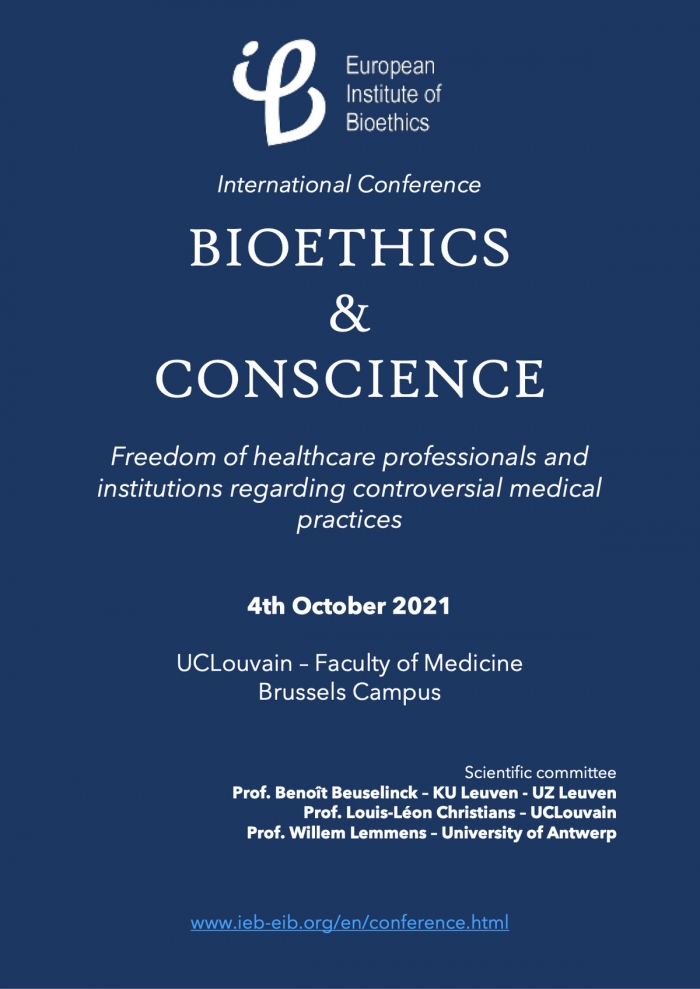
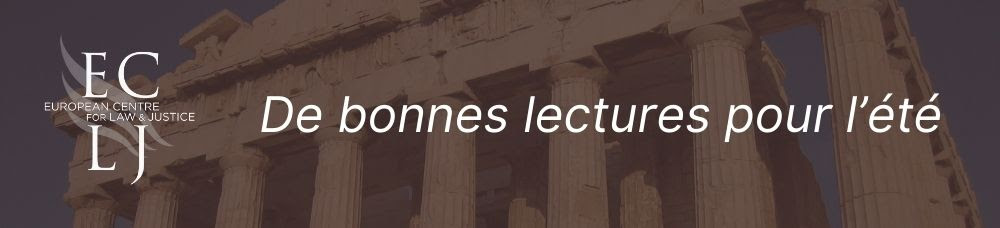
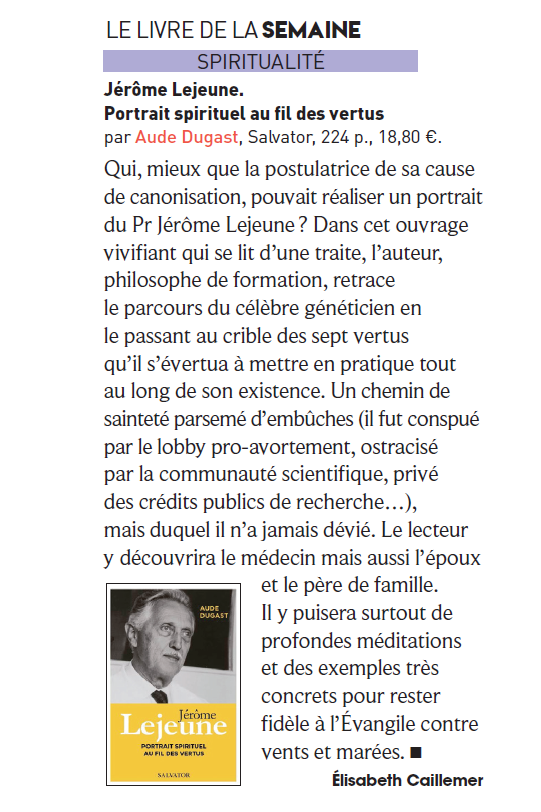
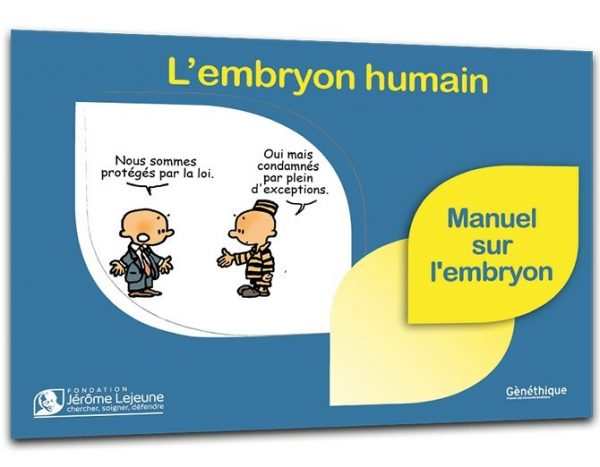
 Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :
Le débat euthanasique n’a hélas plus cours en Belgique : le pire est advenu et l’opinion inerte est chloroformée depuis longtemps déjà. Il n’en va pas encore de même en France. Entre autres, l’écrivain Houellebecq démontait, voici peu, la manipulation du discours publicitaire euthanasique avec l’objection retentissante d’un seul mot : la morphine. Oui, mais encore ? L’absence de douleur ne donne pas nécessairement un sens à la vie. Voici un commentaire D’Henri Quantin, lu sur le site web « aleteia » (21 avril 2021) :