Du site de la Tribune de l'Art :
Une nouvelle menace plane sur Notre-Dame de Paris : ce que l’incendie a épargné, le diocèse veut le détruire
Mais aujourd’hui, cette résurrection est gravement compromise par un projet d’aménagement de l’intérieur du monument. Le diocèse de Paris veut en effet profiter du chantier de restauration pour transformer l’intérieur de Notre-Dame en un projet qui en dénature entièrement le décor et l’espace liturgique. Il estime ainsi que les destructions de l’incendie sont l’occasion de transformer l’appréhension du monument par le visiteur, alors même que celui-ci s’est limité à la toiture et à la flèche et n’a rien détruit de patrimonial à l’intérieur.
Ces propositions de modifications affectent le mobilier, l’éclairage et la circulation. Les auteurs de ce projet cherchent à mettre en place un autre parcours, une autre expérience du monument, alors même que Notre-Dame offre déjà un parcours, qu’elle est déjà un discours. Pour ne prendre qu’un exemple, l’organisation conçue par Viollet-le-Duc repose sur un principe de gradation des espaces qui existait déjà à la fin du moyen-âge et qu’il a restauré. Les premières chapelles ont un décor sommaire pour permettre une montée progressive vers la splendeur du chœur. Et ainsi de suite. Tout fut savamment pensé et arbitré.
Or ce qu’imagine aujourd’hui le diocèse réduit à néant la conception patiemment élaborée par Viollet-le-Duc. Le projet prévoit l’installation de bancs amovibles, d’un éclairage changeant en fonction des saisons, de projections vidéo sur les murs, etc., autrement dit les mêmes « dispositifs de médiation » à la mode (et donc déjà terriblement démodés) que l’on trouve dans tous les projets culturels « immersifs » où bien souvent la niaiserie le dispute au kitsch.
Ce tragique incendie nous offre pourtant une chance exceptionnelle, une occasion absolument unique : la restauration du décor de Viollet-le-Duc. Nous sommes en effet en mesure de faire renaître un décor d’ensemble cohérent et d’une grande perfection formelle. L’architecte génial, soucieux de prolonger et d’achever le travail des bâtisseurs du moyen-âge, avait conçu une œuvre d’art totale, faisant se correspondre architecture et décor, peinture et sculpture, ébénisterie et orfèvrerie, vitraux et luminaires. Guidé par une vision très précise d’un idéal artistique et spirituel, il avait élaboré et mis en œuvre la cathédrale des cathédrales.
Respectons l’œuvre de Viollet-le-Duc, respectons le travail des artistes et des artisans qui ont œuvré pour nous offrir ce joyau, respectons tout simplement les principes patrimoniaux d’un monument historique. Ce chantier de restauration doit nous permettre de retrouver l’authenticité du lieu et de son expérience, en replaçant les bonnes œuvres aux bons endroits, dans une harmonie et une cohérence d’ensemble.
La France fera l’admiration de tous pour avoir su mener une restauration qui restituera au monde un monument sublime. Nos architectes, nos restaurateurs et tous les métiers d’art auront ainsi, selon les mots du président de la République, rendu Notre-Dame plus belle qu’avant l’incendie, c’est-à-dire aussi sublime qu’elle nous avait été léguée.
Les signatures :
 « Dans l'avion qui le ramenait lundi d'Athènes vers Rome, le pape François a évoqué plusieurs sujets d'actualité devant la presse, il a notamment expliqué pourquoi il avait accepté la démission de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Nous publions la réponse intégrale du pape à cette question sur la base du compte rendu de l'agence romaine de presse I.Media, présente dans l'avion :
« Dans l'avion qui le ramenait lundi d'Athènes vers Rome, le pape François a évoqué plusieurs sujets d'actualité devant la presse, il a notamment expliqué pourquoi il avait accepté la démission de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. Nous publions la réponse intégrale du pape à cette question sur la base du compte rendu de l'agence romaine de presse I.Media, présente dans l'avion :
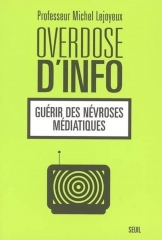 Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.
Michel Lejoyeux dirige le service psychiatrique de l’hôpital Bichat. Voici quinze ans, il publia un petit essai remarqué, Overdose d’info, guérir des névroses médiatiques (Seuil, 2006). À relire par temps de Covid. Le médecin réfléchit aux dépendances à ce que nos grands-parents appelaient « les nouvelles ». Qui pouvait imaginer que l’information fonctionne comme l’alcool ou la cigarette ? Lejoyeux distingue trois symptômes et ceux-ci jouent à plein régime depuis l’épidémie de la Covid.