De Camille de Pommereau sur FigaroVox :
Euthanasie en Belgique : le rouleau compresseur de la pensée unique
FIGAROVOX/TRIBUNE - Camille de Pommereau estime que le débat belge autour de l'euthanasie que l'Institut européen de bioéthique tente d'ouvrir, est entièrement verrouillé par les associations pro-euthanasie.
Camille de Pommereau est juriste en droit public.
L'Institut Européen de Bioéthique (IEB) a publié une proposition de «carte de fin de vie», à commander ou télécharger gratuitement depuis le site de l'IEB. Et voilà que cette simple suggestion suscite l'émoi dans la presse belge. Le Soir, repris par le Journal du médecin, RTL, et maintenant la Libre s'emparent du sujet. L'émotion est grande puisque Le Soir va jusqu'à parler de «guerre des cartes» dans le titre de son article, insinuant une opposition de l'IEB aux déclarations anticipées proposées par l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD).
Les déclarations anticipées, relayées activement par l'ADMD belge, ont été mises en place par une loi en 2002. Elles ont pour but de permettre à une personne de consigner ses volontés pour la fin de sa vie, en prévision de l'hypothèse où elle ne serait plus en mesure de s'exprimer. Il en existe deux formes, l'une en faveur de l'euthanasie, l'autre pour l'arrêt des traitements, en cas de forte dépendance.
Ces déclarations peuvent être enregistrées à la commune. Les fonctionnaires municipaux belges sont donc, malgré eux, les maillons actifs de la chaîne d'acteurs qui banalisent l'euthanasie.
Mais les déclarations anticipées n'offrent aucune possibilité d'affirmer explicitement son refus de l'euthanasie. Bien sûr, l'ADMD rétorquera qu'il suffit de ne rien déclarer pour être contre l'euthanasie. C'est un peu court. Car la déclaration anticipée devrait, pour respecter le libre choix des personnes, intégrer la possibilité de refuser l'euthanasie. Ces déclarations peuvent être enregistrées à la commune. Les fonctionnaires municipaux belges sont donc, malgré eux, les maillons actifs de la chaîne d'acteurs qui banalisent l'euthanasie.
«Saturés d'entendre parler de l'euthanasie comme la seule mort sans souffrance», de nombreuses personnes ont fait entendre leur voix pour demander un outil de communication différent. Carine Brochier explique dans un article de La Libre que c'est comme ça qu'est née la carte de fin de vie de l'Institut Européen de Bioéthique en 2008. «C'est le fruit d'une demande de personnes âgées, de leur famille, mais aussi de médecins et de personnels soignants.»
La carte de fin de vie de l'IEB donne au patient la faculté de réitérer sa confiance dans son médecin et éventuellement l'occasion d'échanger avec lui sur ses vœux pour la fin de sa vie. Elle propose aux personnes, outre leur attachement aux soins et au soulagement de leurs douleurs, de se positionner sur d'éventuelles décisions à prendre en fin de vie, telles que le refus de l'acharnement thérapeutique et de toute forme d'euthanasie. En cas de besoin, le signataire de la carte peut désigner une «personne de confiance», qui «coopérerait à la prise de décision médicale à son égard». La personne peut également y inscrire ses volontés relatives à un éventuel prélèvement d'organes, au mode de funérailles, et demander par anticipation une assistance spirituelle.
En définitive, la carte de fin de vie est un pacte de confiance renouvelée entre le patient et le médecin et sa famille, et la garantie que sa vie sera respectée jusqu'à son terme naturel sans que personne ne lui vole sa mort. En faveur de l'apaisement, elle ne peut que faire du bien. Le succès de la carte est si grand, que l'IEB en est à sa cinquième réimpression depuis 2008.
La banalisation médiatique est telle qu'elle imprègne imperceptiblement les citoyens, particulièrement les plus fragiles. L'euthanasie devient la normalité, alors que la loi la prévoyait initialement comme un geste exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles.
Un glissement est en train de s'effectuer en Belgique. La banalisation médiatique est telle qu'elle imprègne imperceptiblement les citoyens, particulièrement les plus fragiles. L'euthanasie devient la normalité, alors que la loi la prévoyait initialement comme un geste exceptionnel, dans des circonstances exceptionnelles. En attestent les différentes extensions progressives de la loi sur l'euthanasie aux enfants et bientôt aux détenus, aux déments, aux dépressifs?
Etonnant de voir, que le camp des laïques purs et durs se lève dès que quelqu'un en Belgique ose prendre une initiative contre l'euthanasie. Surprenant aussi de constater, qu'en mal d'arguments certains dans le plat pays n'attaquent les opposants à l'euthanasie que sur base de leurs convictions religieuses. Comme si le fait d'être contre l'euthanasie établissait un lien direct avec une croyance, alors que des médias du monde entier ne cessent d'attirer l'attention sur l'horreur législative belge. Il semblait que la laïcité prônait la liberté de penser, d'agir, de débattre.
Dans ce contexte, la carte de l'IEB est un outil qui apaise et rassure, réaffirmant la bonté des soins palliatifs. «Elle mise sur la relation de confiance entre les médecins, la famille et le patient, en mettant les choses au point.» explique Carine Brochier. En ce sens, cette carte est dans la droite ligne de l'article 8 de la loi relative aux droits des patients qui mise en priorité sur le consentement du patient et la prise en compte de ses volontés par le personnel médical.
Pour garantir le libre choix des individus, il est fondamental de donner réellement ce choix par une diversité de propositions. La carte offerte par l'IEB est donc une véritable opportunité. Elle s'élève aujourd'hui comme la seule alternative possible aux déclarations anticipées d'euthanasie. Si elle n'a pas de valeur légale, elle a pour autant un poids juridique. Car en l'absence de directives anticipées, la recherche de la volonté du patient devra se faire par tout moyen.
Le buzz médiatique autour de cette carte, et l'inquiétude voire la virulence de l'ADMD à son encontre seraient-ils la preuve qu'elle répond à une prise de conscience croissante des citoyens belges face à l'euthanasie?
 La menace terroriste que les vagues migratoires actuelles font peser sur l’Europe ne fait aucun doute selon le Saint-Père qui a reconnu le danger potentiel d’une infiltration par des terroristes de l’EI. Lu sur le site « aleteia » :
La menace terroriste que les vagues migratoires actuelles font peser sur l’Europe ne fait aucun doute selon le Saint-Père qui a reconnu le danger potentiel d’une infiltration par des terroristes de l’EI. Lu sur le site « aleteia » : La crise des migrants que connaît l’Europe renvoie les chrétiens aux racines bibliques de leur foi et à la construction même de l’Occident. Pour sortir du débat actuel par le haut, la foi et l’annonce leur seront d’une précieuse aide. Regards croisés de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et du philosophe
La crise des migrants que connaît l’Europe renvoie les chrétiens aux racines bibliques de leur foi et à la construction même de l’Occident. Pour sortir du débat actuel par le haut, la foi et l’annonce leur seront d’une précieuse aide. Regards croisés de Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon, et du philosophe 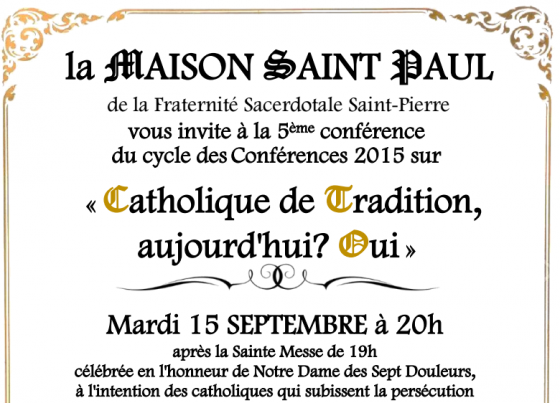
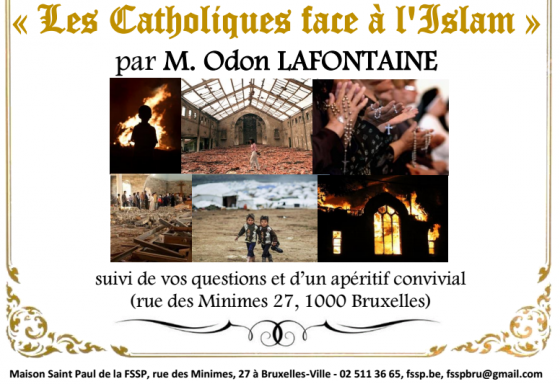
 On l’oubliait un peu, mais bien à tort : un synode n’est jamais qu’un organe consultatif. Le pape François n'a d’ailleurs pas attendu les recommandations de son assemblée d’octobre prochain pour décider d’assouplir la procédure de reconnaissance de nullité d'un mariage sacramentel.
On l’oubliait un peu, mais bien à tort : un synode n’est jamais qu’un organe consultatif. Le pape François n'a d’ailleurs pas attendu les recommandations de son assemblée d’octobre prochain pour décider d’assouplir la procédure de reconnaissance de nullité d'un mariage sacramentel. 
