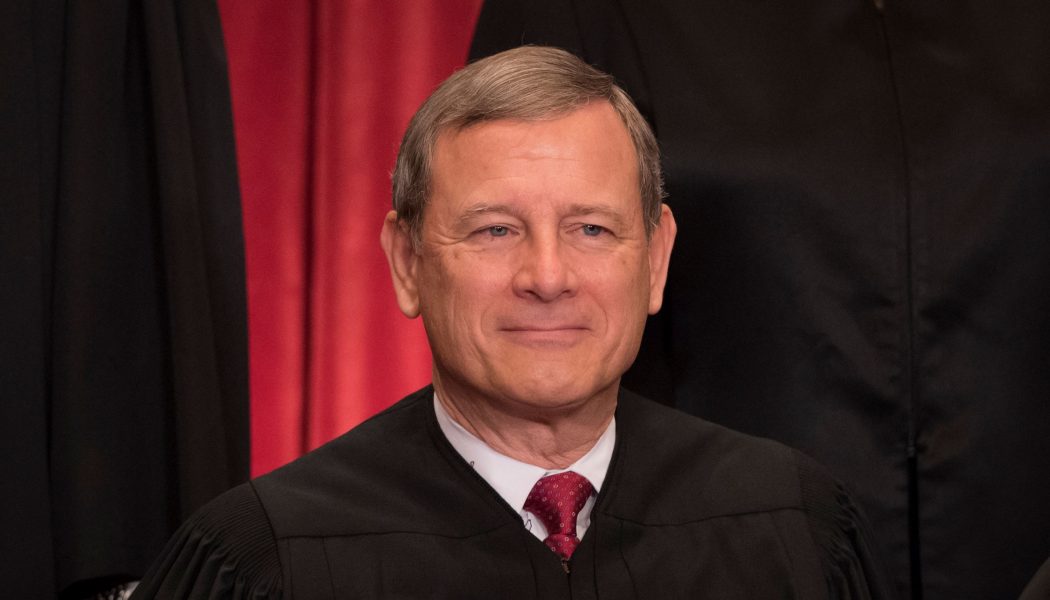De Roberto de Mattei sur le site de Correspondance Européenne :
Un pamphlet LGBT contre l’Eglise
Un pamphlet LGBT contre l’Eglise. Le titre en est Sodome et l’auteur, Frédéric Martel, un activiste LGBT français bien connu. Le livre est cependant né au Italie au cours d’un entretien entre l’auteur et l’éditeur Carlo Feltrinelli, fils de Gian Giacomo, l’éditeur terroriste mort le 14 mars 1972 alors qu’il posait une bombe sur un pylône à haute tension de l’ENEL à Segrate. Sodome sera présenté au cours des tous prochains jours en huit langues et une vingtaine de pays. Le lancement officiel se fera le 21 février en concomitance avec l’ouverture au Vatican de la réunion de haut niveau dédiée aux abus sexuels sur mineurs. Il s’agit donc d’une puissante opération médiatique qui a comme cible l’Eglise catholique. L’auteur du libre, Frédéric Martel, présenté par la presse sous les titres de fois en fois de sociologue, chercheur, historien, est parvenu à une certaine popularité grâce à son dernier essai, traduit en diverses langues, Global gay – publié en Italie par Feltrinelli – dédié à l’actuelle marche triomphante du mouvement homosexualiste dans le monde entier.
Impliqué directement dans de nombreuses associations actives dans la diffusion du programme LGBT Frédéric Martel est engagé depuis des années en première ligne dans le processus de promotion et de « normalisation » de l’homosexualité. Le militantisme LGBT de l’auteur de Sodome l’a porté à être l’un des principaux promoteurs de la loi n°99-944 du novembre 1999 (Du pacte civil de solidarité et du concubinage), sur ce qu’il est convenu d’appeler les PACS, qui introduisirent en France les unions civiles. Au cours des années suivantes, l’activiste LGBT a continué à apporter sa contribution à la cause homosexualiste en dédiant de nombreux articles à l’introduction du pseudo mariage homosexuel en France, jusqu’à sa légalisation complète intervenue le 18 mai 2013.
Frédéric Martel affronte maintenant la sodomie au sein de l’Eglise, en affirmant avoir conduit une enquête de terrain d’une durée de 4 ans, en interrogeant quelques 1.500 personnes au Vatican et dans différents pays du monde. En réalité, ce dont le livre manque cruellement est justement la documentation. Nous ne savons rien, en effet, après sa lecture, de plus que ce que nous ne savions auparavant sur la diffusion de l’homosexualité dans l’Eglise. Ce très grave problème, placé sous les projecteurs par le témoignage de S.Exc. Mgr Carlo Maria Viganò, a été analysé de manière scientifique et documentée par deux chercheurs polonais, les Pères Dario Oko et Andrzej Kobyliński, auteurs d’études qui ont été ignorées par la presse internationale. Cependant Frédéric Martel ne cherche pas la vérité. Il a une thèse idéologique à démontrer et il ne démontre rien au fil de ses pages. Il ne fait que suggérer, insinuer, calomnier, dénigrer.