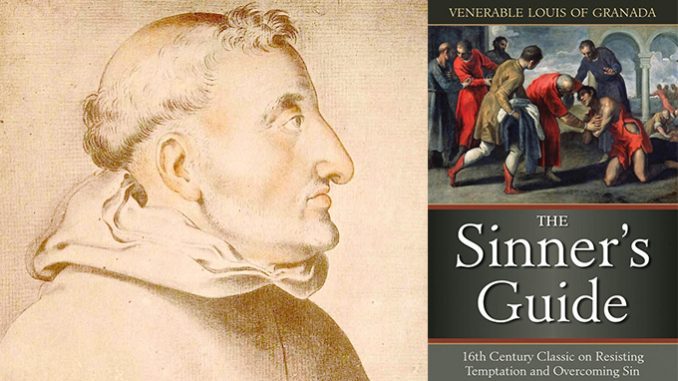De Robert Royal sur The Catholic Thing :
De la lumière et des ténèbres
22 décembre 2025
Bien des choses dépendent de cette division – mais, comme nous le verrons plus loin, pas, en définitive, au sens où on pourrait l'imaginer. D'une certaine manière, il n'est pas surprenant que ce soit un scientifique juif, Albert Einstein, qui ait découvert le premier le rôle fondamental de la lumière dans la création. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans notre univers. Les convictions religieuses personnelles d'Einstein font débat, mais est-ce vraiment un hasard si quelqu'un imprégné de tradition juive a pu parvenir à cette vérité ?
Toute cette tradition est profondément ancrée en nous en cette période. La naissance d'un enfant est – ou devrait toujours être – un motif de joie. Mais le fait que cet enfant soit venu au monde durant ses heures les plus sombres est assurément plus qu'une simple coïncidence. De nos jours, on a tendance à rejeter de telles spéculations comme « moyenâgeuses ». Mais comme dans nombre de paradoxes de la Foi, l'obscurité n'est ni fortuite, ni simplement symbolique, ni même – nous y reviendrons – un vestige du passé. Au fond, l'obscurité est aussi la raison d'être de cette période. La lumière aurait-elle autant d'importance sans elle ?
À bien y réfléchir, pourquoi Jésus est-il né la nuit ? Nous le savons grâce à ce détail apporté par l’Évangile selon Luc : « Or, il y avait dans cette région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » (Luc 2,8) Cela est cohérent, car la tradition prophétique juive suggère que la nuit est la réalité quotidienne dans laquelle nous vivons.
Dans le Messie de Haendel , que vous devriez écouter chaque année à cette période pour votre plaisir et votre édification, vous entendrez beaucoup parler de la gloire de Dieu et de la manière dont nous devons lui être reconnaissants de nous avoir rachetés. « Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » (Ésaïe 9:2) Mais pourquoi était-il assis dans les ténèbres ?
Lors d'un concert la semaine dernière, le passage qui a le plus marqué les esprits était « Et qui pourra supporter le jour de sa venue ? », un extrait du livre du prophète Malachie (3,2) choisi par Haendel. On pourrait croire qu'après toutes les ténèbres et les souffrances du monde, nous serions tous heureux de le revoir. Mais ce monde obscur que le péché originel et nos péchés individuels nous ont imposé – et auquel nous sommes si attachés – est un monde que nous ne renonçons pas facilement. La tradition chrétienne nous rappelle que beaucoup d'entre nous redouteront le retour du Christ. Même lors de sa première venue, certains, comme Hérode, puis les pharisiens et les sadducéens, n'ont pas manifesté une joie immense à sa vue.