Du Catholic Herald (Regina Einig) :
.png)
Interview : Le cardinal Pizzaballa s'exprime sur les chrétiens en Terre sainte et explique pourquoi le chemin synodal allemand est sans importance.
Éminence, la situation des chrétiens en Terre sainte s'est-elle améliorée depuis le cessez-le-feu d'octobre ?
Les conditions de vie des chrétiens et de beaucoup d'autres ne se sont pas améliorées de façon significative. La principale différence réside dans la guerre elle-même. Il n'y a plus de combats aussi intenses qu'au cours des derniers mois, mais les conditions de vie restent exactement les mêmes. Peut-être que la situation est différente dans la région de Bethléem grâce à Noël. Nous avons décidé de célébrer Noël de façon normale et festive, avec des lumières et de la musique, afin d'offrir un peu de répit aux gens. Ils ont besoin de lumière dans leurs vies. Mais notamment à Gaza et en Cisjordanie, les conditions de vie demeurent très difficiles, sur les plans social, économique et politique. L'avenir du prochain gouvernement reste incertain.
Vous avez récemment assisté à la visite du pape au Liban. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?
Ce qui m'a d'abord impressionné, c'est l'enthousiasme du peuple libanais, sans exception, catholiques ou non. Pendant de longues années, les gens se sont sentis oubliés, même après la guerre du Liban, surtout dans le sud. Les blessures y sont encore vives. La visite du Pape a insufflé un nouvel élan à la communauté, et cela s'est ressenti partout. La rencontre avec les jeunes, à laquelle j'ai assisté, a également été un grand cadeau. Ces jeunes étaient non seulement heureux, mais aussi pleins d'espoir. Le Pape Léon a particulièrement insisté sur ce point. L'espoir et la paix étaient les thèmes récurrents de ses discours. L'atmosphère générale était très positive.
Durant son voyage apostolique, le Saint-Père a lancé un vibrant appel à l'unité des chrétiens. Quelle pourrait être la prochaine étape pour les chrétiens sur leur chemin commun ?
Il est important que nous poursuivions sur cette voie. Nous savons que le chemin est encore long. Ne soyons pas naïfs et ne pensons pas que cela puisse se faire rapidement. Tout d'abord, reconnaissons ce que nous avons déjà en commun, notamment au Moyen-Orient, où des chrétiens de différentes confessions vivent déjà ensemble. Les familles sont mixtes et les chrétiens collaborent dans les écoles et bien d'autres lieux. Il est essentiel de reconnaître et de renforcer cette solidarité pastorale. Nous devons également trouver une voix commune sur les questions internationales et universelles telles que la paix, la justice et la dignité humaine. Ces valeurs nous unissent, quelles que soient nos différences et nos confessions. Nous devons continuer à œuvrer en ce sens et améliorer progressivement nos relations pastorales quotidiennes au sein de nos communautés. Peut-être aurons-nous un jour un calendrier commun. Prenons notre temps. L'important pour moi est que, dans l'intervalle, nous n'oublions pas les petits pas, afin de réaliser de plus grandes choses.
Quelles sont les relations œcuméniques entre catholiques et orthodoxes en Terre sainte ?
Nos relations au niveau institutionnel sont très bonnes, et au niveau local, elles fonctionnent également bien. J'admets volontiers que, des deux côtés, certains prêtres ont tendance à faire preuve d'une rigueur excessive, mais fondamentalement, les relations sont bonnes. Je tiens à souligner à nouveau que 90 % des familles chrétiennes parmi nous sont mixtes sur le plan confessionnel. Les catholiques et les chrétiens orthodoxes se marient entre eux. Les relations entre les Églises sont pour nous une question pastorale, et non théologique.
Comment l'œuvre de paix du Saint-Père affecte-t-elle la Terre Sainte, notamment en ce qui concerne les chefs religieux ?
L'œuvre de paix du Saint-Père est très importante. En particulier en cette période de guerre, avec toutes les dévastations humaines qu'elle entraîne, alors que nous nous sentons parfois perdus, nous avons besoin de repères, de quelqu'un qui nous aide à voir au-delà de nos propres horizons et qui nous donne une orientation. En ce sens, le pape, en tant que leader reconnu, peut nous aider par ses paroles à façonner notre récit chrétien dans cet environnement très complexe.
Vous avez récemment déclaré dans une interview au National Catholic Register que le chemin synodal allemand n'avait aucune pertinence pour la vie des chrétiens en Terre Sainte. Quelles discussions théologiques considérez-vous personnellement comme importantes pour la réforme de l'Église ?
Les questions soulevées par le Chemin synodal en Allemagne, ainsi que de nombreux autres sujets abordés dans les pays occidentaux, ne trouvent pas particulièrement d'écho au Moyen-Orient. Nous vivons dans une réalité complètement différente. Ce n'est pas un jugement, c'est simplement un fait. C'est la réalité. La théologie n'est pas vécue ici de manière aussi dramatique. Nos Églises sont traditionnelles, et nous vivons dans et à travers la communauté de l'Église. Pour nous, le renforcement des relations entre les Églises est ce qui importe le plus. Pour les chrétiens d'ici, la coexistence harmonieuse entre les Églises est la priorité.
Pouvez-vous donner des exemples de projets ou d'institutions communes que vous considérez comme des exemples positifs de ces efforts ?
Il existe de nombreux exemples. Je commencerai par le contexte le plus dramatique à l'heure actuelle, Gaza. Les paroisses orthodoxes et catholiques travaillent ensemble partout, non seulement dans le domaine de l'aide humanitaire, mais aussi dans les écoles et les activités pastorales. Elles coordonnent également leurs activités liturgiques afin qu'elles ne se gênent pas mutuellement. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Dans les villages où il y a des écoles catholiques et orthodoxes, nous essayons de coopérer. Comme nous avons malheureusement moins d'élèves chrétiens, nous organisons les choses de manière à ce qu'une Église gère l'école primaire et l'autre l'école secondaire, ou vice versa. De cette façon, nous offrons la même éducation. Les écoles orthodoxes et catholiques utilisent les mêmes livres de catéchisme, que nous élaborons ensemble. Il existe de nombreux autres exemples.
Dans ces écoles, comment les classes sont-elles composées ?
Cela dépend de l'école, mais en général, environ la moitié des élèves sont chrétiens. Dans certaines écoles, les musulmans constituent la majorité des élèves, selon l'endroit. Dans toutes nos écoles, la présence de non-chrétiens est très importante, non seulement en termes de nombre, mais aussi en termes de mission.
Qu'espérez-vous pour votre troupeau en Terre Sainte ?
J'espère de meilleures conditions de vie politiques et sociales pour nous. J'espère que la communauté préservera son unité, son engagement envers la vie et sa résilience dans cette situation compliquée. Mais cela demande plus de patience. Il ne faut pas confondre espoir et solution politique.
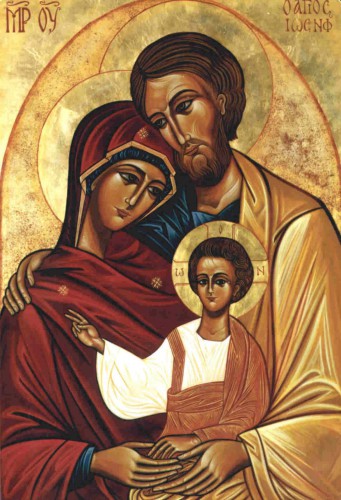 Lors de la messe du pèlerinage des familles, le 27 octobre 2013, le pape François a récité une prière dont voici la traduction (
Lors de la messe du pèlerinage des familles, le 27 octobre 2013, le pape François a récité une prière dont voici la traduction (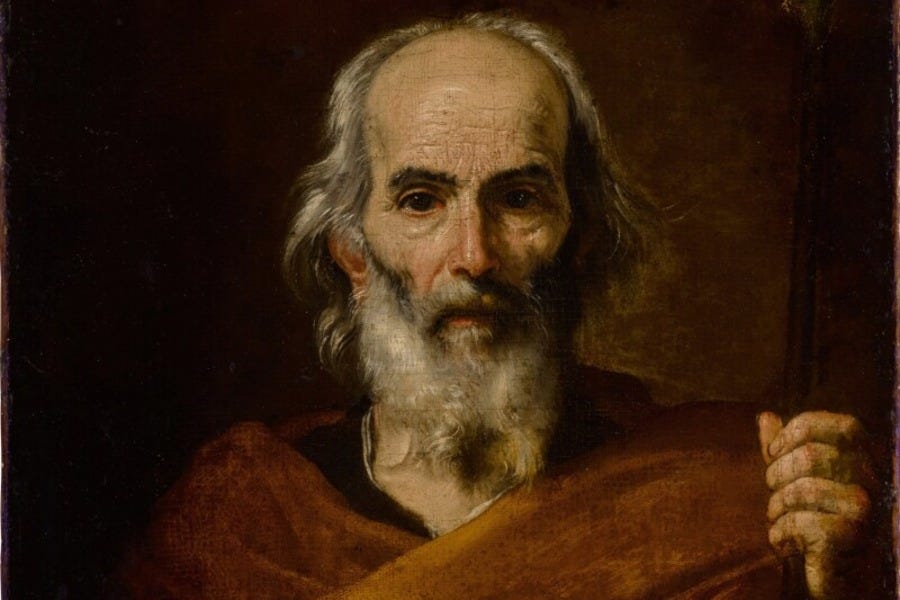
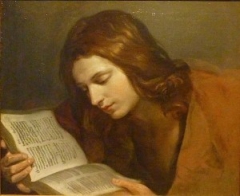 Nous publions ci-dessous le texte intégral de la catéchèse que le pape Benoît XVI a prononcée au cours de l’audience générale du mercredi 5 juillet 2006. (
Nous publions ci-dessous le texte intégral de la catéchèse que le pape Benoît XVI a prononcée au cours de l’audience générale du mercredi 5 juillet 2006. (
