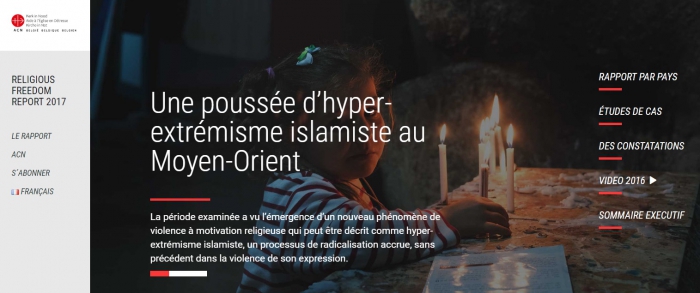NEW YORK, 25 mars (C-Fam). Le monde a assisté au retour des États-Unis vers la tendance pro-vie après des années de promotion de l’avortement par l’administration Obama au cours de la Commission de l’ONU sur le Statut des Femmes d’hier.
Après le coup de marteau signalant l’adoption de l’accord annuel de la commission, connu sous le nom de Conclusions Concertées, la délégation des États-Unis a prononcé une poignante déclaration pro-vie.
Le consensus international sur le programme de l’ONU concernant “la santé sexuelle et procréative” est que “cela ne crée pas de nouveaux droits internationaux, incluant le droit à l’avortement” ainsi que l’ont déclaré les États-Unis.
Ce tournant a permis de revenir sur les acquis des supporters de l’avortement, comme les mentions explicites de l’avortement dépourvues de tous les restrictions qui donnaient une image faussée de l’avortement dans les accords précédents de l’ONU.
Cette année, l’accord non seulement ne mentionne pas l’avortement, mais indique que toute référence à “la santé sexuelle et procréative”, “les services de soins en santé sexuelle et procréative” et ” les droits en matière de procréation” doivent se faire en référence aux accords précédents de l’ONU selon lesquels l’avortement n’est pas un droit, engageant les nations à aider les femmes à éviter l’avortement, et les empêchant de le promouvoir comme méthode de planification des naissances.
Les États-Unis ont déclaré “qu’ils n’encouragent pas l’avortement comme aide sanitaire en matière de procréation” et ont souligné que “les USA sont le plus important pourvoyeur bilatéral en matière d’aide sanitaire pour la mère, le nouveau-né et l’enfant ainsi que pour le planning familial.” C’était une réponse aux critiques du Programme de Mexico City, récemment restauré, qui coupe les subventions aux groupes qui favorisent ou réalisent des avortements.
Cet accord a porté un coup particulièrement dur aux pays Nordiques et Européens qui encouragent une “éducation sexuelle globale” qui enseigne aux moins de 4 ans une “masturbation infantile précoce”, les doits LGBT, et la prostitution légale.
Une ultime tentative par l’Union Européenne pour enlever les restrictions au terme “santé sexuelle et procréative” a échoué.
L’Espagne a exprimé au nom de l’Union Européenne la déception et la frustration de certains pays membres.
Alors que la plupart des délégués dans la salle, y compris le libéral Président de session brésilien et la présidente de ONU-Femmes, ont copieusement rendu hommage à l’animatrice égyptienne de ces négociations ardues et controversées pour sa conduite du processus dans son entier, l’Union Européenne a critiqué l’accord en disant qu’il ne contenait que des “parcelles” d’engagement constructif, et qu’il n’était qu’une “interprétation” fort éloignée des négociations qui se sont poursuivies sur des semaines.
“Nous regrettons que le lien entre émancipation économique et santé et droits sexuels et procréatifs n’ait pas pu être renforcé en prenant mieux en compte les composantes des droits de l’homme”, a déclaré le délégué espagnol.
La délégation européenne a également déploré que l’accord mentionne la primauté de “l’espace politique des nations” prétendant que cela “limitait les ambitions de la commission”, même s’il s’agissait d’une formulation courante dans les accords de l’ONU.
Et, elle déclara qu’ils étaient “troublés par un langage qui renforçait les rôles stéréotypés des femmes et des filles,” en référence à un appel pour la reconnaissance du rôle des mères au foyer.
Le Canada, la Nouvelle-Zélande, et plusieurs pays d’Amérique Latine ont été déçus, mais la France seule a fait écho à la véhémence et la frustration du délégué espagnol, en se référant plusieurs fois aux “droits en matière de sexualité et de reproduction comme condition préalable à l’émancipation économique.”
Le délégué du Saint-Siège a directement contredit cette déclaration selon les réserves habituelles du Saint-Siège, en déclarant que “les droits en matière de reproduction n’étaient pas une condition préalable à l’émancipation économique.”
La Pologne a également indiqué qu’elle souhaitait avoir un rôle de chef de file au sein de l’Union Européenne pour s’opposer aux programmes sociaux progressistes, déclarant que la formule “droits en matière de sexualité et de reproduction n’avait pas de définition reconnue au niveau international.”