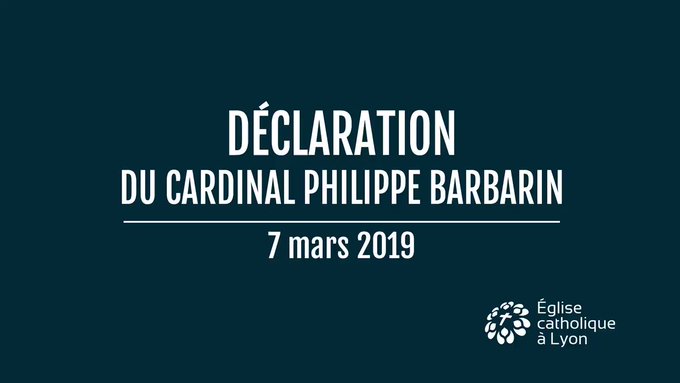D'Adélaïde Patrignani sur Vatican News :
Christus vivit: le Pape offre aux jeunes une «balise sur un chemin synodal»
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican
«Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc: Il vit et il te veut vivant !». Ainsi commence le tout premier des 299 paragraphes de cette Exhortation apostolique post-synodale rédigée et signée par le Saint-Père. Le style du document magistériel est déjà perceptible dans ces quelques phrases: direct, vivifiant, plein d’espérance et jalonné par la personne du Christ.
Une exhortation apostolique écrite avec et pour les jeunes
Le Pape lui-même explique sa démarche concernant la rédaction d’un document qu’il qualifie de «balise sur un chemin synodal». Une lettre écrite «avec affection» et en tenant compte des rencontres passées. «Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et des échanges du Synode de l’année passée [du 3 au 28 octobre 2018]. [...] Ainsi, ma parole sera chargée de mille voix de croyants du monde entier qui ont fait parvenir leurs opinions au Synode. Même les jeunes non croyants, qui ont voulu y prendre part par leurs réflexions, ont soulevé des questions qui ont suscité en moi de nouvelles interrogations», reconnaît le Souverain Pontife.
Pour le fond, le Pape a voulu un texte «qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même temps, encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre vocation». Et concernant la forme, soit François s’adresse «directement aux jeunes» - le tutoiement est de mise dans la plupart des paragraphes -, soit il propose «des approches plus générales pour le discernement ecclésial», particulièrement utiles pour les pasteurs et les acteurs de la pastorale des jeunes et des vocations.
Dans le Verbe de Dieu, des trésors de jeunesse
Après un premier chapitre consacré aux figures marquantes de jeunes dans la Bible, le Pape attire l’attention de ses lecteurs sur «Jésus-Christ, toujours jeune», dont les aspects de la vie constitue une inépuisable source d’inspiration. «Cela implique qu’il faut mûrir dans la relation avec le Père, conscient d’être membre de la famille et du peuple, se disposer à être comblé de l’Esprit et à être conduit [...]. Rien de cela ne devrait être ignoré dans la pastorale des jeunes, pour qu’on ne crée pas des projets qui isolent les jeunes de la famille et du monde, ou qui les transforment en une minorité sélectionnée et préservée de toute contagion. Nous avons plutôt besoin de projets qui les fortifient, les accompagnent et les lancent vers la rencontre avec les autres, vers le service généreux, vers la mission», conseille également le Saint-Père. «Il est très important de contempler le Jésus jeune que nous montrent les Évangiles, car il a été vraiment l’un de vous, et en lui on peut reconnaître beaucoup de caractéristiques des cœurs jeunes», poursuit-il.





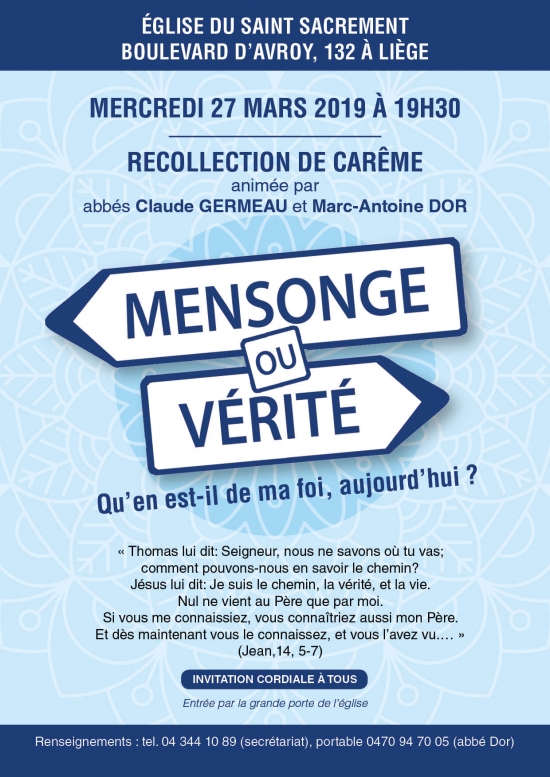
 Sursum Corda asbl
Sursum Corda asbl