De Jean Bernard sur le site de La Nef (27 juin) :
Quand un journal catholique belge assurait la promotion de la pédophilie
« Beaucoup de chrétiens convaincus peuvent encore apprendre beaucoup des pédophiles » : c’est la recommandation que n’hésitait pas à donner, en Belgique, dans les années 80, un « groupe de travail œcuménique sur la pédophilie », dont la publicité était assurée par l’hebdomadaire catholique le plus important du pays.
Chacun garde en mémoire la pluie de critiques qui s’est abattue sur Benoit XVI lorsque ce dernier a, en avril dernier, dans un document publié par la revue bavaroise Klerusblatt, imputé une partie de la crise des abus sexuels à l’esprit de mai 1968 et à la « dissolution du concept chrétien de moralité » qui en est résulté. Alors que la thèse officielle est de privilégier le « cléricalisme » comme facteur explicatif de cette crise, l’intervention du pape émérite ne pouvait qu’être jugée intempestive.
S’il est certain que le cléricalisme a joué assurément un rôle évident dans la survenance des abus, puisque ceux-ci n’auraient jamais pu être commis ni cachés sans l’utilisation dévoyée par les prêtres du pouvoir dont ils disposent, il ne conviendrait pas pour autant d’écarter, par souci idéologique, les autres facteurs, en particulier ceux évoqués par Benoît XVI.
À cet égard, une pièce intéressante, témoignant de l’influence d’un certain esprit de mai 1968, peut être versée au débat. Il s’agit d’une annonce publiée le 9 août 1984 dans l’édition nationale de Kerk & Leven (Église & Vie), principal hebdomadaire catholique de la Belgique néerlandophone, fondé dans les années 40 par les pères Dominicains et dirigé par les évêques de Bruxelles et de Bruges. Cette annonce, dont l’objet était de présenter les activités d’un… « groupe de travail œcuménique sur la pédophilie », était ainsi libellée :
« Un groupe de travail œcuménique sur la pédophilie existe en Flandre depuis plusieurs années.
Ce groupe de travail est composé de catholiques et de protestants.
Ce groupe de travail souhaite sensibiliser les églises sur le phénomène de la pédophilie, transmettre des informations et combattre les préjugés.
En même temps, le groupe de travail entend s’informer sur tout ce qui se passe dans le domaine de la pédophilie.
Enfin, le groupe de travail veut créer un lieu de rencontre pour les pédophiles afin de favoriser l’échange d’idées et de s’encourager mutuellement.
Tous ceux qui souhaitent mieux connaître la pédophilie et les pédophiles sont les bienvenus, à condition de le faire avec ouverture, respect et confiance.
Avec le début de la nouvelle saison, le père […] participera aux activités du groupe de travail.
La prochaine réunion du Groupe de travail œcuménique sur la pédophilie aura lieu le samedi 8 septembre, de 10h00 à 14h00 au plus tard, dans la chapelle « La branche d’olivier » à Brasschaat, Leopoldslei 35.
Vous êtes invités à apporter des rafraîchissements.
Vous pouvez obtenir plus d’informations à l’adresse : […] Pour le groupe de travail :[…] ».
Le lecteur de 2019 qui prend connaissance de cette annonce reste abasourdi et se demande comment il est possible que l’organe de presse officiel de l’Église catholique de la Belgique néerlandophone – qui tirait à plus de 500 000 exemplaires – ait pu donner une publicité à un tel « groupe de travail œcuménique sur la pédophilie ». Ce d’autant que la brochure envoyée par ce groupe aux personnes sollicitant des renseignements levait, s’il en était besoin, toute équivoque :
« Des relations sexuelles fréquentes entre adultes et enfants ne sont pas nécessairement préjudiciables à ces derniers, et il existe même des relations sexuelles qui sont agréables et précieuses pour les enfants. »
« L’amitié entre un pédophile et un enfant ne doit pas être une raison de paniquer. Il n’y a pas forcément raison d’avoir peur. Pas même si cette amitié s’accompagne d’une relation sexuelle. Ayez confiance en votre enfant. Si votre fils ou votre fille accepte cette relation comme étant agréable, ne détruisez pas ce lien. »
« Beaucoup de chrétiens convaincus peuvent encore apprendre beaucoup des pédophiles. »
« Il est préférable qu’il y ait une relation de confiance entre le pédophile et les parents [de l’enfant]. »
Il a fallu attendre l’année 2010 pour qu’un organe de presse belge, en l’occurrence le quotidien De Morgen, publie, sous la plume du journaliste Douglas De Coninck, une enquête portant sur la « mentalité pédophile dans l’Église flamande », en s’appuyant précisément sur l’annonce parue dans Kerk & Leven[1].
Toutefois, le scandale attendu n’a pas vraiment eu lieu, et la personne qui, dans cette annonce, était présentée comme le « prêtre devant participer aux activités du groupe de travail », occupe toujours aujourd’hui une fonction élevée dans le diocèse d’Anvers…
Jean Bernard
[1] https://www.demorgen.be/nieuws/toen-kindermisbruik-in-de-kerk-de-gewoonste-zaak-was-de-oecumenische-werkgroep-pedofilie~beedeea4/



 « Les 28 et 29 juin seront célébrées en la Basilique d’Evron (Mayenne) 20 ordinations sacerdotales et diaconales pour la Communauté Saint-Martin.
« Les 28 et 29 juin seront célébrées en la Basilique d’Evron (Mayenne) 20 ordinations sacerdotales et diaconales pour la Communauté Saint-Martin.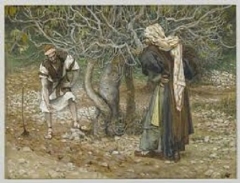 Nos diocèses sont devenus stériles. En écho à l’article publié
Nos diocèses sont devenus stériles. En écho à l’article publié 


