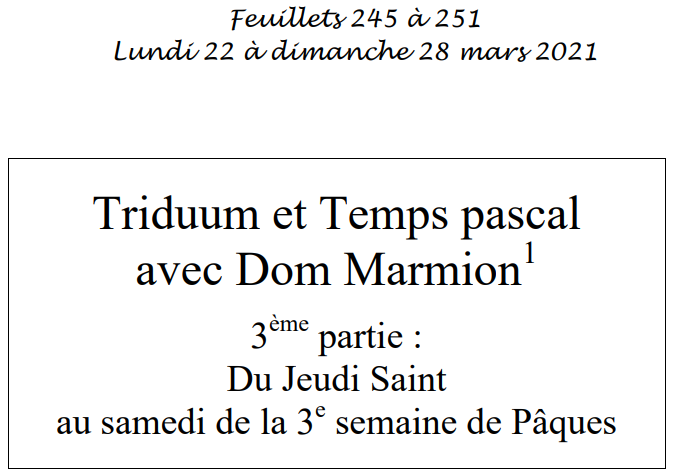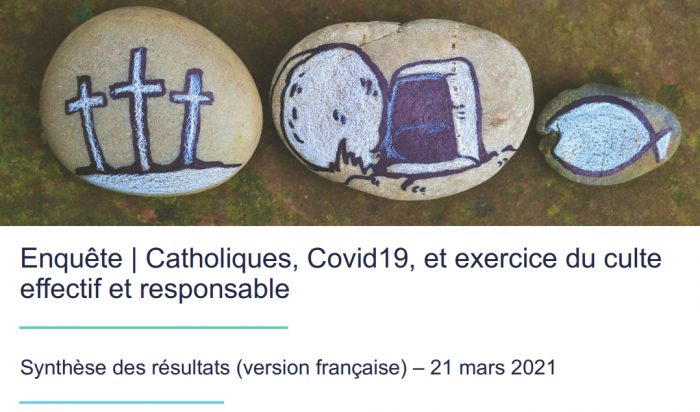Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso, en traduction française sur Diakonos.be :
Exclusif. Le cardinal Sarah demande au pape de révoquer l’interdiction des Messes « individuelles » à Saint-Pierre

(s.m.) Depuis une semaine, la basilique de Saint-Pierre est un désert silencieux. Elle n’est plus animée, comme chaque matin, par les nombreuses Messes célébrées sur les multiples autels. Et tout cela à cause d’une ordonnance émise le 12 mars par la première section de la Secrétairerie d‘État – qui, via son Substitut, est en lien direct avec le Pape – qui a interdit toutes les Messes « individuelles », n’autorisant que les Messes collectives, pas plus de quatre par jour et à des endroits et des horaires préétablis.
L’ordonnance est rédigée sur papier à en-tête mais est dépourvue de toute signature et de numéro de protocole. Et elle n’est même pas adressée à celui qui devrait être son destinataire naturel, le cardinal archiprêtre de la basilique papale construite sur le lieu du martyre et du tombeau de l’apôtre Pierre. C’est un gribouillage juridique.
Et pourtant, elle a fait son effet. Non sans susciter des protestations en haut lieu.
Celle qui suit, confiée à Settimo Cielo pour la publication, est celle du cardinal Robert Sarah, qui était jusqu’au 20 février dernier Préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et donc celui qui est le mieux à même de s’exprimer sur le sujet.
Sa protestation se conclut par cet appel au Pape François :
« Je supplie humblement le Saint-Père de décider du retrait des récentes normes décrétées par la Secrétairerie d’État, qui manquent autant de justice que d’amour, qui ne correspondent pas à la vérité ni au droit, qui ne contribuent pas à la dignité de la célébration, à la participation dévote à la Messe ni à la liberté des enfants de Dieu mais les mettent plutôt en péril. »
Reste à voir si le Pape François répondra, et si oui, comment.
*
Observations concernant les nouvelles normes pour les Messes à Saint-Pierre du cardinal Robert Sarah
Je voudrais spontanément ajouter ma voix à celle des cardinaux Raymond L. Burke, Gerhard L. Müller et Walter Brandmüller, qui ont déjà exprimé leur propre opinion concernant les dispositions prises le 12 mars dernier par le Secrétairerie d’État du Vatican, qui interdit la célébration individuelle de l’Eucharistie sur les autels latéraux de la basilique Saint-Pierre.
Mes confrères cardinaux que je viens de citer ont déjà mis en évidence plusieurs problématiques légales concernant le texte de la Secrétairerie d’État.

 La fonction liturgique de ce dimanche est double : d’abord la bénédiction et la procession des rameaux en souvenir de l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem (elle est attestée depuis le Ve siècle) suivie, pour ainsi dire en contraste, par la célébration d la Messe commémorant la Passion douloureuse du Seigneur.
La fonction liturgique de ce dimanche est double : d’abord la bénédiction et la procession des rameaux en souvenir de l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem (elle est attestée depuis le Ve siècle) suivie, pour ainsi dire en contraste, par la célébration d la Messe commémorant la Passion douloureuse du Seigneur.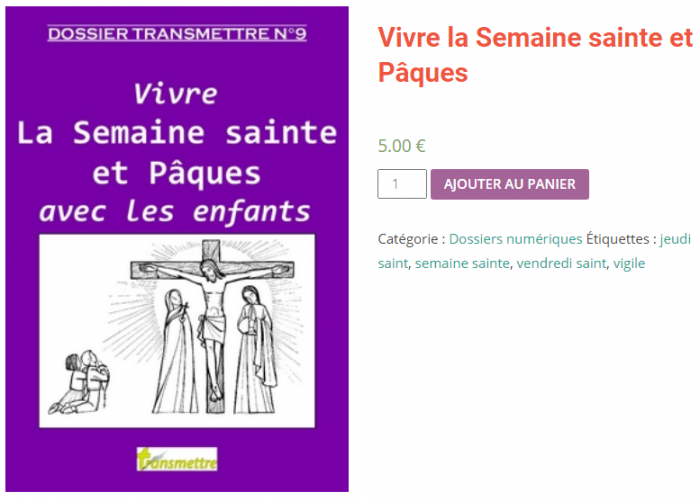
 À l’approche de la
À l’approche de la