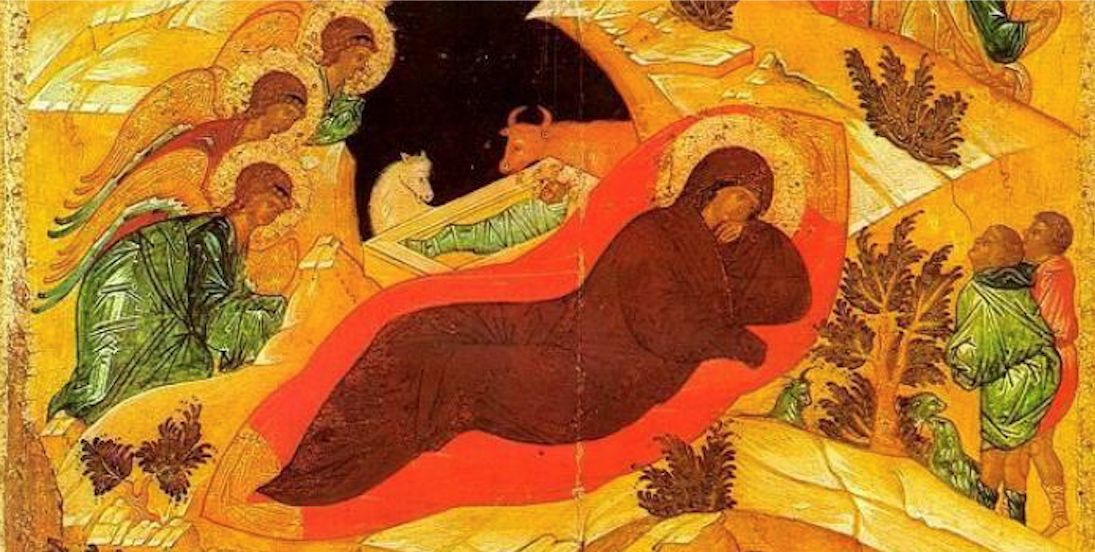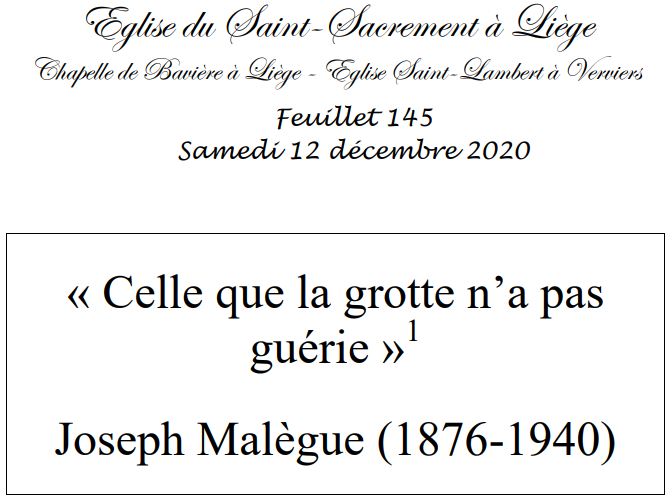Cet article de Paul Sugy, paru sur le Figaro Vox en novembre 2018, nous avait échappé :
« Notre démocratie est gangrenée par l'idéologie progressiste »
FIGAROVOX/GRAND ENTRETIEN - Dans son dernier livre, Laurent Fidès s'attaque à tous les mythes de l'idéologie progressiste dominante. Il déconstruit, un à un, tous les ressorts du discours «politiquement correct».

Laurent Fidès est agrégé de philosophie, ancien élève de l'École normale supérieure. Il vient de publier Face au discours intimidant. Essai sur le formatage des esprits à l'ère du mondialisme (Éd. du Toucan, 2018).
FIGAROVOX.- Votre livre déconstruit les ressorts de l'idéologie contemporaine dominante. De quelle «idéologie» s'agit-il? Et le terme n'est-il pas exagéré, ou trop lourdement connoté?
Laurent FIDÈS.- L'idéologie dont je parle est multiculturaliste, échangiste, déconstructiviste, elle nous promet un monde sans frontières, sans différences, atomisé, peuplé d'entités négociables et remplaçables. Plusieurs indices me font penser que nous avons affaire à une idéologie plutôt qu'à une doxa, même si elle n'est pas formalisée: le fait que ces idées soient présentées comme des vérités, voire comme des vérités scientifiques (portées par les «sciences humaines» qui jouent ici un rôle spécifique), le déni de réalité (l'idéologie est vraie, c'est le réel qui ment, comme lorsque vous croyez assister au changement de peuple qui se déroule sous vos yeux et que l'on vous explique que ce que vous voyez n'existe pas), la mobilisation de l'appareil idéologique d'État, de l'école primaire (qui inculque l'antiracisme dogmatique comme un catéchisme) à la Justice (qui criminalise les idées non conformes) en passant par l'Université et bien sûr les médias. Mais surtout cette idéologie, comme toute idéologie à toute époque, correspond aux intérêts de la classe dominante: cette hyperclasse d'affairistes et de financiers à laquelle s'agrègent tous les gagnants de la mondialisation ainsi que cette fraction de la petite bourgeoisie urbaine cultivée qui profite des retombées sociétales du système et y trouve en tout cas son compte.
Vous parlez d'une «dichotomisation interne» à cette idéologie: qu'est-ce que vous entendez par là?
J'appelle «dichotomisation interne» une technique de manipulation qui consiste à faire croire à un conflit en opposant simplement deux sensibilités prises au sein d'un même courant. En procédant ainsi, en faussant les lois de la symétrie et en marginalisant les contradicteurs sérieux, le système peut se reproduire à l'infini sans entorse apparente au principe du pluralisme.