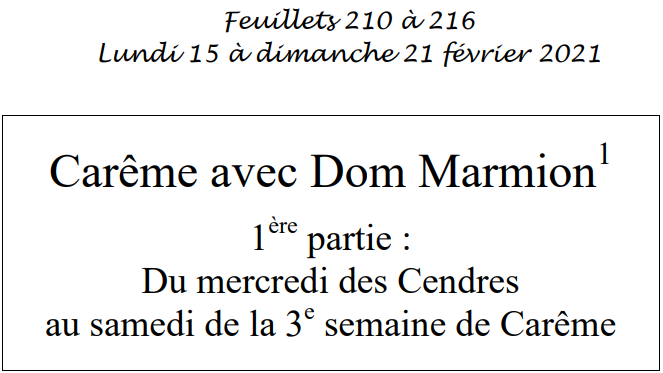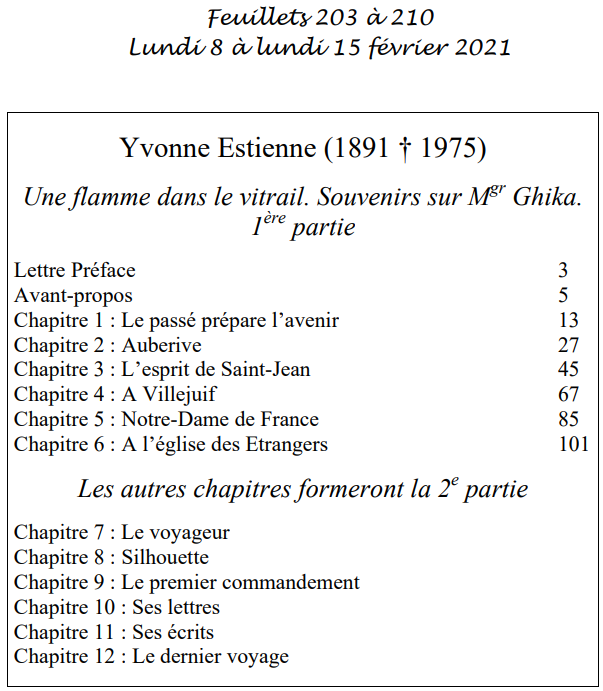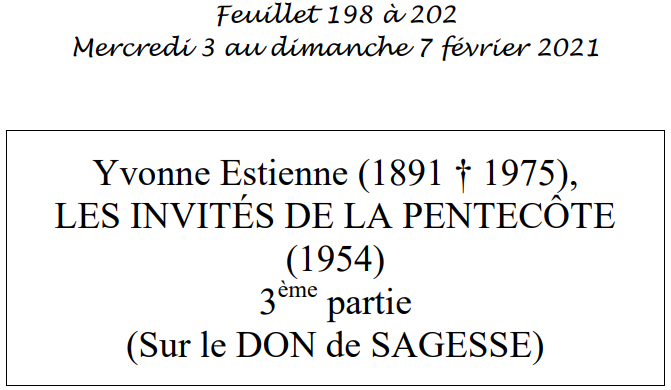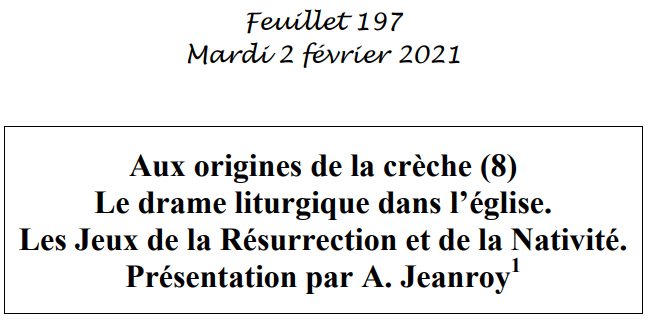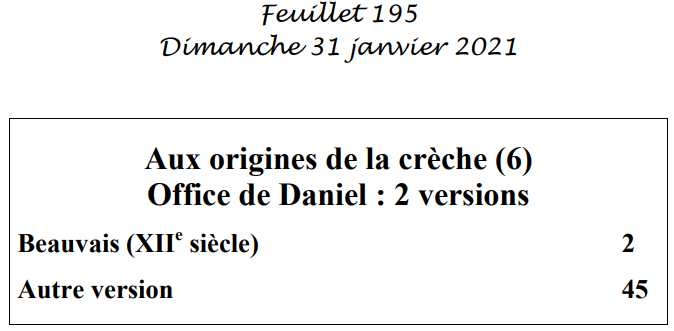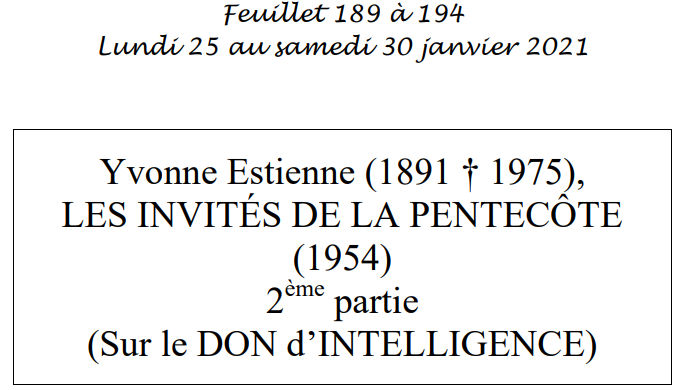De la rubrique "Au quotidien" de l'Homme Nouveau, n°162 :
le Diable dans la démocratie
Polonais, philosophe, ancien ministre et aujourd’hui député européen, Ryszard Legutko a constaté par expérience que le communisme et le libéralisme puisaient aux mêmes sources. Il s’en est expliqué dans un livre, Le Diable dans la démocratie (L’Artilleur). Il a répondu aux questions du Figaro (5 mars 2003).
Je comprends votre inquiétude sur l’expansion du politiquement correct. Mais vous en rendez responsable la démocratie libérale. Est-ce justifié ? N’est-ce pas plutôt le progressisme post-1968 et le phénomène récent du radicalisme « des justiciers sociaux » qui est en cause ?
J’explique dans le livre que le libéralisme, dès l’origine, veut instaurer une transformation sociale. Si vous lisez Hobbes ou Locke, figures de la philosophie libérale, ils commencent toujours par une situation hypothétique, prépolitique sur l’état de nature. Cela a des conséquences, car il résulte de cette perspective que toute institution a la charge de la faute. Le libéralisme a de ce point de vue privé les gens du respect de l’expérience et des institutions de longue durée. Prenez l’exemple de la famille. Elle a toujours été suspecte pour les libéraux. Ceux qui défendent la famille sont a priori dans une position plus faible, car c’est à eux de prouver qu’elle est importante. Le libéralisme de ce point de vue affaiblit les conservateurs, il invite au radicalisme et sans avoir d’arme théorique pour le contrer. Les libéraux finissent donc toujours par rendre les armes face aux radicaux.
Selon Tocqueville, le libéralisme, c’est le pluralisme des idées, la capacité à accepter nos désaccords…
Les sociétés sont par essence pluralistes, mais nous ne le devons pas aux libéraux qui, eux, ont une vue assez stérile et uniforme de la société. Distinguer entre le sexe féminin et masculin est une notion qui habite toute l’histoire de l’humanité, depuis des millénaires. Mais les libéraux ont décidé désormais qu’il y avait 50 genres, et non 2 sexes ! Vouloir introduire ces 50 genres implique un travail de destruction massif des structures existantes. En réalité, sous prétexte de diversité, c’est l’uniformité s’installe. On crée des « bureaux de diversité » partout - universités, administrations, business. Mais ces appellations cachent des bureaux « d’homogénéité », réduisant au silence ceux qui pensent différemment.