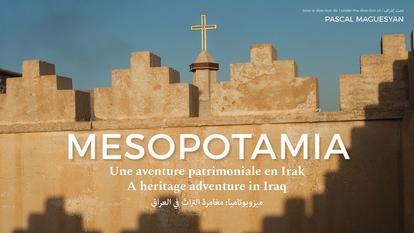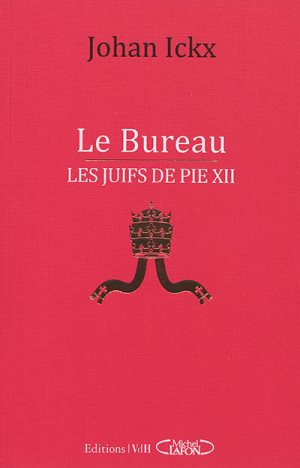De Charles-Henri d'Andigné sur le site de l'hebdomadaire Famille Chrétienne :
Soljenitsyne, prix Nobel en 1970 : la voix des sans-voix
Nourrie de témoignages d’ex-prisonniers du Goulag en plus de sa propre expérience, l’œuvre de Soljenitsyne eut un impact décisif.
« Une parole de vérité pèse plus que le monde entier. » Ainsi Soljenitsyne conclut-il son discours de réception du prix Nobel de littérature en 1970. C’est une phrase clé, qui éclaire toute son œuvre. Sa vie durant, l’écrivain russe aura été possédé par un sentiment d’urgence : dire toute la vérité sur le totalitarisme marxiste, sur le matérialisme historique, expliquer, raconter, décrire le drame qu’a connu son pays, et prévenir le reste du monde des dangers mortels que courent les sociétés occidentales devant les idéologies athées qui les minent, notamment le libéralisme sans Dieu.
D’où une œuvre gigantesque (15 000 pages !), protéiforme, empruntant à tous les genres littéraires, de la nouvelle au roman, de l’essai à la fresque historique, du théâtre à la poésie.
L’homme qui croit pouvoir se passer de Dieu, il était bien placé pour en parler. Jeune, il s’était laissé séduire intellectuellement par le matérialisme historique, qui a l’avantage de fournir une explication clé en main à tous les événements, à toutes les questions que se posent les hommes.
Dans Le Premier Cercle (1968), le personnage de Lev Roubine incarne le jeune Soljenitsyne défendant la société « rationnelle », basée sur la science : « La loi historique ! Tout va là où tout doit aller. » Pas besoin de littérature, la science explique tout. Et l’art ? L’art, oui, mais réaliste, objectif… Son arrestation, en 1945, lui dessillera les yeux. Prisonnier pendant huit ans, il découvre la réalité concentrationnaire qu’il décrit de façon saisissante dans Une journée d’Ivan Denissovitch (1962), qui raconte la journée d’un zek (bagnard). Récit imaginaire, mais nourri de son expérience des camps. C’est l’œuvre qui le fera connaître comme écrivain. Il dira dans Le Chêne et le Veau (1975) comment Krouchtchev lui-même autorisa ce livre, croyant y voir une dénonciation du système de Staline, sans s’apercevoir de sa charge explosive.
Ces années de prison sont fondatrices. Ce sont celles de son retour à la foi orthodoxe, si fondamentale pour lui. Ce sont celles aussi où il forge ses convictions profondes sur l’homme et la société. « L’écrivain que vous avez devant vous, c’est la prison qui l’a fait », dira-t-il à « Apostrophes » en 1975. En outre, La Journée incitera de nombreux ex-prisonniers à lui faire parvenir leur témoignage. Ce sera la matière première de L’Archipel du Goulag. « Mes sources sont des morceaux de fonte d’une très haute qualité, dira-t-il. Je les jette dans ma fournaise intérieure et ils prennent une forme nouvelle. » Il se fait ainsi la voix des sans-voix.
Écrit clandestinement, L’Archipel paraît en russe en 1973, à Paris, avant d’être traduit dans le monde entier. C’est une véritable bombe, dont l’onde de choc provoque les premières fissures dans le bloc soviétique. Le livre montre de manière limpide que le totalitarisme soviétique n’est pas une déviation, mais qu’il est dans la nature même du communisme léniniste, système gouverné par le mensonge. Ce qui explique l’accueil assez mitigé que l’intelligentsia germanopratine fit à l’auteur…
▶︎ À LIRE AUSSI : Soljenitsyne, combattant de la vérité
Restait à tenter de comprendre la genèse de ce totalitarisme. Ce sera La Roue rouge (1993), grand roman historique de la Révolution russe. Soljenitsyne y emploie la méthode des « nœuds ». Il l’expliquera lui-même à la télévision russe : « Ce sont des segments de temps de deux à trois semaines, là où se passent les événements les plus pittoresques, les causes les plus fondamentales de ces événements. Je décris ces nœuds avec force détails. Et c’est en reliant ces nœuds que je restitue la courbe sinueuse du mouvement révolutionnaire. »
Comment expliquer l’impact extraordinaire de son œuvre ? D’abord par ses années d’exil : chassé de son pays en 1974, il s’installe en Suisse, voyage en Europe et s’installe aux États-Unis, dans le Vermont, jusqu’en 1994. Autant d’occasions de faire entendre sa voix. Ensuite, et surtout, par son génie d’écrivain. Soljenitsyne est un géant de la littérature, dont le style est l’expression d’une pensée charpentée, de convictions profondément ancrées dans le réel, d’un courage et d’une force d’âme exceptionnels. Héritier de Pouchkine, de Tolstoï, il est comparable à Dante, pour son côté spirituel, à Bernanos, pour son souffle prophétique, à Dostoïevski, pour sa puissance et sa capacité à aller à l’essentiel. Rien de poseur, chez lui, rien de précieux, souligne le romancier Antoine Rault : « Une écriture vive à la Hemingway, teintée d’humour et d’ironie, d’une précision qui s’interdit toute fioriture, toute préciosité, toute emphase, mais surtout d’un souffle qui vous emporte dès la première page, et que complète un sens parfait du dialogue. »
Russe, Soljenitsyne ? Oui, ô combien. Mais universel.
Charles-Henri d'Andigné
(archive 2018)
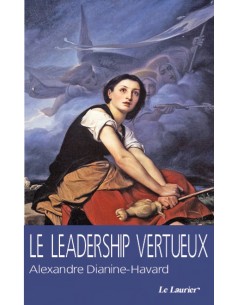
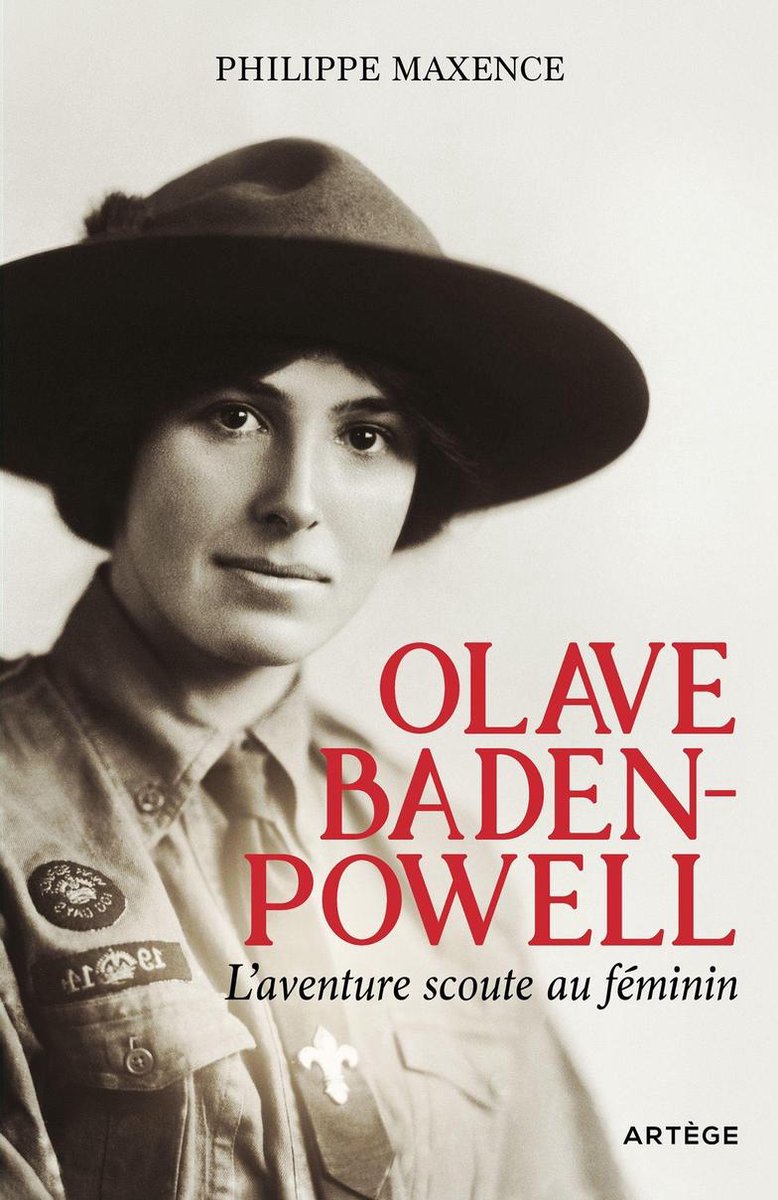
/image%2F0962328%2F20201013%2Fob_65fcb1_incroyables-chretiens.jpg)