De Stéphanie Le Bras dans « Le Monde » (extraits) :
« (…) Ce texte arrive à point nommé. Depuis son élection, le pape a beaucoup parlé et certains catholiques commençaient à se demander ce qui, dans ce foisonnement, relevait de la pensée personnelle de Jorge Mario Bergoglio et ce qui s'inscrivait dans le magistère – la parole officielle – de l'Eglise. D'autres pointaient son « anti-intellectualisme » et son goût exclusif pour les phrases chocs. Les péripéties autour de l'entretien publié dans La Repubblica en octobre – dont la teneur relevait plus d'une « reconstruction » par le journaliste que d'une transcription des propos du pape – avaient fini d'inquiéter les tenants d'une parole papale sans ambiguïté.(…)
Hiérarchisation des priorités
Le pape semble convaincu de l'adaptation de l'Eglise au contexte local. Il invite chacun à « repenser les structures, le style et les méthodes de ses propres communautés » et préconise « un processus résolu de discernement, de purification et de réforme ». Pas question pour autant d'adapter le message. Ainsi sur l'avortement : le pape reste ferme dans son opposition, mais appelle à un meilleur accueil des femmes ayant avorté. De même, « le sacerdoce réservé aux hommes est une question qui ne se discute pas », même si la place des femmes dans l'Eglise peut être améliorée.
Sur le message de l'Eglise, le pape suggère aussi aux clercs une hiérarchisation des priorités, notamment en ce qui concerne l'enseignement moral de l'Eglise. Ils demandent aux pasteurs de ne pas être « obsédés par la transmission désarticulée d'une multitude de doctrines qu'on essaie d'imposer à force d'insister», de sortir du « catalogue des péchés et des erreurs ». Il leur rappelle que le « confessionnal ne doit pas être une salle de torture » et les invite à des homélies plus « positives » que « purement moralistes ou endoctrinantes ». Sans citer explicitement les fidèles privés de communion, comme les divorcés-remariés, le pape rappelle que « l'Eglise n'est pas une douane et qu'il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile ».
Lire l’article ici : Le pape appelle l'Eglise à « sortir du catalogue des péchés »
Dans le « Figaro », Jean-Marie Guénois commente (extraits) :
" Le Pape était censé établir une synthèse du «synode sur la nouvelle évangélisation» que Benoît XVI avait convoqué en octobre 2012 (200 évêques, trois semaines de débats) mais le nouveau Pape en tient très peu compte. Il laisse, et c'est très nouveau, aux «épiscopats locaux» le soin d'en tirer les conclusions qu'ils jugeront utiles. Il préfère se concentrer sur ce qu'il a à dire à l'Église catholique qui l'a élu pape le 13 mars dernier.
Premier point d'insistance, la «joie de l'Évangile», titre du document. Le Pape demande à chaque chrétien de «renouveler aujourd'hui même sa rencontre avec Jésus-Christ», de montrer «la miséricorde de Dieu», sa «tendresse», de laisser au vestiaire de l'histoire les «airs de carême sans Pâques», car «un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement».
Affaiblir le centre
Second point d'insistance, la réforme de l'Église en commençant par sa tête, la «papauté». Non seulement François se dit «ouvert aux suggestions» sur «un exercice de mon ministère qui le rende plus fidèle aux significations que Jésus-Christ entend lui donner». Mais il appelle de ses vœux une des applications du concile Vatican II que le cardinal Ratzinger, sous le pontificat de Jean-Paul II, a toujours combattu en enterrant ce projet: «un statut pour les conférences épiscopales» leur donnant «une certaine autorité doctrinale authentique».
Ce qui revient effectivement à affaiblir le centre, la papauté, le Vatican, pour donner plus de place aux évêques locaux. De fait, c'est aussi nouveau, l'exhortation apostolique, publiée mardi, contient autant de références à des textes d'épiscopats de différentes régions du monde, qu'à des textes du magistère romain.
Cette volonté de réforme de la culture profonde de l'Église - passer d'une vision centralisatrice et dogmatique, à une vision d'une Église «aux portes ouvertes» pour mieux accueillir - implique une série de petites réformes, qui ne sont pas d'aimables suggestions mais que François demande, de façon très nette, d'appliquer (…).
Condamnation renouvelée de l'avortement
Par exemple: mettre la morale à sa place pour ne pas «alourdir» les fidèles, parler de l'essentiel du christianisme, à savoir «l'amour de Dieu» - le Pape relance à ce titre le thème conciliaire également controversé de la «hiérarchie des vérités» - ; recours et retour à la «piété populaire» qui parle aux «gens simples» et le rejet de la «spiritualité du bien-être» ; lutte contre le «cléricalisme» et la «mondanité spirituelle» qui utilise l'Église «autocentrée» pour se faire valoir ; catéchèse qui «annonce» vraiment le Christ et qui introduise aux «mystères de la foi» ; vision, non conflictuelle, des autres religions: l'islam en particulier à qui il demande toutefois «humblement» la réciprocité pour la liberté religieuse des chrétiens vivant en pays musulmans.
Cet esprit de réforme va cependant avec deux avertissements non équivoques. Il n'y a aucune évolution à attendre de sa part pour ouvrir le sacerdoce aux femmes. Et aucune concession sur la condamnation extrêmement ferme - renouvelée dans ce texte - de l'avortement.(…). «
L'homélie doit faire «brûler les cœurs»
Outre cette série d'évolutions et de confirmations, cette «exhortation apostolique» contient deux morceaux de choix.
Le premier est un véritable traité de «l'homélie». Le Pape considère que l'homélie du prêtre, lors de la messe, est un moment capital pour évangéliser. Il fustige les prêtres qui ne les préparent pas: c'est «malhonnête» et «irresponsable», car l'homélie doit faire «brûler les cœurs» des fidèles. François donne donc une large série de conseils concrets dignes d'un cours de séminaire, pour bien préparer les homélies.
L'autre morceau de choix est sa condamnation sans appel, déjà exprimée, d'une «économie qui tue» autour d'un «marché divinisé» qui génère «un système injuste à la racine» qui sera à terme cause de «violences» qu'aucun système de «forces de l'ordre» ne pourra contenir si une régulation n'intervient pas."
Lire l’article ici : Le pape François installe sa révolution dans l'Église
JPSC
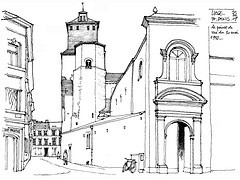 Les plus anciens s’en souviennent : à l’église Saint-Denis à Liège, tous les jours que Dieu fasse, on trouvait autrefois un confesseur de permanence. Grâce, notamment, à la persévérance du doyen de Liège (rive gauche), Eric de Beukelaer, ce temps est aujourd’hui de retour, comme le précise un communiqué :
Les plus anciens s’en souviennent : à l’église Saint-Denis à Liège, tous les jours que Dieu fasse, on trouvait autrefois un confesseur de permanence. Grâce, notamment, à la persévérance du doyen de Liège (rive gauche), Eric de Beukelaer, ce temps est aujourd’hui de retour, comme le précise un communiqué :  Lu sur le site de « Famille chrétienne » ce nouvel appel insistant:
Lu sur le site de « Famille chrétienne » ce nouvel appel insistant: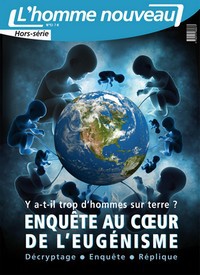

 Dans la lignée du Manuel Bioéthique des Jeunes, et suite à l’introduction des notions de genre dans les ouvrages scolaires de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) de 1ère, la Fondation Jérôme Lejeune met à disposition Théorie du genre et SVT : décryptage des manuels de 1ère.
Dans la lignée du Manuel Bioéthique des Jeunes, et suite à l’introduction des notions de genre dans les ouvrages scolaires de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) de 1ère, la Fondation Jérôme Lejeune met à disposition Théorie du genre et SVT : décryptage des manuels de 1ère.