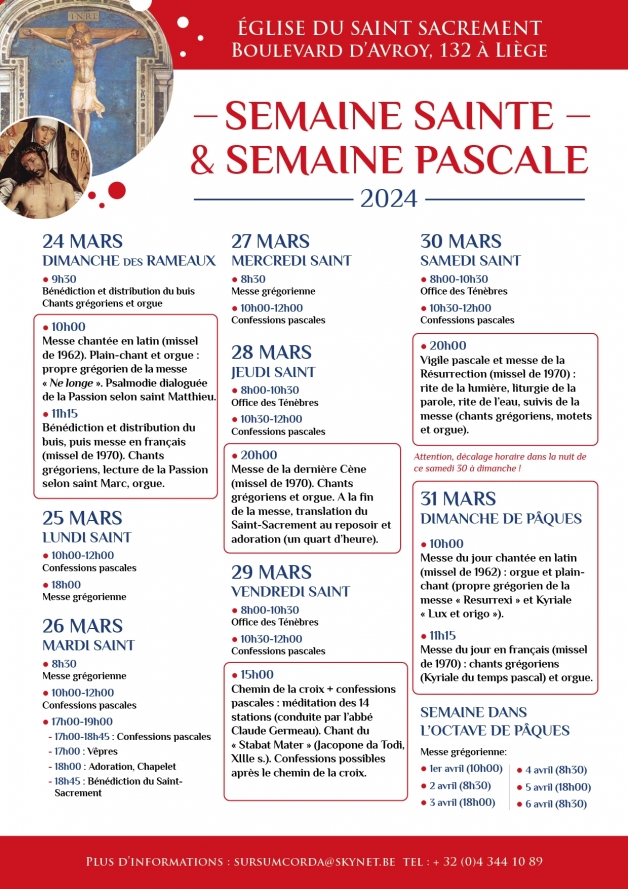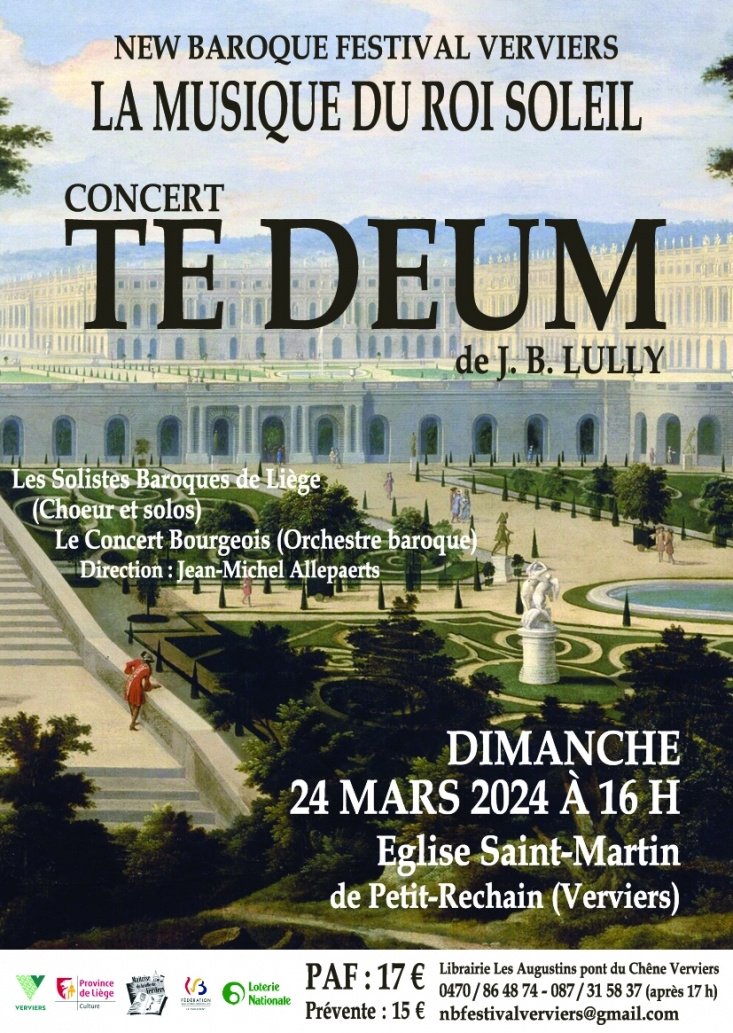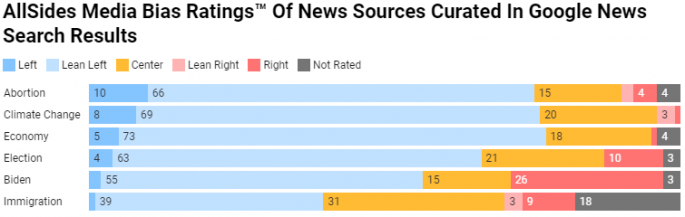De Carl Kozlowski sur le Catholic World Report :
La tendance des films chrétiens de qualité à Hollywood se poursuit
6 mars 2024
Il existe un mouvement chrétien à Hollywood qui pourrait être identifié par le titre de l'un de ses plus grands succès : Jesus Revolution, qui a rapporté plus de 50 millions de dollars l'année dernière.
Ses leaders sont deux paires de frères, les premiers étant Alex et Stephen Kendrick, deux pasteurs baptistes basés en Géorgie qui ont à leur actif une série de succès cinématographiques tels que Fireproof, Courageous, War Room, qui a rapporté 70 millions de dollars, et The Forge, qui sortira en août prochain.
L'autre duo est composé de Jon et Andrew Erwin, qui ont connu un grand succès avec leur biopic musical I Can Only Imagine (83 millions de dollars), suivi de l'excellent drame sportif basé sur la foi American Underdog. Ils ont été producteurs de Jesus Revolution, faisant équipe avec un autre réalisateur chrétien, Jon Gunn, pour réaliser un film sur la vague de "hippies" des années 1960 et 1970 qui se sont convertis au christianisme.
Un facteur notable rapproche les deux équipes : elles ont perfectionné leur art pour réaliser des films capables de rivaliser avec les autres drames produits par l'industrie cinématographique d'aujourd'hui. La preuve en est que le grand studio Sony soutient les Kendrick avec sa branche Affirm Films, et que Gunn et les Erwin ont créé leur propre société de production, Kingdom Story Company, dans le cadre d'un accord de plusieurs millions de dollars avec Lionsgate.
Ces films sont d'une telle qualité qu'ils ont attiré des spectateurs bien au-delà de la population chrétienne. Ils n'assomment pas les spectateurs avec des prêches pesants et des acteurs inconnus, problèmes qui ont entaché de nombreux films religieux précédents.
Au contraire, ils créent des histoires vraies mettant en scène des acteurs grand public acclamés, tels que Kelsey Grammer, quatre fois lauréat d'un Emmy et célèbre pour "Frasier" (Jesus Revolution), et la star bien-aimée Dennis Quaid (I Can Only Imagine).
Mais aujourd'hui, ils ont attiré leur acteur le plus important, Hilary Swank (Boys Don't Cry, Million Dollar Baby), deux fois lauréate du prix de la meilleure actrice, dans le rôle principal du nouveau film Ordinary Angels (Anges ordinaires). Swank incarne une coiffeuse alcoolique du nom de Sharon Stevens, qui a touché le cœur de millions de personnes dans tout le pays en 1994 en tentant de sauver une fillette de 5 ans, Michelle Schmitt (Emily Mitchell), qui avait besoin d'une greffe de rein.
Stevens a également sauvé le père de Michelle, Ed (Alan Ritchson), de la ruine financière en se battant pour que les 500 000 dollars de dettes médicales de Michelle soient annulés contre toute attente. Alan Ritchson, star populaire de la série d'action à succès "Reacher" sur Amazon Prime, est un autre acteur impressionnant de ce film.
Ordinary Angels a un excellent sens de la gravité et des réalités difficiles, montrant le comportement sauvage de Sharon alimenté par l'alcool (tout en restant fidèle à son classement PG) dans la scène d'ouverture où elle boit de l'alcool et danse au sommet d'un bar avant de se réveiller avec une gueule de bois furieuse. Sa vie de femme de la classe ouvrière de Louisville est également attristée par sa relation avec son fils, âgé d'une vingtaine d'années, qui ne peut oublier tous les dommages que son esprit et son comportement dérangés lui ont causés en grandissant.
Ed est un couvreur en difficulté qui vient de perdre sa femme à cause d'une maladie mortelle, le laissant veuf, père célibataire de deux jeunes filles et croulant sous les dettes. Sharon découvre par hasard son histoire tragique en première page du journal lors d'une de ses descentes d'alcool matinales, et se retrouve bientôt à assister aux funérailles de la femme d'Ed, où elle se présente tout en dissimulant à peine son problème d'alcool.
Cette intrusion rend Ed méfiant à son égard, mais Sharon organise rapidement un "Hair-a-thon" de 24 heures où tout l'argent payé pour des centaines de coupes de cheveux s'élève à près de 4 000 dollars qu'elle apporte chez lui. Elle insiste pour l'aider de toutes les manières possibles et devient rapidement une "tante" pour les filles, leur offrant une présence féminine aimante en plus de leur grand-mère (Nancy Travis).
Elle apprend également à Ed à organiser ses finances désastreuses et à se préparer à lutter contre les hôpitaux et les compagnies d'assurance qui l'ont mis au bord de la ruine. Mais sa meilleure amie remarque que son dévouement sans fin à la famille est un "comportement de toxicomane" et qu'elle pourrait retomber dans la bouteille.
Sharon parviendra-t-elle vraiment à changer de vie ? Comment va-t-elle s'y prendre pour sauver la situation ? Et dans le dernier tiers du film, comment la ville de Louisville va-t-elle s'unir de façon incroyablement variée pour sauver la vie de Michelle ?
Ordinary Angels raconte une histoire extraordinaire avec une grande maîtrise technique et une forte capacité d'adaptation. Le fait qu'il s'agisse de personnes "ordinaires" qui relèvent le défi en fait une histoire qui peut inspirer les spectateurs, qu'ils soient chrétiens ou non, à réfléchir à la manière dont ils peuvent aider à servir les autres dans leur propre communauté d'une manière profonde et significative.
Swank a remporté des Oscars pour avoir incarné des personnages pleins de fougue, notamment dans son rôle de boxeuse dans Million Dollar Baby, et elle adopte ici une nouvelle approche. Sa Sharon ne peut être et ne sera jamais arrêtée dans sa quête, mais cette détermination d'acier n'est pas motivée par la colère et la force physique, mais par l'utilisation de ses émotions et de son charme pour gagner les autres.
Ritchson fait un virage à 180 degrés par rapport à sa performance de gars hyper dur dans "Reacher" pour montrer un gars qui a une attitude trop "virile" pour son propre bien. Il dédaigne l'aide de Sharon pendant une bonne partie du film, mais lorsqu'il se laisse enfin aller à l'émotion et accueille son aide, c'est une très belle performance qui est émouvante sans être étouffante.
Le film montre Ed et ses enfants comme des pratiquants malgré le fait qu'il ait renoncé à vénérer Dieu pendant un certain temps après la perte de sa femme, tandis que Sharon arrive prudemment à l'enterrement après une longue absence. Elle se fond subtilement dans la communauté et finit par s'attirer leur soutien dramatique et unique lors du dénouement (même si l'on sait que Michelle doit survivre pour mériter un film, le dernier tiers comporte plusieurs rebondissements imprévisibles).
Personne ne s'effondre sur le sol d'une église dans une capitulation angoissée, mais le fait que l'élévation spirituelle de ces vies soit ordinaire rend Ordinary Angels très utile pour atteindre des publics laïques et éviter de prêcher à la chorale. Je recommande de voir ce film dans les salles de cinéma ; il a obtenu une rare note positive de 99 % de la part du public et une remarquable note de 81 % de la part des critiques laïques, qui se moquent habituellement de ce genre de films.

 disponibles sur les canaux Facebook et Youtube de 1RCF Belgique
disponibles sur les canaux Facebook et Youtube de 1RCF Belgique