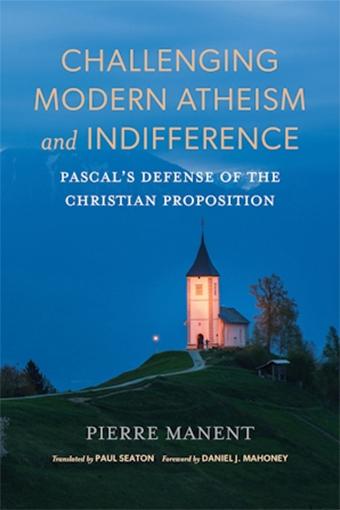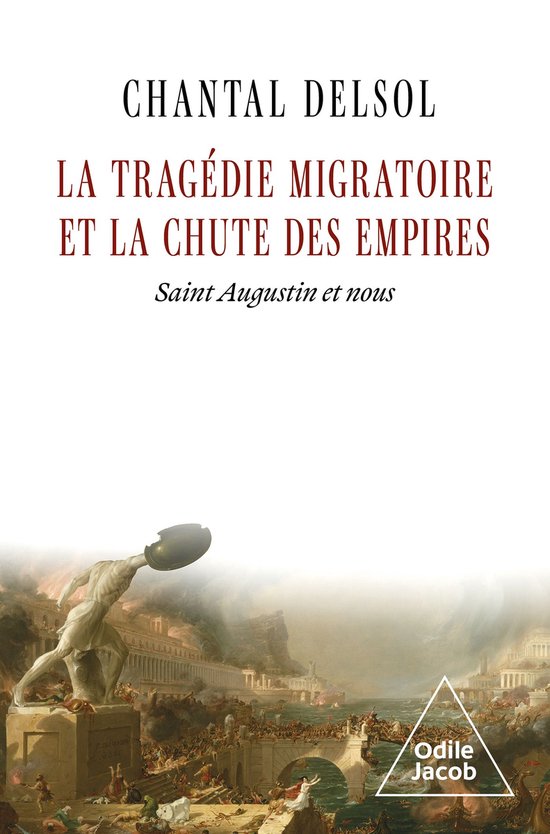De Stefan Rehder sur le Tagespost :
Dieu est-il mathématicien ?
20 février 2026
La physique classique a souvent été perçue comme une preuve de la validité d'une vision matérialiste et déterministe du monde, où Dieu et son action n'ont ni nécessité ni, à proprement parler, aucune place. La mécanique quantique démontre que cette idée est fausse. Nous ne vivons pas dans un univers constitué de particules microscopiques de matière qui s'assemblent pour former des particules toujours plus grandes, un univers qui pourrait s'expliquer entièrement par les forces qui s'exercent sur elles. La mécanique quantique montre que nous vivons dans un univers qui, en définitive, est constitué d'information.
Particulièrement enthousiasmant pour les chrétiens : les découvertes des physiciens quantiques sont non seulement compatibles avec les concepts métaphysiques d’ Aristote ou de saint Thomas d’Aquin , mais aussi avec la doctrine théologique de la « creatio continua », la création continue. Selon cette doctrine, Dieu n’a pas créé le monde une fois pour toutes pour ensuite l’abandonner, mais le maintient et le développe continuellement et activement par des processus naturels. Démontrer cela et encourager la réflexion à ce sujet est l’objet de notre sujet de la semaine. Les chrétiens peuvent donc se réjouir, car la mécanique quantique montre que la foi chrétienne ne contredit pas les découvertes des sciences naturelles, mais s’y harmonise parfaitement.
L'équation de Schrödinger
Lorsqu'Erwin Schrödinger (1887-1961) publia ses équations d'onde dans les « Annalen der Physik » en quatre numéros consécutifs au printemps 1926, rares étaient ceux qui soupçonnaient que le physicien autrichien avait couché sur le papier certaines des formules les plus importantes de l'histoire des sciences. S'appuyant sur l'idée du prince Louis de Broglie (1892-1987), aristocrate français qui, dans sa thèse de 1924 présentée à l'Université de Paris, avait avancé la thèse alors encore audacieuse selon laquelle si la lumière présentait des propriétés corpusculaires en plus de propriétés ondulatoires, alors on pouvait également s'attendre à ce que les particules possèdent des propriétés ondulatoires, Schrödinger développa une série d'équations différentielles décrivant l'évolution temporelle et spatiale d'une fonction d'onde.
Les formules entrées dans l'histoire sous le nom d'« équation de Schrödinger » se sont rapidement révélées extrêmement puissantes. Elles ont permis le calcul précis des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène et ont expliqué avec élégance ses raies spectrales discrètes. Ceci a permis la première compréhension globale de la stabilité atomique dans le cadre d'une théorie générale. Ces équations sont devenues des outils fondamentaux de la mécanique quantique et ont depuis été appliquées dans pratiquement tous les domaines de la physique et de la chimie modernes.
« Dès 1960, des historiens assidus avaient recensé plus de 100 000 articles utilisant les équations de Schrödinger, que son collègue Paul Dirac qualifiait avec admiration de condensées de toute la physique et de toute la chimie. Il suffisait de résoudre l’équation de Schrödinger appropriée pour comprendre le monde qui nous entoure », explique le physicien et historien des sciences renommé Ernst Peter Fischer dans son ouvrage de 2022, « L’Heure des physiciens ».
La base de presque tout ce qui est considéré comme « haute technologie » aujourd'hui.
« L’équation d’onde de Schrödinger est aussi fondamentale pour la physique quantique que les lois du mouvement de Newton le sont pour la physique classique », affirme l’astrophysicien Andrew May. Michio Kaku, l’un des physiciens les plus éminents des États-Unis, qui enseigne au Graduate Center de la City University of New York et anime une émission de radio hebdomadaire diffusée sur plus de 100 stations locales, s’enthousiasme : « Il m’arrive d’enseigner la mécanique quantique à des étudiants de niveau avancé et de leur faire comprendre que tout ce qui les entoure peut, en un sens, être décrit par l’équation de Schrödinger. Je leur fais prendre conscience que cette équation explique non seulement les atomes, mais aussi leurs liaisons pour former des molécules, et donc tous les composés chimiques qui constituent notre univers. »