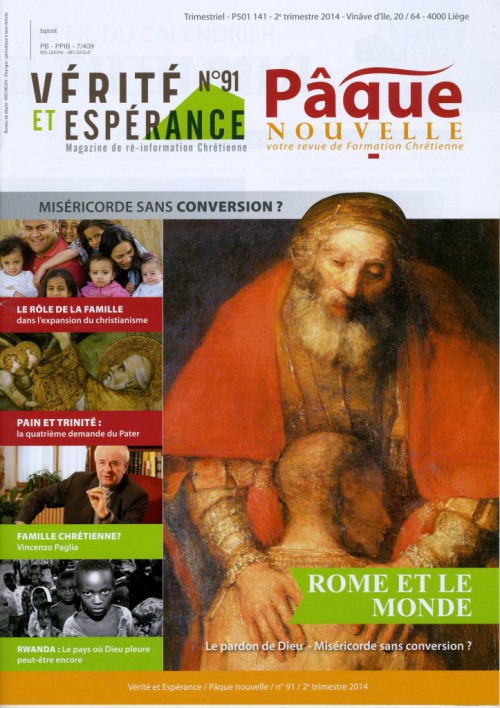Pour « La Vie », Jean Mercier a interviewé William T. Cavanaugh théologien catholique enseignant à l’université DePaul à Chicago : un penseur membre du mouvement théologique Radical Orthodoxy (en français : Orthodoxie radicale). Une des caractéristiques clés du mouvement est de prendre au sérieux les premiers commandements du Décalogue jusque dans ses dernières conséquences. Déjà considéré comme l’un des plus grands de sa génération, Cavanaugh travaille la théologie sur trois fronts qu’il ne cesse de faire dialoguer : la politique, l’ecclésiologie et l’éthique économique. JPSC
Pour « La Vie », Jean Mercier a interviewé William T. Cavanaugh théologien catholique enseignant à l’université DePaul à Chicago : un penseur membre du mouvement théologique Radical Orthodoxy (en français : Orthodoxie radicale). Une des caractéristiques clés du mouvement est de prendre au sérieux les premiers commandements du Décalogue jusque dans ses dernières conséquences. Déjà considéré comme l’un des plus grands de sa génération, Cavanaugh travaille la théologie sur trois fronts qu’il ne cesse de faire dialoguer : la politique, l’ecclésiologie et l’éthique économique. JPSC
Pourquoi remettez-vous en cause la séparation entre le religieux et le politique, alors que cette séparation est pour les chrétiens un des acquis positifs de la modernité, qui évite la confusion du temporel et du spirituel ?
Selon moi, le processus de sécularisation, commencé au XVIe siècle, est moins une séparation stricte entre le religieux et le politique qu’un déplacement de leurs frontières mutuelles. En fait, le sacré a progressivement migré de l’Église vers l’État : l’État moderne s’est constitué contre l’Église en absorbant ses prérogatives. Au fil des siècles, l’État s’est retrouvé toujours plus investi d’une dimension sacrée, surtout dans sa capacité à faire régner l’ordre et protéger socialement les citoyens, notamment par l’État providence, tandis que la religion a été progressivement reléguée vers l’espace intime, devenant de plus en plus inoffensive et insignifiante.
Seriez-vous nostalgique de l’ère constantinienne ?
Absolument pas ! Il est bon qu’on en soit sorti, et je n’ai aucune espèce de nostalgie pour l’alliance entre le trône et l’autel ! Mais je pense qu’il faut remettre en cause les termes mêmes de la division entre le religieux et le temporel. Je suis en faveur de la séparation entre l’État et l’Église, mais je m’oppose à une séparation entre le religieux et le politique. La distinction est cruciale.
Comment les chrétiens doivent-ils donc s’engager dans l’arène politique ?
Notre imagination s’est rétrécie en la matière. L’action politique n’est pas d’abord une stratégie d’influence pour faire pression sur ceux qui ont le pouvoir. Le lobbying ne doit pas être le premier réflexe du chrétien. Je ne dis pas que tout soit mauvais en la matière. Mais il faut une autre manière d’aborder les choses. Comme le dit Stanley Hauerwas, les chrétiens doivent désormais se penser comme des « résidents étrangers », comme des pèlerins conscients de leur vocation eschatologique et de leur appartenance au corps du Christ, qui est supérieure à leur citoyenneté terrestre. À cause de cela, ils doivent créer des communautés qui témoignent de cet autre ordre de valeurs auquel ils croient. Il faut que le corps du Christ se voie fortement à travers la vie radicalement différente de ses membres.
N’y a-t-il pas un prophétisme vraiment spécifique des chrétiens, par exemple quand ils dénoncent certaines ruptures anthropologiques ?
On peut toujours dénoncer… Ces derniers mois, les évêques américains ont été très en pointe sur le sujet. Ils ont fait campagne sur la liberté religieuse, contre la politique de santé d’Obama. Certes, le gouvernement n’a pas à nous imposer d’agir contre notre conscience. Mais je suis critique quand je vois comment la campagne a été menée, avec un discours apocalyptique sur la décadence de notre pays, sur fond d’exaltation nationaliste. Franchement, je pense qu’on irait mieux si les évêques se comportaient un peu moins comme des prophètes et un peu plus comme des pasteurs ! Quand on dénonce une situation, on doit toujours le faire dans une attitude prudentielle et déontologique. Il y a trop de rhétorique prophétique venant de l’Église, trop souvent sur la sexualité, alors qu’elle est trop réservée sur d’autres thèmes, comme la torture ou le traitement des immigrés de la frontière mexicaine.
Les chrétiens sont-ils voués à lutter à contre-courant ?
Les chrétiens peuvent avoir envie de se positionner en disant : nous rejetons la culture de mort, même si cela doit nous marginaliser car nous nous retrouvons minoritaires. Mais la marginalisation ne doit être acceptée que comme une conséquence de notre suivance du Christ, et non pas comme un but premier.
Jusqu’où faut-il assumer ses choix ?
Les catholiques américains qui sont montés à l’assaut d’Obama sur son programme de santé ont martelé le slogan selon lequel on n’a pas à choisir entre « être catholique » et « être américain ». Je crois au contraire que, si on a des convictions, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, et qu’il faut parfois choisir entre être un bon Américain et être un vrai catholique. Les évêques américains, souvent, ont choisi le patriotisme contre l’Évangile. Il est clair, par exemple, qu’au moment de la guerre en Irak, on ne pouvait pas être vraiment catholique – le pape avait sévèrement condamné la guerre – et passer pour un bon patriote aux yeux de tout le monde ! Si les catholiques avaient commencé par dire que ce n’était pas une juste guerre et qu’ils ne la feraient pas pour honorer la théorie catholique de la guerre juste, les choses auraient été différentes.
Le christianisme doit-il être une contre-culture ?
Non ! Car cela supposerait qu’il existe, en soi, un gros truc monolithique qui s’appelle la culture, et qu’il faudrait être soit pour, soit contre. Or, cette culture monolithique est un mythe. Dans la société, il y a des domaines dans lesquels les chrétiens sont contre-culturels, et d’autres pas. J’ai demandé un jour à un moine trappiste de venir faire une conférence sur le monachisme comme contre-culture. Il a beaucoup déçu mes étudiants en leur disant que c’était un non-sens ! Selon lui, la vie monastique n’est pas un refus, mais une affirmation. En tant que chrétien, vous serez toujours plus attirant en vivant concrètement ce que vous pensez, en étant un témoin. Je préférerais, par exemple, que les chrétiens créent des communautés économiques vraiment différentes, et pas seulement qu’ils manifestent devant la Banque mondiale !
Vous insistez souvent sur la dimension politique de l’eucharistie. Pourquoi ?
La liturgie incarne notre refus de la séparation entre la religion et la politique. Il y a quelque chose de très politique dans l’adoration du saint sacrement, par exemple : on n’a rien à faire, on a juste à être dans la présence de Dieu. C’est l’une des rares activités où l’on n’est pas en train de consommer ! C’est un acte politique. J’aimerais que ceux qui adorent l’eucharistie et ceux qui s’occupent de la justice sociale soient les mêmes.
Le témoignage doit-il aller jusqu’au martyre ?
Il y a aujourd’hui beaucoup de vrais martyrs, bien plus que sous l’Empire romain, et donc je ne voudrais pas en faire un concept métaphorique. Je parlerais plutôt de témoignage ascétique, notamment dans notre monde marqué par le consumérisme. L’idée de ne pas gratifier ses instincts est une idée subversive. Lorsque je fais mon cours sur l’Église et le consumérisme, je propose à mes étudiants non seulement de renoncer pendant trois semaines au portable, à l’Internet, au sexe, au tabac, à l’alcool, au sucre et aux ingrédients artificiels dans la nourriture, mais aussi de prier une partie de la journée en silence. Ils disent que cela les transforme. Cela peut rejoindre aussi les préoccupations que l’on peut avoir sur l’écologie. La racine du problème écologique est précisément que nous nous faisons nous-mêmes des dieux. Vivre l’humilité est un acte politique.
Réf : Pour William Cavanaugh, "le religieux est indissociable du politique"
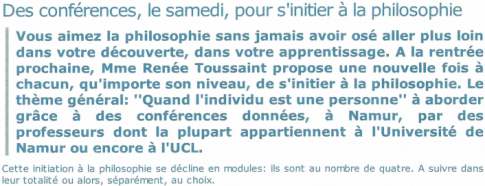
 FigaroVox a interrogé Jean-Sébastien Philippart, conférencier à l’’Ecole Supérieur des Arts de Bruxelles (extraits) :
FigaroVox a interrogé Jean-Sébastien Philippart, conférencier à l’’Ecole Supérieur des Arts de Bruxelles (extraits) : Pour « La Vie », Jean Mercier a interviewé William T. Cavanaugh théologien catholique enseignant à l’université DePaul à Chicago : un penseur membre du mouvement théologique Radical Orthodoxy (en français : Orthodoxie radicale). Une des caractéristiques clés du mouvement est de prendre au sérieux les premiers commandements du Décalogue jusque dans ses dernières conséquences. Déjà considéré comme l’un des plus grands de sa génération, Cavanaugh travaille la théologie sur trois fronts qu’il ne cesse de faire dialoguer : la politique, l’ecclésiologie et l’éthique économique. JPSC
Pour « La Vie », Jean Mercier a interviewé William T. Cavanaugh théologien catholique enseignant à l’université DePaul à Chicago : un penseur membre du mouvement théologique Radical Orthodoxy (en français : Orthodoxie radicale). Une des caractéristiques clés du mouvement est de prendre au sérieux les premiers commandements du Décalogue jusque dans ses dernières conséquences. Déjà considéré comme l’un des plus grands de sa génération, Cavanaugh travaille la théologie sur trois fronts qu’il ne cesse de faire dialoguer : la politique, l’ecclésiologie et l’éthique économique. JPSC Comment accepter de recevoir d’un autre son identité ? Comment penser l’identité et l’altérité comme des limites créatrices ? De Thibaud Collin, philosophe, membre du conseil éditorial de Liberté politique (Dernier ouvrage paru :
Comment accepter de recevoir d’un autre son identité ? Comment penser l’identité et l’altérité comme des limites créatrices ? De Thibaud Collin, philosophe, membre du conseil éditorial de Liberté politique (Dernier ouvrage paru :