Le 17 mars dernier, au cours de sa messe matinale à la maison Sainte-Marthe où il réside, le pape François a répété l’un de ses leitmotivs favoris : « Si nous tous étions miséricordieux, si les peuples, les personnes, les familles, les quartiers avaient cette attitude de la miséricorde, nous aurions tellement plus de paix dans le monde, dans nos cœurs ! Parce que la miséricorde nous porte à la paix. Rappelez-vous donc toujours de cette phrase : ‘Qui suis-je pour juger ?’ »
Cet optimisme n’est-il pas contredit, de prime abord, par l’ordre aveugle et impassible de la nature qui semble gouverner ce monde ?
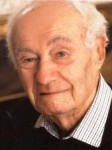 Dans « L’ignorance étoilée » (Fayard, 1974), Gustave Thibon a consacré un chapitre à la justice et à la miséricorde confrontées aux lois inexorables de l’univers. En voici quelques extraits, à partir de la citation d’un paradoxe énoncé par Simone Weil : « La nécessité, en tant qu’absolument autre que le bien, est le bien lui-même’ » » : le bien c’est donc le consentement intérieur à un ordre où la miséricorde et la puissance n’ont aucun lien apparent entre elles (JPSC) :
Dans « L’ignorance étoilée » (Fayard, 1974), Gustave Thibon a consacré un chapitre à la justice et à la miséricorde confrontées aux lois inexorables de l’univers. En voici quelques extraits, à partir de la citation d’un paradoxe énoncé par Simone Weil : « La nécessité, en tant qu’absolument autre que le bien, est le bien lui-même’ » » : le bien c’est donc le consentement intérieur à un ordre où la miséricorde et la puissance n’ont aucun lien apparent entre elles (JPSC) :
"Cette pensée contredit l’éternel rêve de l’homme : celui d’une puissance surnaturelle qui, non seulement aurait pitié de nous, mais dont la miséricorde se traduirait par des grâces, des faveurs, voire des miracles sur le plan temporel. Le rêve d’une providence qui desserrerait pour nous l’étau de la nécessité en faisant pleuvoir dans nos mains ou dans nos âmes – c’est-à-dire au niveau de l’événement extérieur ou intérieur – des bienfaits étrangers à l’inexorable enchaînement des effets et des causes ou sans proportion avec nos efforts pour modifier cet enchaînement.
∂
Seigneur, ayez pitié de moi ! cela signifie presque toujours : Seigneur, séparez-moi de mon destin, épargnez-moi d’être brisé par cette nécessité que vous avez créée et à laquelle vous vous êtes soumis sous les oliviers et sur la croix, faites avorter en moi la contradiction qui est semence de Dieu dans l’homme, déchirez avant terme ce voile d’apparences qui ne doit s’ouvrir qu’à la mort, faites que le vrai me devienne vérifiable, sinon dans l’événement extérieur, du moins à la surface de la vie intérieure, dans mes sentiments, mes états d’âme : donnez à mon âme une nouvelle teinture, mais gardez-vous bien de la tuer pour qu’elle renaisse, car je ne veux pas changer d’âme, je ne veux pas d’un cœur nouveau, je veux un cœur repeint, remis à neuf du dehors, tout luisant du vernis divin. Ce qui revient à dire : que votre puissance me protège contre l’appel dévorant de votre pureté ; soyez pour moi l’apparence qui sauve et non la réalité qui tue.
∂
Pour que la miséricorde soit pure, il faut qu’elle soit sans puissance et, apparemment, sans effet. J’entends sans effet sur la nécessité pour être reçue, dans la plénitude sans limite, par la liberté. Sans effet sur la mort pour préparer la résurrection. Sinon les rapports entre l’âme et dieu restent sur le plan de l’avoir : ce sont des rapports entre le puissant et le faible, entre le maître et l’esclave. Car Dieu est plus faible que nous en ce monde, et sa miséricorde est celle d’un être qui ne peut rien donner, comme le mot l’indique, que son cœur.
On peut même interpréter dans ce sens la distinction classique entre la justice et la miséricorde de Dieu. Dieu est juste en tant qu’il a délégué sa puissance à l’inexorable nécessité : dans ce domaine, pas de faveurs, pas de passe-droit ; la gratuité est absente ; l’effet, impitoyable, suit la cause et chacun recueille jusqu’au bout le fruit de ses actes. « Vous ne sortirez pas d’ici que vous n’ayez payé la dernière obole… »
Mais Dieu est infiniment miséricordieux en tant qu’amour, dans son essence solitaire, hors de la création et de ses lois : « Je ne donne pas comme le monde donne. » La justice est la loi de la création, la miséricorde est la loi de l’incréé. Deux lois absolument étrangères et irréductibles l’une à l’autre – et qui, cependant, s’identifient dans la mesure où on accepte, par amour et par respect de la seconde, d’obéir sans restriction à la première, car alors nécessité et liberté, temps et éternité, vie et mort ne s’opposent plus : « tout est fruit pour moi de ce qu’apportent les saisons, ô nature ! » Mais il faut subir jusqu’au bout la justice de Dieu pour rencontrer sa miséricorde.
∂
Simone Weil dit que l’absence totale de miséricorde ici-bas est le signe de la miséricorde de Dieu. Cette absence ne peut pas être totale, car alors que saurions-nous de la miséricorde de Dieu ? Disons que la miséricorde est absente de la nature, mais présente dans le centre divin de l’âme. Pour moi, je n’ai jamais senti la miséricorde de Dieu à mon égard, mais la pitié que j’éprouve pour les misérables me fait croire que Dieu a pitié de moi comme j’ai pitié de mes frères. Je reçois la miséricorde dans la mesure où je l’éprouve. Je suis du péché qui pleure et ne juge pas – et si le péché est capable de miséricorde, quelle doit être la compassion d’un Dieu infiniment pur ?
∂
Loi du créateur : croissez et multipliez. La loi du sauveur est inverse : elle nous enseigne l’effacement, la décroissance (il faut que je diminue pour qu’il croisse… si le grain ne meurt…) et le retour à l’unité par la chasteté et par la mort.
La première loi est de la vie temporelle, car Dieu ne peut créer que dans le temps ; la seconde loi est de la vie éternelle, car Dieu ne peut sauver qu’au-delà du temps.
La première conséquence du premier précepte est de manger, car la vie temporelle ne peut se maintenir que par un carnage réciproque et perpétuel.
La première conséquence du second précepte est de se laisser manger. Et le Christ l’a subi dans toute sa force en perpétuant l’Eucharistie par le sacrifice de la croix, en se faisant pain, en s’anéantissant dans nos bouches impures. Par là le Sauveur rachète la « faute » du Créateur, le Dieu-victime transfigure l’œuvre du Dieu-bourreau. L’homme, en mangeant, ne peut qu’entretenir quelques instants cette mort masquée et agitée qu’est la vie temporelle, mais Dieu, en se laissant manger, nous donne la vie éternelle. »
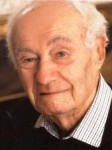 Dans « L’ignorance étoilée » (Fayard, 1974), Gustave Thibon a consacré un chapitre à la justice et à la miséricorde confrontées aux lois inexorables de l’univers. En voici quelques extraits, à partir de la citation d’un paradoxe énoncé par Simone Weil : « La nécessité, en tant qu’absolument autre que le bien, est le bien lui-même’ » » : le bien c’est donc le consentement intérieur à un ordre où la miséricorde et la puissance n’ont aucun lien apparent entre elles (JPSC) :
Dans « L’ignorance étoilée » (Fayard, 1974), Gustave Thibon a consacré un chapitre à la justice et à la miséricorde confrontées aux lois inexorables de l’univers. En voici quelques extraits, à partir de la citation d’un paradoxe énoncé par Simone Weil : « La nécessité, en tant qu’absolument autre que le bien, est le bien lui-même’ » » : le bien c’est donc le consentement intérieur à un ordre où la miséricorde et la puissance n’ont aucun lien apparent entre elles (JPSC) :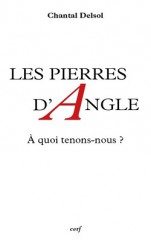
 Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré
Le nouvel évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, a inauguré 
