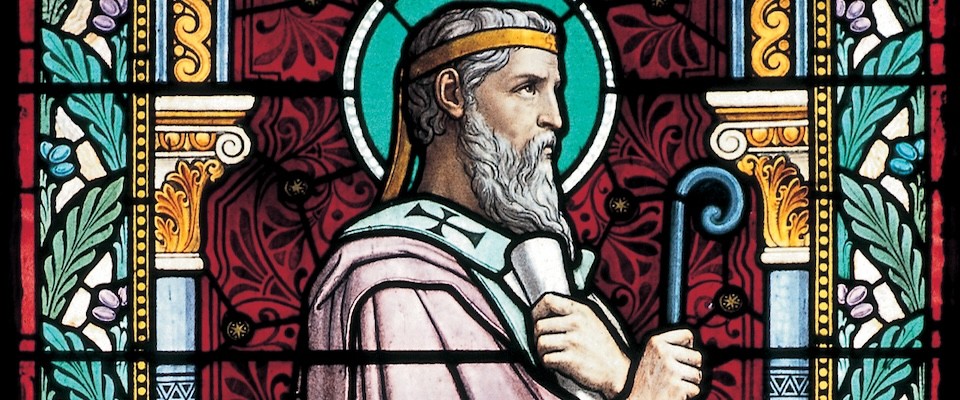De George Weigel sur First Things :
La « Conversation dans l’Esprit » et l’avenir catholique
Différentes cultures – anglaise, turque, chinoise – prétendent avoir inventé la maxime « Le poisson pourrit par la tête » (une maxime favorite dans la capitale de votre pays pendant les années malheureuses où les Redskins/Commanders appartenaient à Daniel Snyder). Appliqué à l’Église, cet idiome suggère que lorsque la théologie est décadente, de mauvaises choses s’ensuivront dans la vie de la foi. Ou, pour le dire plus rigoureusement, un catholicisme intellectuellement décadent (le catholicisme allégé) mène inévitablement à un catholicisme mort (le catholicisme zéro).
Ce qui nous amène à la conférence sur « L’avenir de la théologie », parrainée par le Dicastère pour la culture et l’éducation du Vatican et qui s’est tenue à l’Université pontificale du Latran les 9 et 10 décembre derniers.
Parmi les intervenants vedettes de la conférence figuraient le père James Keenan, SJ, du Boston College, et le Dr Nancy Pineda-Madrid de l'université Loyola Marymount de Los Angeles.
Le père Keenan s’est fait connaître du grand public en 2003, lorsque, lors d’un témoignage devant le Comité judiciaire de l’Assemblée législative de l’État du Massachusetts, il s’est opposé à un projet de loi définissant le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme, le qualifiant de « contraire à l’enseignement catholique sur la justice sociale », car une telle loi constituerait une « discrimination active et injuste contre les droits sociaux fondamentaux des homosexuels et des lesbiennes ». Lors de la conférence du Latran en décembre dernier, Keenan aurait consacré une partie considérable de son temps à fustiger Donald Trump, dont le lien avec « l’avenir de la théologie » n’est pas immédiatement évident.
La page de la faculté du Dr Pineda-Madrid sur le site Web de la LMU la décrit comme « une théologienne féministe qui étudie l'expérience de la foi latino/x » et l'auteur d'un livre « plaidant pour une nouvelle interprétation théologique du salut où la vie des femmes compte ». En juin 2024, elle a été élue présidente de la Catholic Theological Society of America. Mais les théologiens de la CTSA représentent-ils « l'avenir de la théologie » ?
Les preuves de ce phénomène ne sont pas abondantes dans l’université de Pineda-Madrid. En effet, alors que Loyola Marymount compte actuellement 7 094 étudiants de premier cycle, le site Internet « Institutional Research and Decision Support » de la LMU indique que l’université a décerné une licence en théologie au cours de l’année universitaire 2023-2024. Ce manque marqué d’intérêt des étudiants pourrait s’expliquer en partie par la page de la faculté de la collègue du Dr Pineda-Madrid au département de théologie de la LMU, le Dr Layla Karst, qui propose un séminaire intitulé « Bad Catholics ». Les étudiants y apprennent des « voix » de « théologiens féministes, de théologiens noirs et féministes, de théologiens queer et d’éco-théologiens » sur la « lutte pour la croyance orthodoxe et la bonne pratique qui se déroule dans le cadre de relations de pouvoir asymétriques ».
Le fait que plusieurs des participants à la conférence du Latran aient refusé de discuter en détail de ce qui s’y était dit en dit long sur l’atmosphère d’intimidation ecclésiastique qui règne actuellement à Rome, même si une âme courageuse a qualifié la conférence de « fade ». Indépendamment de la théologie qui a encadré le contenu de la conférence, l’imposition aux participants de la méthode de discussion en petits groupes de la « Conversation dans l’Esprit » garantissait qu’il n’y aurait pas d’échange de vues vigoureux du type de ceux qui caractérisaient autrefois les universités catholiques médiévales, où même les professeurs les plus éminents étaient censés défendre publiquement leurs positions, longuement et en profondeur, contre tous les interlocuteurs.
En effet, malgré le battage médiatique qui a été fait autour de son utilisation lors des deux derniers synodes – et qui s’appuie sur cette expérience –, la « Conversation dans l’Esprit » est un instrument de manipulation, et non un processus qui donne lieu à une conversation ou à un débat sérieux. Les participants (dont certains étaient brillants et érudits) ont eu deux minutes au cours du « Moment One » pour partager leurs idées ou leurs réactions à ce que les principaux orateurs ont dit à l’ensemble de la conférence ; une minute de silence a suivi ; les participants ont eu deux minutes supplémentaires pour dire « ce qui les a le plus touchés parmi les contributions partagées par les autres au cours du Moment One » (note : pas ce qu’ils auraient pu penser être une absurdité totale) ; une autre minute de silence a suivi ; et enfin, le « secrétaire et l’animateur » du groupe ont concocté « un résumé concis à présenter à l’assemblée ».
Si vous pouvez imaginer une délibération sérieuse sur n’importe quel sujet émergeant d’un processus dans lequel un minuteur humain contrôle le flux de la discussion, eh bien, votre imagination est plus fertile que la mienne.
Il est absurde de suggérer qu’un « avenir de la théologie » créatif et évangélique sera défini par un jeu de cartes truqué de grands intervenants et un processus infantilisant. Pire encore, cependant, est-ce que, dans certains milieux, cette méthodologie de « Conversation dans l’Esprit » semble être considérée comme un modèle pour tous les organes délibératifs catholiques. Cela pourrait-il inclure, dans certains esprits, les congrégations générales de cardinaux qui précèdent un conclave ? Certains pourraient-ils même oser suggérer que le conclave lui-même devrait être conduit selon la méthode de la « Conversation dans l’Esprit » ?
Ces inquiétudes ont été exprimées discrètement à Rome le mois dernier. Et c'est tout à fait normal.
La chronique de George Weigel « La différence catholique » est syndiquée par le Denver Catholic , la publication officielle de l'archidiocèse de Denver.
----------------------George Weigel est membre éminent du Centre d'éthique et de politique publique de Washington, DC, où il est titulaire de la chaire William E. Simon en études catholiques.