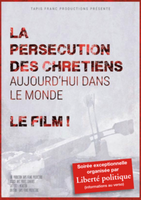MARIANNE DURANO : « ET SI ON LAISSAIT LA VIE NOUS SURPRENDRE ? »
Le coin des experts de genethique.org
Dans le livre qu’elle vient de publier « Mon corps ne vous appartient pas »[1], Marianne Durano raconte « l’histoire d’une dépossession et le témoignage d’une reconquête », celle de la femme et de son corps. Elle revient pour Gènéthique sur l’expérience « à corps perdu » de ce livre.
Gènéthique : Qu’est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre ?
Marianne Durano : Au départ, je voulais faire une thèse sur les biotechnologies, particulièrement les dernières innovations en matière de procréatique. Pendant mon master 2, je suis « tombée » enceinte de mon premier enfant, vivant, pour ainsi dire à vif, l'engendrement dont j'étudiais en même temps les manipulations techniques. Ma grossesse a été une double révélation. D'une part, je découvrais soudainement que j'avais un corps de femme, merveilleux, complexe... et parfois encombrant. D'autre part, simultanément, je vivais l'emprise médicale comme une dépossession : mon corps devenait l'objet d'une surveillance, comme s'il ne m'appartenait plus.
Mon corps de mère était pesé, ausculté, réifié : les gynécologues à qui j'avais affaire n'y voyaient que des pathologies potentielles, quand ils ne se permettaient pas des remarques paternalistes. Au même moment, à l'université, parmi mes amis, j'avais l'impression d'être devenue un ovni (objet vivant non-identifié) : quelle idée d'avoir un enfant à 23 ans, alors qu'on n'a pas fini ses études ? Quelle indécence d'étaler ainsi son corps de femme enceinte dans les allées de la bibliothèque ? Mon corps, dont je réalisais le mystère, était considéré comme un phénomène gênant dans l'espace public, comme un mécanisme dangereux dans les cabinets médicaux. Comment en étions-nous arrivés là ? Pourquoi me sentais-je moi-même mal-à-l'aise dans ce corps sexué ? Pourquoi acceptais-je sans broncher les regards et les mains froides des médecins ? A partir de cette expérience de la grossesse, j'ai relu tout mon parcours de jeune femme moderne : la puberté, les premières relations sexuelles, la première contraception, les règles, les discours de prévention, les modèles de féminité qu'on nous propose. Partout la même logique technicienne, qui trouve son aboutissement dans la procréation artificielle, et son origine dans un corpus philosophique qui dévalue systématiquement la noblesse du corps féminin.
G : Vous dénoncez une aliénation du corps de la femme à la technique qui fonctionne comme un miroir aux alouettes et, loin de la libérer, elle maintient la femme sous domination masculine. Comment cette domination, que vous déclinez de la contraception à l’avortement, de la PMA à la GPA, se joue-t-elle ?
MD : Il y a bien des manières de répondre à cette question. Pour commencer, on propose aux femmes une émancipation qui passe par la mise sous contrôle de leur corps et de leur fécondité. On leur demande de s'adapter à des rythmes – sexuels, affectifs, professionnels – qui sont pensés par et pour les hommes. Ainsi la pilule permet-elle aux jeunes filles d'être disponibles sans restriction au désir masculin, sans que ces derniers aient à assumer aucune responsabilité dans la prise en charge de la contraception. Toutes les techniques de contrôle de la fécondité féminine permettent aux hommes, et à la société toute entière, de se désengager totalement sur cette question, laissant les femmes seules devant leur gynéco, leur plaquette de pilule, leur contraception d'urgence, leur test de grossesse. De même, la carrière-type – des études longues, une productivité maximale autour de la trentaine, le placard passé 45 ans – est absolument contradictoire avec l'horloge biologique des femmes : une grande fécondité avant 25 ans, de jeunes enfants entre 25 et 40 ans, la vie devant soi pour mener d'autres projets après la ménopause. Conséquence : les femmes s'infligent une contraception hormonale lorsqu'elles sont fécondes, au risque d'avoir plus tard des difficultés à concevoir un enfant naturellement. Or, plutôt que d'adapter notre société au corps féminin, on préfère plier ce dernier à coup de techniques toujours plus innovantes : congélations d'ovocytes, stimulations ovariennes, PMA, voire GPA. Selon le rapport d'activité du CNSE (Centre National des Soins à l’Étranger) pour l'année 2015, 50,2% des femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger avaient plus de quarante ans. Le nombre de femmes ayant leur premier enfant passé la quarantaine a ainsi triplé en 20 ans. Pas étonnant, dans ces conditions, qu'on réclame à grands cris la PMA pour toutes !