Les réseaux sociaux catholiques semblent en feu. Le départ du Père Michel-Marie Zanotti-Sorkine agite les esprits. Dans le journal « La Croix », Isabelle de Gaulmyn y va d’un commentaire digne du style d’une certaine pièce de Molière : Site d'Isabelle de Gaulmyn . Non sans s’attirer cette réplique très pertinente sur le blog « Le Suisse Romain », alias l’abbé Dominique Rimaz :
« Sans entrer dans les nombreuses polémiques, la question du reproche du manque d'obéissance du Père me laisse quelque peu perplexe, avec un goût quelque peu amer. Certes, il est absolument vital pour tous les prêtres de vivre dans la communion, le respect et l'obéissance envers l' évêque. Pour un prêtre, rien ne se fait sans son évêque. Ceci est un absolu !
Cependant, le reproche du manque d'obéissance ne semble subitement concerner que le Père Zanotti !? Que chacun fasse son propre examen de conscience. Si tous les chrétiens vivaient en communion avec toute l'Eglise, Une, Sainte, Catholique, Apostolique et romaine, avec le Pape, le doux vicaire du Christ, alors les avalanches de commentaires agressifs cesseraient d'eux-mêmes.
Le Père Zanotti est très exposé, par ses livres, ses publications, ses apparitions dans les médias et sa présence sur les nouveaux réseaux sociaux. La jalousie n'est jamais très loin. Personnellement, j'ai beaucoup reçu de Dieu, par le Père Michel-Marie.
Sans doute que sa prise de position à propos du Père Marie-Dominique Philippe ne fut pas en communion avec les décisions du Saint-Siège. Mais très honnêtement, peut-on tomber aussi lourdement sur un prêtre ?
Les chrétiens sont parfois lourds, alors que nous devons être légers
Lors de la levée des excommunications des 4 évêques intégristes, la planète médiatique chrétienne s'était aussi enflammée dans de plus grande proportion encore. Benoît XVI, tel un saint, avait lancé cet avertissement:
Mordez-vous les uns les autres ?
... Car toute la Loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde: vous allez vous détruire les uns les autres !" J’ai toujours été porté à considérer cette phrase comme une des exagérations rhétoriques qui parfois se trouvent chez saint Paul. Sous certains aspects, il peut en être ainsi.
Mais malheureusement ce "mordre et dévorer" existe aussi aujourd’hui dans l’Église comme expression d’une liberté mal interprétée. Est-ce une surprise que nous aussi nous ne soyons pas meilleurs que les Galates? Que tout au moins nous soyons menacés par les mêmes tentations? Que nous devions toujours apprendre de nouveau le juste usage de la liberté? Et que toujours de nouveau nous devions apprendre la priorité suprême : l’amour ? »
Réf: Le départ du Père Michel-Marie Zanotti Sorkine devient une affaire
C'est vrai que la leçon vaut pour chacun d'entre nous.
Mais, pour conclure, je ne résiste pas à la tentation d'emprunter à l'un des commentateurs de l'article du "Suisse Romain" cette citation de Boileau:
"Sitôt que d'Apollon un génie inspiré
Trouve loin du vulgaire un chemin ignoré,
En cent lieux contre lui les cabales s'amassent ;
Ses rivaux obscurcis autour de lui croassent ;
Et son trop de lumière, importunant les yeux,
De ses propres amis lui fait des envieux..."
Boileau
Épître à Racine (9-14)
JPSC
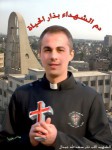 AED : votre Excellence, craignez-vous la fin de la chrétienté en Irak ?
AED : votre Excellence, craignez-vous la fin de la chrétienté en Irak ? Les scandales qui, dans l’Église, impliquent des fondateurs connus de communautés religieuses peuvent légitimement déstabiliser. Il n’est pas inutile de réfléchir aux causes de tels scandales, et notamment au contexte trop laxiste des années 70 et bien prendre en compte combien l’institution ecclésiale est nécessaire pour structurer et orienter les jeunes communautés.
Les scandales qui, dans l’Église, impliquent des fondateurs connus de communautés religieuses peuvent légitimement déstabiliser. Il n’est pas inutile de réfléchir aux causes de tels scandales, et notamment au contexte trop laxiste des années 70 et bien prendre en compte combien l’institution ecclésiale est nécessaire pour structurer et orienter les jeunes communautés. De Stefano Gennarini sur
De Stefano Gennarini sur  (…) Après la Corée, le Sri Lanka et les Philippines, un autre pays d’Asie est déjà en train de se préparer à recevoir la visite du pape : le Japon (…).
(…) Après la Corée, le Sri Lanka et les Philippines, un autre pays d’Asie est déjà en train de se préparer à recevoir la visite du pape : le Japon (…).
 Haut-lieu de la liturgie célébrée en latin et en grégorien, cette fille de l’abbaye de Fontgombault est aujourd’hui à l’étroit dans ses murs. Lu sur le site du « Salon beige » :
Haut-lieu de la liturgie célébrée en latin et en grégorien, cette fille de l’abbaye de Fontgombault est aujourd’hui à l’étroit dans ses murs. Lu sur le site du « Salon beige » :