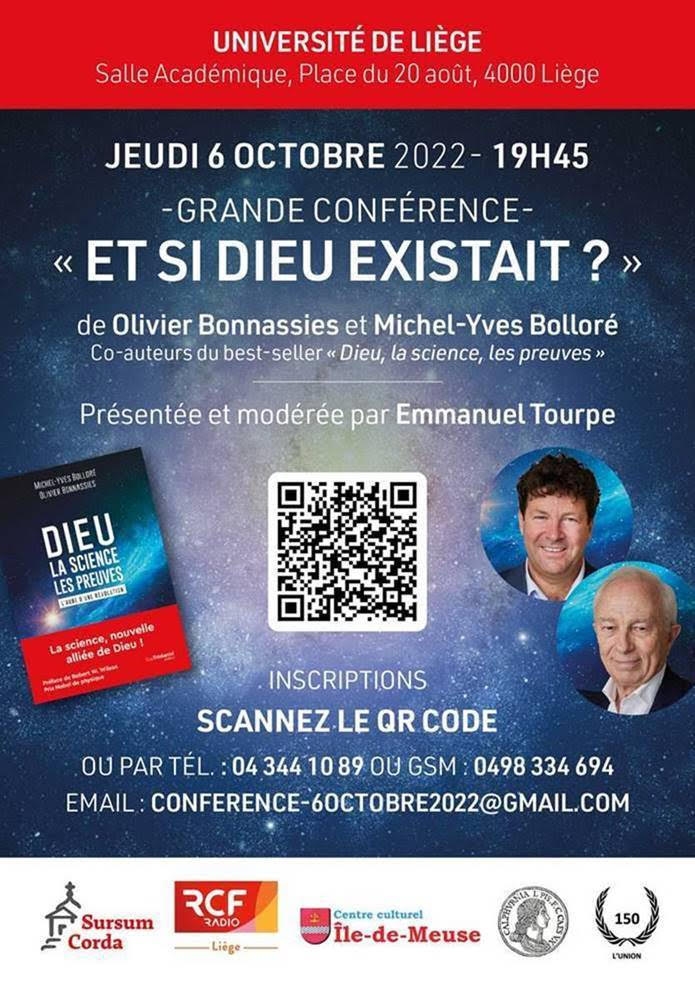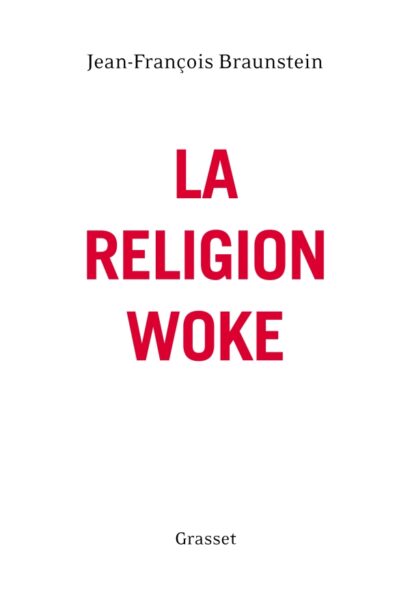De kath.net/news :

Le "Nouvel ordre mondial" : une théorie du complot ou une vision politique ?
13 septembre 2022
Cardinal Gerhard Müller : "Le déclin de l'Eglise en Allemagne et en Europe n'est pas dû à la sécularisation, au combat de l'Eglise... mais au manque de foi, à l'amour refroidi des catholiques..." interview kath.net par Lothar C. Rilinger
Vatican (kath.net) L'expression "Nouvel ordre mondial" est interprétée comme une métaphore de la théorie du complot. Pourtant, il ne fait que décrire un projet de société qui - comme tout autre - doit se confronter au discours intellectuel. La chute du communisme en 1989/90 marque la fin d'un processus historique que le sociologue américain Francis Fukuyama a qualifié de fin de l'histoire. Selon lui, le communisme avait fait son temps en tant qu'antithèse de la démocratie, de sorte qu'il fallait penser à une nouvelle base sociale. Une nouvelle compétition était ainsi ouverte : Il s'agit de l'avenir du développement social au-delà du marxisme. La lutte des classes de type marxiste devrait avoir fait son temps - ce que les marxistes ne sont toutefois pas prêts à accepter - mais dans la lutte pour la suprématie dans le discours sur la société et l'État, le modèle démocratique n'était plus non plus considéré comme un idéal. Le principe "un homme, une voix" est associé à l'époque des Lumières. C'est pourquoi il doit être transgressé afin de pouvoir attribuer l'attribut de "progrès" à l'évolution de la société. On se réfère ainsi à un principe selon lequel l'homme - détaché de Dieu, qui n'est plus supposé exister - peut faire tout ce qu'il peut. L'autolimitation est un obstacle au progrès.
Comme Dieu est rejeté en tant qu'instance ultime de l'action humaine dans la croyance au progrès, le Nouvel Ordre Mondial doit construire une société qui ne connaît pas de limites et dans laquelle tout ce que les hommes sont capables de développer et de penser est autorisé ; rien ne doit entraver le progrès ou l'empêcher de se développer. La métaphysique, considérée comme prémoderne, est bannie du discours social et, avec elle, la croyance en une rédemption de l'homme dans l'éternité. Seul doit être valable ce qui peut être falsifié ou vérifié, de sorte que la rédemption de l'homme doit avoir lieu sur terre, dans la vie terrestre. Ce que Karl Marx a appelé le paradis sur terre doit être atteint d'une autre manière grâce au progrès qui caractérise le Nouvel ordre mondial. Comme cet ordre mondial nie le recours à Dieu et le déclare, comme Feuerbach, inexistant, il n'est pas étonnant que l'ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Gerhard Ludwig Müller, se sente interpellé et condamne le Nouvel ordre mondial. Nous nous sommes entretenus avec lui à ce sujet.
Rilinger : Depuis quelques décennies, l'exigence selon laquelle l'ordre mondial existant doit être remplacé par un ordre qui ne connaît plus le recours à Dieu, mais seulement celui au progrès inconditionnel, hante à nouveau le discours politique. La revendication de cet ordre mondial, appelé "Nouvel ordre mondial", se fait presque en marge du discours politique, public. Que devons-nous comprendre par "Nouvel ordre mondial" ?
Cardinal Gerhard Ludwig Müller : Aussi bien selon la confession de foi juive que chrétienne, c'est Dieu lui-même qui, dans sa souveraine bonté, a créé le monde à partir du néant et l'a ordonné dans sa parole (logos, raison) et son esprit (force, sagesse) éternels. La raison humaine est finie et en principe - en raison du péché originel - susceptible d'être perturbée par des pulsions égoïstes, comme le désir désordonné de pouvoir, d'argent, de jouissance de soi/plaisir. L'homme est donc intellectuellement et moralement faillible.