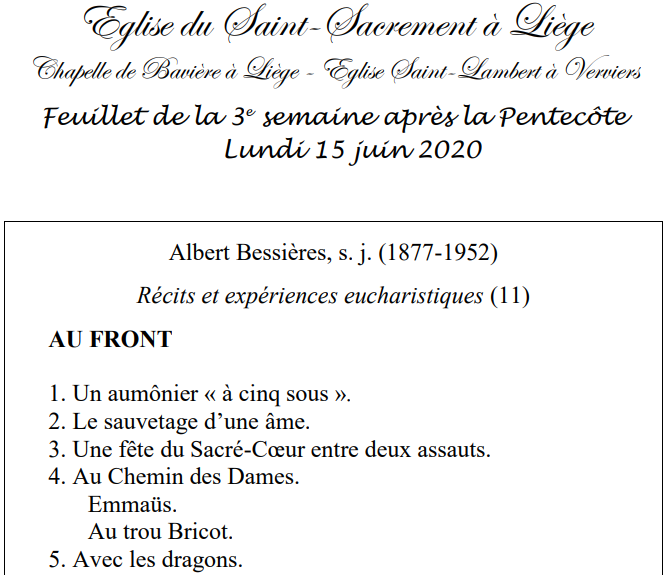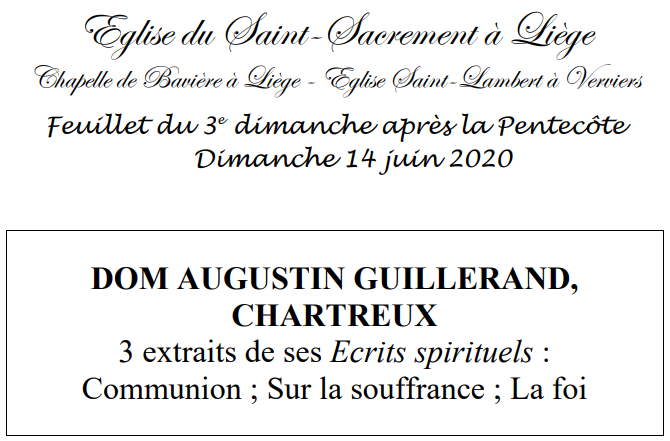En conformité avec les « normes sanitaires » imposées, près de 80 fidèles, de tous âges et de tous milieux, ont pu se réunir, en l'église du Saint-Sacrement au Bd d'Avroy, autour de l’évêque de Liège pour assister à cette grande fête d’origine liégeoise. La messe était chantée selon la forme extraordinaire du rite romain.
Téléchargez ici le feuillet pour suivre cette messe.
Voici le texte de l’homélie prononcée par Monseigneur Delville :
« Chers Frères et Sœurs,
La Fête-Dieu de cette année est placée sous le signe des retrouvailles. C’est la première fête que nous pouvons célébrer en étant corporellement présents, même si notre nombre est limité. C’est pourquoi cette messe est aussi retransmise par les médias pour tous ceux qui n’ont pas pu être matériellement présents. Nous avons découvert durant la période de confinement combien la participation directe à la liturgie nous manquait et combien nous désirions la communion au corps du Christ. Le sens même du sacrement, comme signe sacré de la grâce de Dieu, nous apparaissait d’autant plus que nous en étions privés. Or voici que nous pouvons nous retrouver lors de la seule fête liturgique qui soit consacrée à un sacrement, la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, la Fête-Dieu.
Si sainte Julienne de Cornillon a reçu l’inspiration de faire célébrer cette fête, c’est qu’elle avait compris combien le sacrement actualise en nous la vie du Christ. En effet la vie du Christ ne se résumé pas à son aspect historique ; elle se prolonge en chacun de nous par un signe qui nourrit chacune de nos vies. Nous fêtons donc aujourd’hui autant le signe – l’hostie consacrée – que la réalité personnelle qu’elle représente, le Christ lui-même.
Or ce fut la volonté de Jésus lui-même que de prolonger sa vie terrestre par un signe perpétuel. C’est le geste qu’il a fait à la dernière cène, comme nous le raconte saint Paul dans sa 1e lettre aux Corinthiens (1 Cor 11,23-26) : « Le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, prit du pain et rendant grâces, le rompit et dit : prenez et mangez, ceci est mon corps, qui sera livré pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». Donc Jésus, face à la souffrance et à la mort, partage le pain et le vin, en tant que son corps et son sang. Face à la fragilité de sa vie, à l’échec apparent de sa mission, face à la pauvreté des disciples qui vont se sentir abandonnés, Jésus ne baisse pas les bras, il ne tombe pas dans la déprime, encore moins dans la fuite. Il partage cette nourriture essentielle d’un repas, que sont le pain et le vin, en disant qu’ils sont son corps et son sang. Ils représentent une vie fragile, une vie qui va être enlevée. Mais ils représentent en même temps un partage de cette vie et une démultiplication de ses effets : « faites ceci en mémoire de moi ». Le corps et le sang du Christ, donnés en communion, nous associent aujourd’hui à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Notre pauvreté est dépassée, nous sommes rassasiés ; nous recevons une vie nouvelle, par notre communion à la pauvreté du Christ.
Certes, on pourrait se moquer de l’eucharistie et dire : « Mais ce n’est qu’un bout de pain, que voulez-vous que cela fasse ? Pourquoi le vénérez-vous tellement ? » Et pourtant nous déployons toute une liturgie et toute une vénération, comme ce soir, pour ce bout de pain. Pourquoi ? Parce que c’est la pauvreté partagée par le Christ, et ce partage nous révèle sa divinité. Dieu est dans ce partage de la pauvreté et nous communique sa divinité. Et c’est pourquoi, en abrégé, nous appelons « Fête-Dieu » la fête d’aujourd’hui. Nous la célébrons ici dans cette église du Saint-Sacrement d’une manière particulièrement solennelle, dans la forme extraordinaire du rite romain, parce qu’elle nous permet de garder la richesse de la liturgie ancienne, dans la beauté de ses gestes, ses mots et de ses chants, qui évoquent le mystère d’amour de Dieu qui se donne à nous.
Cette communion au Christ par la liturgie nous invite à l’action concrète, puisque le Christ nous dit : « faites ceci en mémoire de moi ». Comme lui-même s’est livré à nous et s’est donné à nous, il nous invite à nous donner aux autres. Nous rejoignons l’intuition de sainte Julienne de Cornillon qui, au 13e siècle, était d’abord au service des malades comme directrice d’un hôpital, la léproserie de Cornillon, avant d’être aussi la promotrice de la fête du Saint-Sacrement, fête destinée à favoriser l’union du chrétien au Christ par la communion eucharistique. Et nous portons fortement dans notre prière tous ceux qui se sont donnés pour leurs frères et sœurs durant cette crise du coronavirus. Je pense au personnel soignant, aux personnels des maisons de retraite, à tous ceux qui ont accompagné une personne en difficulté. Cette période difficile nous a aussi stimulés à trouver des gestes nouveaux pour nous soutenir les uns les autres. Elle a fait apparaître l’importance de l’affection et de la solidarité, surtout quand celles-ci faisaient défaut.
Frères et Sœurs, cette pauvreté partagée est un secret de vie. Jésus nous dit (Jn 6,56-59) : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » « Celui qui mange ce pain vivra éternellement ». Dans la communion au Christ nous trouvons la vraie vie, et dans la communion à celui qui souffre, nous trouvons la vraie joie. Plusieurs personnes me l’ont dit durant cette période : les services d’entraide ont accueilli de nouveaux bénévoles; leur venue était particulièrement appréciée, car il y avait parfois plus de service à assurer, plus de repas à distribuer; et ces bénévoles y ont trouvé une vraie joie. Ainsi la communion au Christ débouche dans une communion en Église.
Alors recevons avec foi le corps du Christ qui nous est donné en communion et soyons des témoins de la vraie vie dans notre monde !
Amen ! Alleluia ! »
JPSC