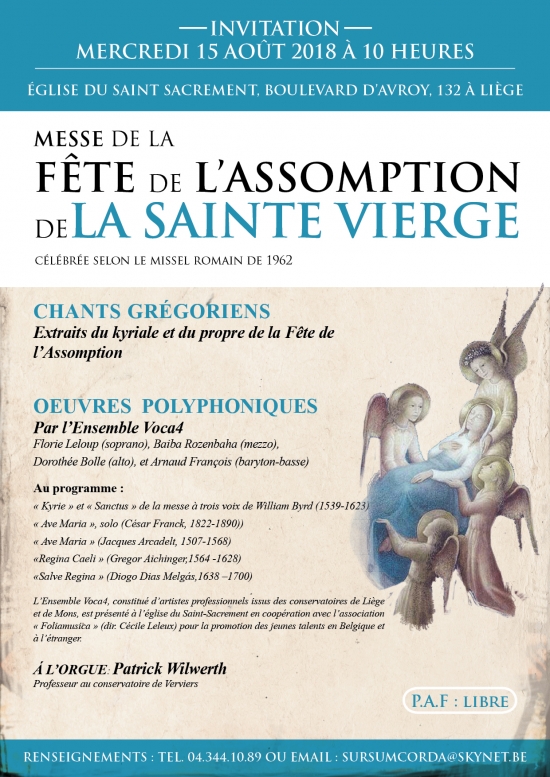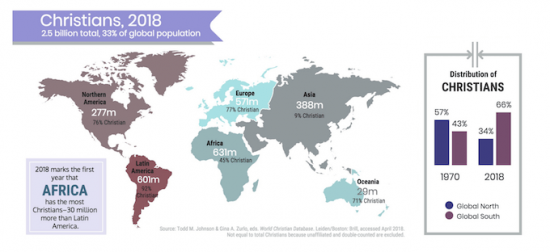Du site "Paix Liturgique" :
LA DERNIÈRE LETTRE DE GIOVANNINO GUARESCHI A DON CAMILLO
Le 21 juillet 2018, l'église Saint-Michel-Archange de Roncole Verdi, village de la commune de Busseto, en Émilie-Romagne (Italie), a accueilli une messe de Requiem à l'occasion du cinquantième anniversaire du rappel à Dieu de Giovannino Guareschi, le créateur de don Camillo. À la demande des enfants de l'écrivain – car don Camillo, avant d'être la série de films à succès que nous connaissons, est une œuvre littéraire profondément catholique – cette messe a été célébrée selon la forme extraordinaire du rite romain, en présence du maire de Busseto, lieu de sépulture de Guareschi, et de celui de Roccabianca, son lieu de naissance. Don Marino Neri, secrétaire de l'Amicizia sacerdotale Summorum Pontificum (voir notre lettre 584 notamment), a prononcé pour l'occasion un sermon vigoureux rappelant que, si la fin proche de l'homme est sa sanctification, sa fin ultime est la gloire de Dieu à laquelle l'auteur de don Camillo a contribué excellemment.
Cet événement nous a permis de prendre connaissance d'un petit chef-d'œuvre que nous vous proposons bien volontiers en cette période de lectures estivales : la lettre adressée par Giovannino Guareschi à « son » don Camillo au lendemain du concile Vatican II et publiée le 19 mai 1966 par le journal Il Borghese. Nous omettons la dernière partie de cette lettre dans laquelle Guareschi regrette avec son ironie mordante que le cardinal Josef Mindszenty n'ait pas été élu Pape à la suite de Jean XXIII car « l'Église du Silence aurait alors acquis une voix puissante ».
Cher don Camillo,
Je sais que vous avez des problèmes avec votre nouvel évêque. Il m'a été rapporté que vous avez dû détruire le maître-autel de l'église paroissiale pour le remplacer par la fameuse « table à repasser », modèle Lercaro (1), reléguant votre bien-aimé Crucifix dans un coin près de la porte d'entrée, de façon à ce que l'Assemblée lui tourne le dos...
De même, j'ai su que le dimanche, une fois célébrée la « Messe du Peuple », vous alliez en célébrer une autre dans la vieille chapelle, intacte, de votre ami Perletti : une messe clandestine, en latin, pour les catholiques.Du coup, les gros bonnets de la Démocratie chrétienne vous ont dénoncé et vous voici fiché en curie parmi les « prêtres subversifs » après avoir reçu un dur avertissement de l'évêque.
Mon Père, vous n'avez décidément rien compris. Il est juste que le Christ ne soit plus sur l'autel : le Christ en Croix est l'image de l'extrémisme. Notre Seigneur était un factieux, un fasciste, et son exhortation « Ou avec Dieu ou contre Dieu » n'est qu'un plagiat du célèbre slogan mussolinien « Ou avec nous ou contre nous ».
Ne se comportait-il pas comme un fasciste en chassant à coups de matraque les marchands du Temple ???
C'est le sectarisme, l'intransigeance et l'extrémisme du Christ qui l'ont amené à la Croix alors que, s'il avait choisi la voix du compromis démocratique, il aurait très bien pu s'entendre avec ses adversaires.
Don Camillo, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en 1966 : les aéronefs parcourent le cosmos à la découverte de l'Univers et la religion chrétienne n'est plus adaptée à la situation. Le Christ a voulu naître sur la Terre ce qui, tant que l'ignorance et la superstition faisaient de la Terre le centre voire l'essence de l'Univers, pouvait encore passer mais qui aujourd'hui, à l'heure des explorations spatiales et de la découverte de nouveaux mondes, le rapporte à un phénomène provincial. Un phénomène qui, comme l'a solennellement établi le Concile, va redimensionner.
Pour vous, Mon Père, les beatniks et leurs cheveux longs ne sont que des pouilleux à envoyer se faire tondre le crâne, et leurs compagnes avec ces jupes courtes qui leur couvrent à peine l'aine des filles de petite vertu à soumettre d'urgence au dépistage de la syphilis. En revanche, à Rome, l'Autorité Ecclésiastique Supérieure a créé une messe spéciale pour ces pouilleux et ces demoiselles de petite vertu – une messe Beat, jouée et hurlée par trois groupes de chevelus.
Vous êtes resté bloqué dans l'autre siècle, Mon Père. Aujourd'hui, l'Église s'adapte à son époque, se mécanise. À Ferrare, sur la « table à repasser » de l'église San Carlo, il y a un distributeur d'hosties : au moment de l'Offertoire, le fidèle qui souhaite communier dépose son offrande sur un plateau, presse un bouton et, au son d'un joyeux carillon, l'hostie tombe dans le calice !
Et, croyez-moi, il n'est pas impossible que dans les laboratoires du Vatican ne soit déjà à l'étude une machine plus complète dotée d'une petite pince qui, une fois la pièce introduite et le bouton pressé, porte directement aux lèvres du communiant l'hostie consacrée électroniquement.
Don Camillo, l'an dernier vous m'avez fait des reproches parce que dans une de mes pièces j'ai raconté que don Giacomo, jeune prêtre des temps modernes, confessait ses fidèles par téléphone et leur envoyait des pulvérisateurs d'eau bénite au lieu de se déplacer pour bénir leurs foyers. Vous m'avez dit qu'on ne plaisantait pas avec ces choses-là...
Pourtant, sur initiative de l'Autorité Ecclésiastique Supérieure, voici qu'on y est presque. Le jour n'est pas si loin où après s'être confessé par téléphone, le fidèle recevra par courrier recommandé l'hostie consacrée à domicile accompagnée d'une petite pince fournie par le « service mécanique » de la paroisse pour pouvoir la consommer sans la toucher avec ses doigts impurs (2). Je n'exclus pas que, pour arrondir les maigres revenus de la paroisse, le curé ne fasse imprimer sur l'hostie quelque message publicitaire...
Don Camillo, je sais que Peppone, aujourd'hui, se fiche ouvertement de vous. Je sais qu'il vous a intimé de retirer du prieuré le portrait provocateur de Pie XII, « le pape fasciste et ennemi du Peuple », menaçant de vous dénoncer à l'évêque. Mais Peppone a raison : les rôles se sont inversés et bientôt la Section du Parti vous ordonnera de déplacer l'horaire des fonctions sacrées pour ne pas menacer la « Festa dell'Unità » (3) organisée sur le parvis de l'église.Don Camillo, si vous ne vous mettez pas à la page et n'arrêtez pas d'appeler « Sans-Dieu » les communistes et de les décrire comme des ennemis de la religion et de la liberté, la Fédération locale du Parti vous suspendra a divinis. Moi qui vous suis attentivement et vous suis attaché depuis vingt ans, je ne voudrais pas vous voir finir d'une si triste façon.
Je sais bien que de nombreux paroissiens, et pas seulement les plus âgés, sont avec vous mais je sais aussi que vous préféreriez partir en silence, en cachette, pour éviter tout incident ou toute polémique qui pourrait tourmenter votre troupeau.
En réalité, vous avez une sainte terreur de voir les catholiques se diviser. Malheureusement, cette division existe déjà.
-------
(1) Du nom du très rouge cardinal de Bologne, Giacomo Lercaro, l'un des plus virulents promoteurs de l'aggiornamento conciliaire en Italie. Choisi par Paul VI, Mgr Lercaro présida de 1964 à 1968 la Commission pour l’Application de la Réforme liturgique, dont le secrétaire n'était autre que Mgr Bugnini...
(2) Là, Guareschi n'osait pas imaginer que les fidèles pourraient un jour être encouragés à se saisir par eux-mêmes de la sainte Hostie !
(3) L'Unità est l'équivalent italien de L'Humanité. Chaque section du PCI (Parti communiste italien) avait l'habitude d'organiser une ou plusieurs fêtes annuelles placées sous le patronage du quotidien du Parti.
 « La fête de l’Assomption tombe au beau milieu de l’été. Le 15 août : cette date ne doit rien au hasard. La montée de Marie à la gloire céleste, « avec son corps et son âme » selon les termes de la définition dogmatique de Pie XII, arrive lorsque les temps sont mûrs. L’Assomption marque en effet la fin de la moisson du mystère pascal. Il en constitue le couronnement, le fruit achevé, avec la Toussaint (le dogme fut d’ailleurs proclamé le premier novembre 1950). Avec l’entrée de Marie au ciel, la rédemption dans le Christ atteint sa pleine consommation.
« La fête de l’Assomption tombe au beau milieu de l’été. Le 15 août : cette date ne doit rien au hasard. La montée de Marie à la gloire céleste, « avec son corps et son âme » selon les termes de la définition dogmatique de Pie XII, arrive lorsque les temps sont mûrs. L’Assomption marque en effet la fin de la moisson du mystère pascal. Il en constitue le couronnement, le fruit achevé, avec la Toussaint (le dogme fut d’ailleurs proclamé le premier novembre 1950). Avec l’entrée de Marie au ciel, la rédemption dans le Christ atteint sa pleine consommation.