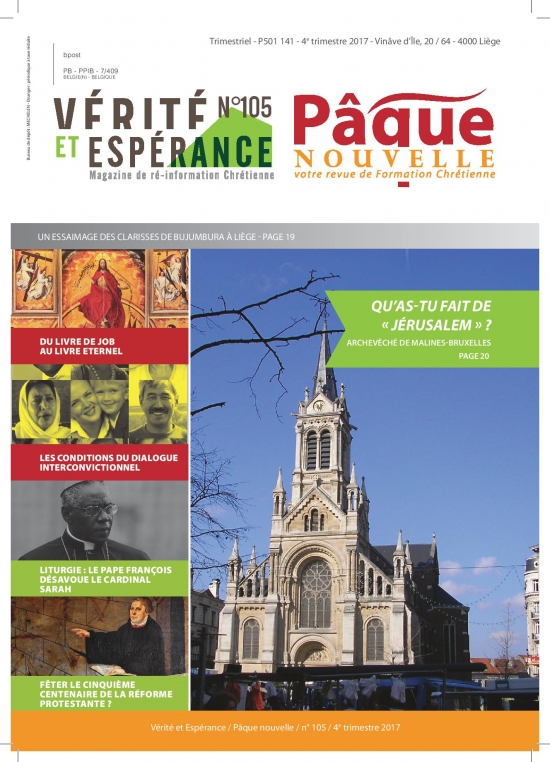En cette nouvelle année 2018, nous allons commémorer le centenaire de la dernière année de combat de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, à 11h00, l’armistice entrait officiellement en vigueur. Dans le calendrier liturgique, c’était la fête de saint Martin, cet officier romain devenu apôtre du Christ et qui allait devenir l’une des grandes figures de la sainteté française.
Dès avant le déclenchement du conflit, la papauté avait appelé à la paix, en espérant jusqu’au bout que le dialogue remplacerait la voix des armes. Le pape saint Pie X d’abord, puis après sa mort, le 20 août 1914, son successeur, Giacomo della Chiesa, qui prit le nom de Benoît XV, lors de son élection, le 3 septembre 1914. Depuis fin juillet-début août de la même année, l’Europe s’était embrasée pour quatre longues et meurtrières années de guerre.
La papauté pour la paix
Avant de mourir le 28 septembre 2016, l’historien de l’Église Paul Christophe, prêtre du diocèse de Cambrais, avait achevé un livre consacré au pape Benoît XV et à son rôle pendant la Grande Guerre. Publié peu après aux éditions du Cerf, cet ouvrage d’un peu plus de 250 pages entend offrir une synthèse de la manière dont l’activité déployée par le Pape en faveur de la paix a été perçue en France et comment Benoît XV a maintenu le cap pendant toute la durée du conflit.
L’auteur, dont trois précédents ouvrages étaient consacrés à la Première Guerre mondiale, notamment à travers la publication de lettres de catholiques engagés dans le conflit, est aussi celui qui avait mené à bien, entre 1994 et 2003, la publication des neuf volumes contenant les carnets du cardinal Alfred Baudrillart, lesquels s’étalaient entre 1914 et 1942, année de la mort de celui qui fut recteur de l’Institut catholique de Paris et membre de l’Académie française. C’est principalement à partir de la matière de ces carnets Baudrillart et de lettres de catholiques envoyés au front que Paul Christophe aborde le rôle de Benoît XV en faveur de la paix et, surtout, comment son action fut perçue en France.
Une guerre de civilisation ?
Alors que l’Allemagne a envahi la Belgique, violant la neutralité de ce pays, une pression se fait jour qui demande au pape de condamner l’agression et de prendre partie. Pour les Alliés, la guerre menée contre l’Allemagne est une guerre de civilisation. Selon eux, ils luttent contre la barbarie germanique. Cette thèse est largement reprise et défendue, non seulement par la presse (soumise à la censure, ce que ne rappelle pas l’auteur), mais aussi la très grande majorité des élites. Les personnalités catholiques, membres du clergé ou laïcs influents, ne sont pas en reste. De là va naître l’incompréhension de la position de Benoit XV, incompréhension qui va se muer au fil du temps en refus de sa politique. Celui-ci trouve certainement son point d’acmé quand le lundi 10 décembre 1917, en l’église de la Madeleine, à Paris, le Père Sertillange prononce un discours sur la « Paix française », en, présence notamment du cardinal Amette, archevêque de Paris. Or, que déclare, ce jour-là, le célèbre dominicain ?
« Très Saint Père, nous ne pouvons pas, pour l’instant, retenir vos appels de paix ».
Non seulement le cardinal Amette est présent ; non seulement, il ne proteste pas, mais plus encore, il a laissé donné l’imprimatur à la publication du discours du prédicateur. C’est évidemment trop pour Rome. Et, naturellement, le cardinal Gasparri, secrétaire d’État, exige des sanctions.
L’action du Saint-Siège
Quelle aura été la position du Saint-Siège pendant toute cette guerre ? On a parlé de neutralité ? Ce n’est pas exact ! Benoît XV a pris constamment parti pour la paix. Il s’est opposé à la guerre, a milité pour la concorde entre les nations et « a condamné, écrit Paul Christophe, toutes les violations du droit et toutes les atrocités commises par qui que ce soit, en se voulant impartial. » De fait, le Souverain Pontife n’a pas voulu que la papauté fût entraînée d’un côté ou de l’autre, voulant rester le Père commun.
Pendant le conflit, Benoît XV a été décrié, en France, comme le « pape boche » ou comme « Pilate XV » pour reprendre les termes de Léon Bloy. Il subissait un sort à peu près similaire de l’autre côté du Rhin, ce que Paul Christophe ne rappelle pas assez. C’est d’ailleurs un manque de son livre : on aimerait voir comment était traité le pape dans la presse allemande ou parmi les politiques comme on aimerait savoir comment le pape était perçu par les pays alliés.
La différence est que l’Allemagne n’avait pas coupé toutes relations officielles avec le Saint-Siège. Le 20 avril 1917, Mgr Eugenio Pacelli a été nommé nonce apostolique en Bavière, Munich étant alors l’unique représentation du Saint-Siège dans l’Empire allemand. Malgré ce fait, le nonce peut agir ou tenter d’agir. Ainsi, il rencontre le chancelier allemand Bethmann-Hollweg, le 26 juin de la même année, puis le Kaiser Guillaume II en personne, le 29 juin. Le lendemain, il s’entretient également avec un allié de l’Allemagne, l’empereur d’Autriche-Hongrie Charles Ier.
Toute la différence avec la France réside là : pour faire avancer les idées de paix, le cardinal Gasparri est obligé, par exemple, de s’en remettre, en 1915, à l’entremise de Mgr Baudrillart pour sonder le gouvernement français… Il ne peut agir directement ! Sans oublier que la France compte alors comme allié l’Italie, avec laquelle le Saint-Siège n’a pas encore réglé la Question romaine de 1870 et qui refuse obstinément, y compris pour la Conférence de la paix en 1919, de voir la papauté jouait un rôle ou simplement d’être reconnu comme partenaire international.
Un pape réhabilité
Depuis quelques années, la figure de Benoit XV, et singulièrement son action pendant la Première Guerre mondiale, est réétudiée et réhabilitée. Parmi les ouvrages sur la questions, citons surtout celui de Nathalie Renoton-Beine, La colombe et les tranchées : Benoît XV et les tentatives de paix durant la Grande Guerre (Cerf), et les biographies de Marc Launay et d’Yves Chiron. Le livre de Paul Christophe s’inscrit dans cette veine, mais à travers un essai historique dont la thèse est de montrer que Benoît XV a œuvré en faveur de la paix sans céder aux pressions des gouvernants, des élites et de la « presse nationaliste », tout en rencontrant un accueil favorable parmi une grande partie des combattants.
Ce dernier aspect est, malgré tout, l’un des points faibles de l’ouvrage. Bien sûr, l’auteur cite plusieurs lettres de poilus montrant leur dégout de la guerre, de la barbarie des combats et, parfois, leur accord avec le pape. Mais il aurait fallu pouvoir établir dans quelle mesure ce sentiment était partagé parmi l’ensemble des combattants, avec, il est vrai, cette difficulté que les propos jugés défaitistes devaient passer au crible de la censure.
Par ailleurs, Paul Christophe s’en prend à la « presse nationaliste », opposée à l’action de Benoît XV. Malheureusement, le terme est équivoque. Et il n’est clairement défini par l’auteur. S’agit-il de la presse politiquement nationaliste, à l’instar de L’Action française, ou une fièvre nationaliste dans la presse en temps de guerre ? L’auteur ne cite qu’une fois L’Action française et, pour le reste, des titres et de noms de personnalités qui n’appartenaient pas politiquement au camp nationaliste. Par exemple, il évoque Fernand Laudet, le même Laudet qui avant guerre avait subi les foudres du nationaliste Péguy à propos de Jeanne d’Arc.
Une religion séculière
Il est vrai pourtant qu’il y a eu chez les catholiques français – et ailleurs ! – une fièvre nationaliste pendant cette guerre, laquelle dépassait largement les mouvements et les partis nationalistes. Il y a eu, comme le montre Paul Christophe, une assimilation de la religion au patriotisme, laquelle a entraîné une confusion. Mais sur ce point, il est beaucoup moins clair que Jean de Viguerie dans son essai Les deux patries où l’historien n’oppose pas foi et patriotisme, mais la vertu de patriotisme, ordonnée elle-même à un ordre plus grand, au patriotisme révolutionnaire, idéologique et expansionniste par nature.
Au fond, la thèse de Paul Christophe, à travers cette étude intéressante sur Benoît XV, est que les réflexes nationalistes en temps de guerre ont sacralisé la patrie, en l’élevant au rang de religion de substitution, assimilant même la religion à son dessein. De ce point de vue, Les deux patries de Jean de Viguerie reste plus percutant.
De même, un certain nombre d’éléments de compréhension historique manquent ici, comme par exemple le fait que les catholiques ont répondu positivement à l’Union sacrée en espérant y retirer un bénéfice en faveur de leur retour dans la vie sociale (cf. à ce sujet 1914, l’Église face à la guerre, hors série n°16 de L’Homme Nouveau). À la place, il y eut certes le retour des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, mais dans le cadre d’une religion séculière qu’avait très bien vue l’abbé Mugnier, cité par Paul Christophe :
« 13 novembre 1923. On a allumé, dimanche, une flamme perpétuelle devant la tombe du soldat inconnu. Voilà un culte nouveau établi. On nous a pris la lampe du sanctuaire, la voilà laïcisée. »
Il y eut également une autre conséquence, qu’avait parfaitement perçu dès 1914, Mgr Baudrillart, cité aussi par Paul Christophe :
« À force de ménager tout le monde, le Saint-Siège finira, par laisser, à la fin de la guerre, le rôle d’arbitre moral au président des États-Unis. » La raison n’est peut-être pas celle invoquée par le recteur de l’Institut catholique de Paris. Mais le résultat est bien là.
Nous y sommes encore !
Paul Christophe, Benoît XV et la Grande Guerre, Cerf, 258 pages, 22 €

 Nouvelle répression, ce dimanche, des tentatives des chrétiens congolais d’organiser des marches pacifiques pour réclamer l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre 2016, qui balise la marche vers des élections consensuelles. Celles-ci, qui auraient dû être organisées en 2016, ne l’ont pas été, ce qui a permis au président Joseph Kabila de se prolonger au pouvoir en dépit de la fin de son dernier mandat constitutionnel.
Nouvelle répression, ce dimanche, des tentatives des chrétiens congolais d’organiser des marches pacifiques pour réclamer l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre 2016, qui balise la marche vers des élections consensuelles. Celles-ci, qui auraient dû être organisées en 2016, ne l’ont pas été, ce qui a permis au président Joseph Kabila de se prolonger au pouvoir en dépit de la fin de son dernier mandat constitutionnel.