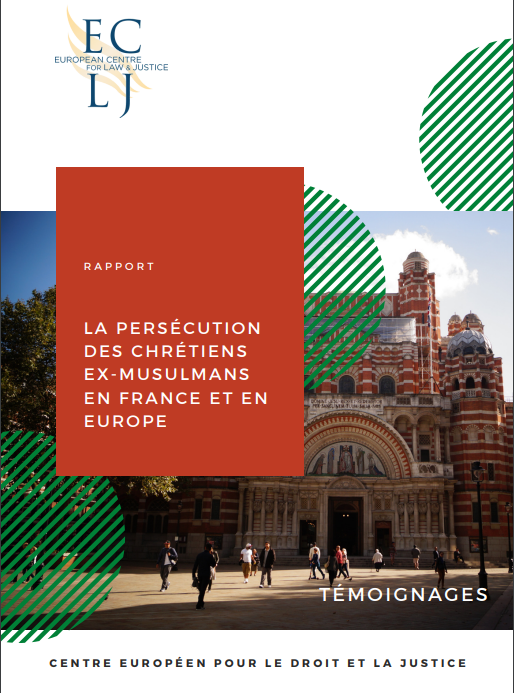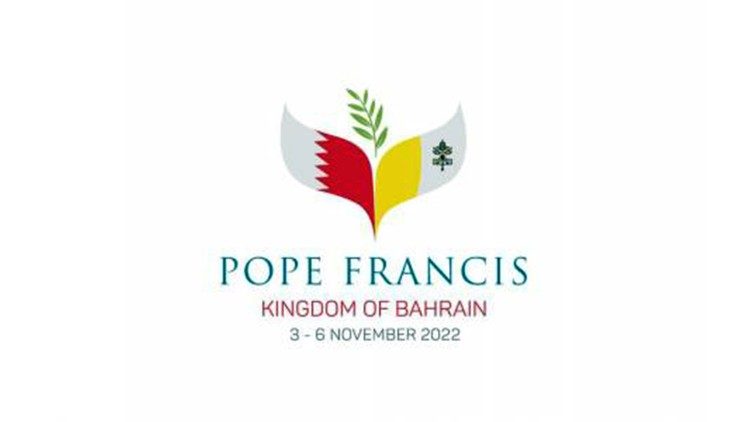D'Anna Bono sur La Nuova Bussola Quotidiana :
Les chrétiens d'Afrique dans le collimateur des extrémistes islamiques
19-11-2022
Rien qu'au Nigeria, 7 600 chrétiens ont été tués en un an et demi, mais dans toute l'Afrique - à quelques exceptions près - les chrétiens sont menacés par l'extrémisme islamique. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur les chrétiens persécutés publié par l'Aide à l'Église en détresse (AEC). "Dans 75% des 24 pays examinés, la persécution des chrétiens a augmenté". Des situations très critiques existent également au Moyen-Orient, en Corée du Nord, en Chine et en Inde.
La fondation pontificale Aide à l'Église en détresse (AEC) publie tous les deux ans un rapport sur les chrétiens persécutés dans le monde. Le 17 novembre, elle a présenté sa huitième édition, intitulée "Persécutés plus que jamais. Rapport sur les chrétiens opprimés pour leur foi 2020-2022. La période de référence s'étend d'octobre 2020 à septembre 2022. Les informations et les données rapportées ont été recueillies par l'AEC elle-même et ses correspondants locaux dans 24 pays où les violations de la liberté religieuse et les violences infligées aux fidèles sont fréquentes et particulièrement préoccupantes. Les pays, tous sauf un, la Russie, sont asiatiques et africains : Afghanistan, Arabie saoudite, Chine, Corée du Nord, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Inde, Iran, Irak, Israël et les territoires palestiniens, Maldives, Mali, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Qatar, Russie, Sri Lanka, Soudan, Syrie, Turquie et Vietnam.
L'objectif de la fondation est de donner une voix aux persécutés, de faire connaître leur situation au public, aux médias et aux représentants des institutions qui peuvent leur venir en aide. "L'Église qui souffre a besoin de personnes qui parlent en son nom. Pour que les meurtres cessent, davantage d'organisations comme l'AEC doivent proclamer la vérité sur ce qui arrive aux chrétiens dans le monde. Sinon, nous resterons à jamais persécutés et oubliés". C'est par ces mots que Monseigneur Jude A. a commenté la présentation du rapport. Arongudade, évêque d'Ondo, le diocèse du Nigeria où un commando armé a attaqué une église où une messe était célébrée en juin dernier, tuant plus de 40 personnes.
Le Nigeria détient le record du nombre de chrétiens tués en Afrique : environ 7 600 entre janvier 2021 et juin 2022, pour la plupart victimes des deux groupes djihadistes du pays, Boko Haram et Iswap. Mais sur tout le continent, à quelques exceptions près, les chrétiens sont menacés par l'extrémisme islamique, qui a gagné du terrain au Sahel et en Afrique subsaharienne. Depuis 2017, elle a également pénétré dans le nord du Mozambique, s'installant et recrutant des centaines de jeunes de confession islamique pour le djihad. Par ailleurs, sur l'ensemble du continent, la haine envers les chrétiens se superpose aux divisions tribales et les renforce : c'est le cas des affrontements armés entre bergers musulmans et agriculteurs chrétiens dans les régions centrales du Nigeria et en République centrafricaine.
Dans 75% des 24 pays examinés, a expliqué Alessandro Monteduro, directeur de l'AEC Italie, en présentant le rapport au public, l'oppression ou la persécution des chrétiens a augmenté. Au Moyen-Orient, cela a conduit de nombreux chrétiens à partir et à ne jamais revenir. En Syrie, le nombre de chrétiens est passé de 1,5 million avant la guerre à environ 300 000 : en termes de pourcentage, la population chrétienne est passée de 10 % à moins de 2 %. En Irak, l'exode est moins important. Cependant, les chrétiens, qui étaient environ 300 000, ont été mis en fuite en 2014 par la formation d'Isis, l'État islamique. Malgré sa défaite en 2018, beaucoup ne sont pas revenus et maintenant leur communauté est réduite de moitié. "Paradoxalement", selon l'AEC, "plusieurs signes indiquent que dans certaines régions du Moyen-Orient, les chrétiens vivent dans des conditions pires que pendant l'occupation par Isis".
Dans le reste du continent asiatique, la pire situation reste celle des chrétiens de Corée du Nord, où l'interdiction de culte est pratiquement totale. Au Sri Lanka, ce sont les nationalistes hindutva et les bouddhistes cinghalais qui persécutent les chrétiens avec le soutien des autorités : ce sont les policiers eux-mêmes qui interrompent les services religieux et arrêtent les fidèles qui y assistent. En Inde, l'extrémisme hindou est responsable des cas de plus en plus fréquents d'intolérance à l'égard des chrétiens et des autres minorités, avec le soutien du parti nationaliste hindou au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP). Entre janvier 2021 et début juin 2022, 710 incidents de violence anti-chrétienne ont été enregistrés, mais beaucoup d'autres ne sont pas signalés en raison de la méfiance envers les institutions. Lors d'une manifestation de masse à Chhattisgarh en octobre 2021, a rappelé le président Monteduro, les membres du BJP ont acclamé le chef religieux hindou de droite Swami Parmatman et ont appelé au meurtre des chrétiens. "En Chine", a souligné M. Monteduro, "les autorités ont accru la pression sur les chrétiens par des arrestations sans discernement, la fermeture forcée des églises et l'utilisation de systèmes de surveillance oppressifs. Parmi les victimes de persécution figure le cardinal Joseph Zen, arrêté en mai dernier et accusé de collusion avec des forces étrangères pour avoir fait partie des administrateurs du Fonds de secours humanitaire 612, créé pour aider financièrement et légalement les participants aux manifestations antigouvernementales de 2019 à Hong Kong. Le procès contre lui et cinq autres accusés a débuté le 26 septembre.
Même dans les pays islamiques d'Asie, les chrétiens souffrent de discrimination, d'injustice, d'intimidation et de violations des droits de l'homme. Leur situation est devenue presque désespérée en Afghanistan, après le retour au pouvoir des Talibans qui imposent une interprétation stricte de la shari'a, la loi islamique. Moins grave, mais extrêmement sérieuse est également la position de la petite minorité chrétienne aux Maldives, où les autorités refusent même la citoyenneté aux non-musulmans.
En Occident, conclut le rapport, il existe une "perception culturelle erronée très répandue qui continue de nier que les chrétiens restent le groupe religieux le plus persécuté". Et c'est une partie du problème.