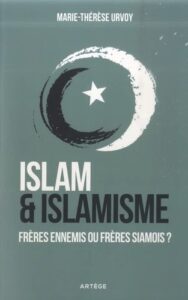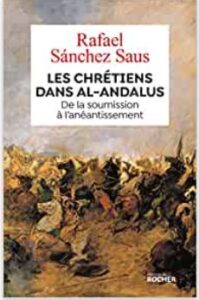De VoaNews.com :
Une étudiante chrétienne nigériane accusée de blasphème massacrée par la foule
12 mai 2022
KANO, NIGERIA -
Des étudiants musulmans de la ville de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, ont lapidé et brûlé le corps d'une étudiante chrétienne après l'avoir accusée de blasphème contre le prophète Mahomet, a indiqué la police.
Des dizaines d'étudiants musulmans du Shehu Shagari College of Education se sont déchaînés après que Deborah Samuel, une autre étudiante, a fait une déclaration sur les médias sociaux qu'ils ont jugée offensante à l'égard du prophète Mahomet, a déclaré Sanusi Abubakar, un porte-parole de la police de Sokoto dans un communiqué.
Les "étudiants ont sorti de force la victime de la salle de sécurité où elle était cachée par les autorités de l'école, l'ont tuée et ont brûlé le bâtiment", a déclaré M. Abubakar.
Il a ajouté que les élèves ont bloqué l'autoroute devant l'école avant que les équipes de police ne les dispersent.
Abubakar a déclaré que deux suspects avaient été arrêtés.
Sokoto fait partie d'une douzaine d'États du nord où le système juridique islamique strict ou la charia est en vigueur.
Le commissaire à l'information de l'État, Isah Bajini Galadanci, a confirmé dans un communiqué le "malheureux incident ... au cours duquel une étudiante du collège a perdu la vie."
Un étudiant qui a donné son nom de Babangida, a accusé l'étudiante assassinée d'avoir posté "une remarque offensante sur un groupe Whatsapp d'étudiants que tout le monde a vu."
"Les étudiants musulmans de l'école qui étaient furieux de son insulte se sont mobilisés et l'ont battue à mort", a-t-il déclaré.
Son récit a été soutenu par trois autres étudiants.
Les images du déchaînement ont été partagées sur les médias sociaux, et la police a déclaré que tous les suspects identifiés dans la vidéo seraient arrêtés.
Le gouvernement de l'État a ordonné la fermeture immédiate de l'école en vue de déterminer "les causes lointaines et immédiates de l'incident."
Le blasphème dans l'islam, notamment contre le prophète, est passible de la peine de mort en vertu de la charia, qui fonctionne parallèlement au droit commun dans la région.
Deux musulmans ont été séparément condamnés à mort en 2015 et 2020 par des tribunaux de la charia pour blasphème contre le prophète.
Mais les affaires sont toujours en appel.
Dans de nombreux cas, les accusés sont tués par des foules sans passer par la procédure légale.
L'année dernière, une foule dans le district de Darazo, dans l'État de Bauchi (nord-est), a brûlé à mort un homme accusé d'avoir insulté le prophète.
En 2016, une commerçante chrétienne de 74 ans, Bridget Agbahime, a été battue à mort par une foule musulmane devant sa boutique à Kano après l'avoir accusée d'avoir insulté le prophète.