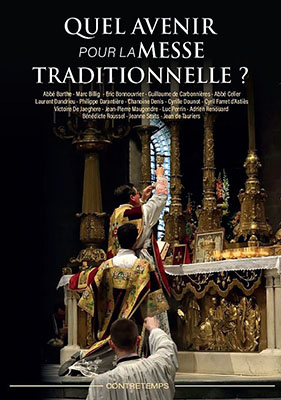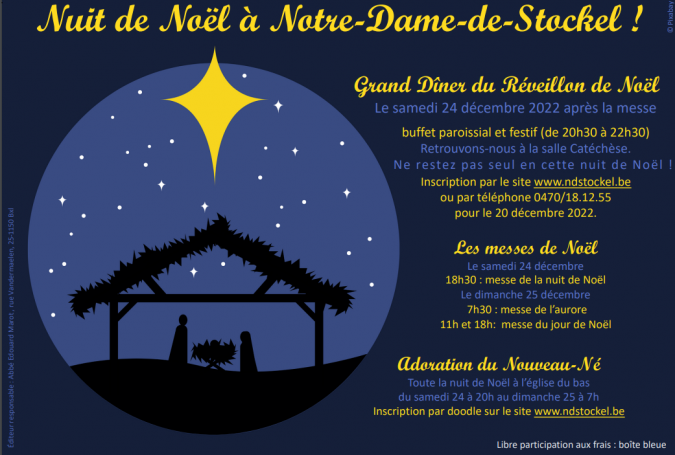De Stefano Chiappalone sur la Nuova Bussola Quotidiana :
Benoît XVI : la beauté qui ouvre le cœur à Dieu
2-01-2023
Un fil conducteur important du riche enseignement de Joseph Ratzinger est le concept de "raison élargie". Une raison qui ne rejette pas l'étonnement et ne s'enferme pas dans l'horizon matériel, mais reste capable d'accueillir les diverses expressions de l'art et de la beauté comme autant de manières d'être fasciné par le Mystère de Dieu.
Malgré la profondeur intellectuelle qui le place à juste titre parmi les "grands" de la pensée contemporaine et - en perspective - parmi les "docteurs" de facto de l'Église, Benoît XVI était aussi une "petite voie" - comparable en quelque sorte à celle de la "petite" Sainte Thérèse de Lisieux - capable de s'émerveiller de la beauté comme voie privilégiée pour trouver (ou redécouvrir) la foi. Tout le contraire de l'étiquette de panzerkardinal ou de " berger allemand ", qui ne pourrait être crue que par ceux qui n'ont jamais fait l'effort (pourtant agréable) d'approcher ses discours, préférant ingurgiter la rumeur injuste répandue chez de nombreux catholiques (plus enclins à un sentimentalisme bon marché compatible avec les sirènes du conformisme médiatique).
Benoît XVI ne s'oppose pas à l'émerveillement et à la lucidité de la pensée, mais il les intègre dans la perspective de ce qu'il a lui-même défini à plusieurs reprises comme une "raison élargie", c'est-à-dire capable d'englober également la beauté, l'amour, toutes ces réalités qui ne sont pas "mesurables" et dont l'existence et la nécessité ne peuvent être niées. Au contraire, "une raison qui voudrait en quelque sorte se dépouiller de la beauté serait réduite de moitié, ce serait une raison aveuglée". Cette complémentarité est inhérente au christianisme, puisque " le "Logos" créateur n'est pas seulement un "logos" technique ", mais " est amour et donc de nature à s'exprimer dans la beauté et la bonté ", a-t-il affirmé en été 2008 à Brixen (reprenant en partie la lectio de Ratisbonne). C'est pourquoi le pape émérite était convaincu que "l'art et les saints sont la plus grande apologie de notre foi".
S'il faut lui coller une étiquette, Benoît XVI était plutôt le pape de la beauté, qu'il définissait comme "la grande nécessité de l'homme ; c'est la racine d'où jaillissent l'arbre de notre paix et les fruits de notre espérance" : c'est ainsi qu'il s'exprimait à l'occasion de son voyage apostolique en Espagne en novembre 2010, à Saint-Jacques-de-Compostelle et à Barcelone, où il est allé consacrer la basilique de la Sagrada Familia. Il a souligné le lien entre la beauté du bâtiment et la spiritualité de l'architecte Antoni Gaudí, qui n'était pas une star de l'architecture, mais "un architecte brillant et un chrétien conséquent, dont le flambeau de la foi a brûlé jusqu'à la fin de sa vie, vécue avec une dignité et une austérité absolues". À partir des trois livres de la Création, de l'Écriture et de la Liturgie, Gaudí a donné vie au "miracle architectural" de la Sagrada Familia, "un espace de beauté, de foi et d'espérance, qui conduit l'homme à la rencontre de Celui qui est la vérité et la beauté même".
Depuis son enfance, Joseph Ratzinger voit dans la beauté un chemin privilégié vers Dieu. De sa Bavière festive et très catholique, il a rapporté "le parfum émanant des tapis de fleurs et des bouleaux verdoyants ; les ornements de toutes les maisons, les drapeaux, les chants ; j'entends encore les instruments à vent de la fanfare locale". Une jubilation qui trouve son fondement dans le matin de Pâques, ou plutôt le samedi saint : le jour même de sa naissance (16 avril 1927), une coïncidence qui constituait pour lui - comme il l'a rappelé dans son autobiographie Ma vie, publiée en 1997 - un "signe prémonitoire" sur le plan personnel mais aussi "une caractéristique de notre existence humaine, qui attend encore Pâques, n'est pas encore en pleine lumière, mais s'en approche avec confiance". Et il le fait aussi à travers l'art, la beauté du paysage et des bois, et la musique, qui chez les Ratzinger est dans l'air depuis l'enfance (après tout, ils vivaient aux frontières de la Salzbourg de Mozart), dans une continuité naturelle avec la liturgie. Et c'est leur père qui jouait et expliquait les lectures pour les préparer à la messe du dimanche : à l'époque, "lorsque le Kyrie commençait, c'était comme si le ciel s'ouvrait".
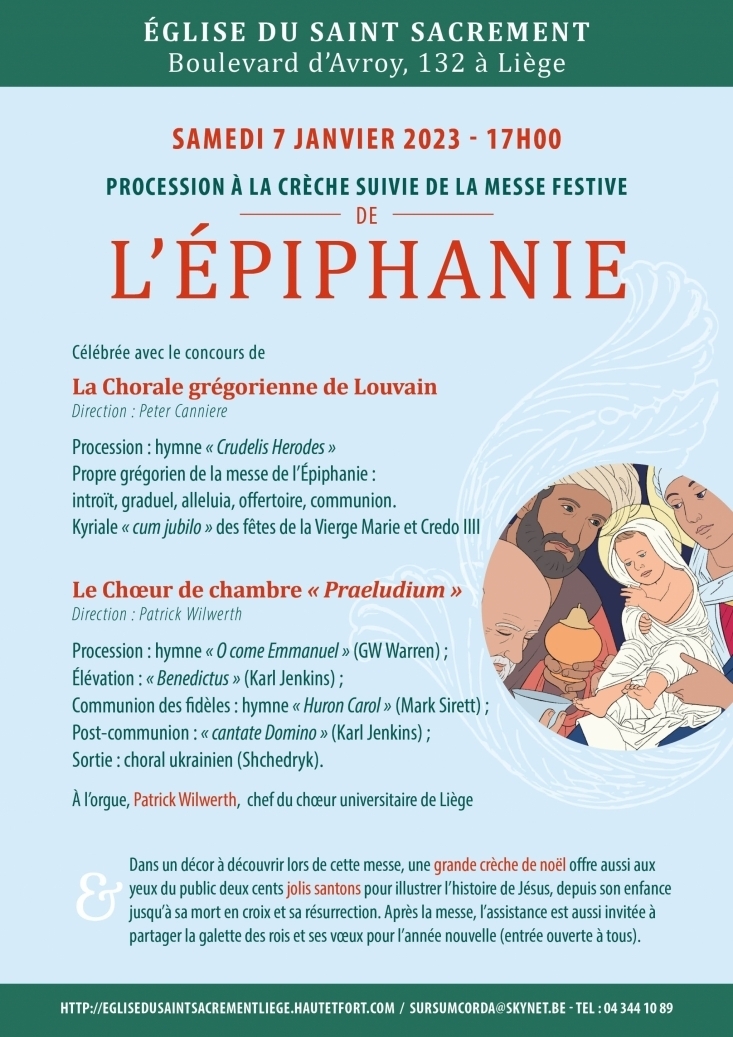

/image%2F0962328%2F20230102%2Fob_5ca356_hommage-a-b16-1.jpg)